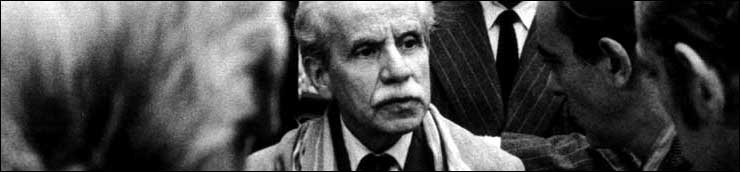|
|
JORGE LUIS BORGES - FRAGMENT Invasion est un film qui m’a vraiment beaucoup intéressé, et duquel je peux parler en toute liberté puisque seul un tiers du film me revient (si tant est que l’on puisse mesurer ces choses-là) étant donné que je l’ai fait avec Hugo Santiago et Adolfo Bioy Casares. Dans tous les cas, il s’agit d’un film fantastique et d’un genre de fantaisie que l’on peut qualifier de nouveau. Il ne s’agit pas d’un film de fiction scientifique à la manière de (H. J.) Wells ou de Bradbury. Il n’y a pas non plus d’éléments surnaturels. Les envahisseurs n’arrivent pas d’un autre monde, ce n’est pas non plus un film psychologiquement fantastique : les personnages n’agissent pas –comme ils peuvent le faire dans les œuvres d’Henry James ou de Kafka– en opposition au comportement général des hommes. Il y est question d’une situation fantastique : la situation d’une ville (et malgré sa topologie différente, elle est évidemment Buenos Aires) qui est assiégée par des envahisseurs puissants et défendue –on ne sait pas pourquoi– par un petit groupe de civils. Naturellement ces civils ne ressemblent pas à cette nouvelle version de Douglas Fairbanks qui s’appelle James Bond. Non : ce sont des hommes comme tous les hommes ; ils ne sont pas spécialement courageux ni (sauf un) particulièrement forts. Ce sont des personnes qui essayent de sauver leur patrie de ce danger, et qui meurent ou se font tuer sans emphase épique majeure. Mais j’ai voulu que le film soit finalement épique. C’est-à-dire, ce que ces hommes font est épique, mais ils ne sont pas des héros. Et je crois que l’épique consiste bien en cela ; parce que si les personnages de l’épique sont dotés de forces exceptionnelles ou de vertus magiques, alors ce qu’ils font n’a pas une trop grande valeur. En revanche, ici nous avons un groupe d’hommes, pas tous jeunes, certains assez quelconques, il y a même un père de famille ; ces personnes sont à la hauteur de cette mission-là qu’ils ont choisie. Et je crois que, en plus de l’étrangeté de cette fable, nous avons bien résolu le grand problème technique que nous avions (et que je suppose être un problème pour quiconque dirige un western) : le fait qu’il doit y avoir beaucoup de morts violentes (ceci arrivait avant avec les films de gangsters, je ne sais pas si on en fait toujours, je crois que non), le fait qu’il faille beaucoup de morts violentes et que ces morts soient pourtant différentes : elles ne peuvent pas être répétitives et monotones. De telle façon que, je le répète, nous avons essayé (j’ignore avec quelle fortune) un genre nouveau de film fantastique : un film basé sur une situation qui n’a pas lieu dans la réalité et qui doit, cependant, être acceptée par l’imaginaire du spectateur. Je crois que dans un livre de Coleridge on parle de ce thème, le thème de ce que croit le spectateur au théâtre ou de ce que croit le lecteur d’un livre. Le spectateur n’ignore pas qu’il est dans un théâtre, le lecteur sait qu’il est en train de lire une fiction ; et cependant tous deux doivent croire de quelque manière l’un ce qu’il voit, l’autre ce qu’il lit. Coleridge a trouvé une phrase heureuse. Il
a parlé de a willing suspension of disbelief : une suspension
volontaire de l’incrédulité. Et j’espère que
nous avons obtenu cela durant les deux heures d’Invasion. Je voudrais
rappeler en plus que Troilo a composé, pour une milonga dont
les paroles sont banalement de moi, une musique admirable. Je crois,
en plus, que le cinématographe, comme d’autres genres artistiques
(le théâtre, la conférence), est toujours une
œuvre "en collaboration" : je crois que le succès
d’un film, d’une conférence, d’une pièce de théâtre,
dépend aussi du public. Et j’ai été curieux
de savoir comment Buenos-Aires recevrait ce film, qui ne ressemble
à aucun autre et qui ne veut ressembler à aucun autre.
Dans tous les cas, nous avons inauguré un genre nouveau –il
me semble– dans l’histoire du cinématographe. |
| Extrait de Fernando Sorrentino, Sept
conversations avec Jorge Luis Borges, Buenos Aires - Editions El Ateneo , 1996 |
|
|
ADOLFO BIOY CASARES (1914-1999) Grand maître, avec son alter ego Jorge Luis Borges, de la littérature fantastique, ce romancier, conteur et essayiste est fasciné très tôt par le mystère que renferment les livres. Dès 1929, il écrit un conte fantastique, Vanidad, et en 1930 paraît son premier livre, Prologó. Après des études de lettres et de droit qu’il ne mène pas à leur terme, il fonde (avec Borges) une maison d’édition, publie une revue, participe à Sur et écrit pour La Nación. Doté d’une vaste culture littéraire, scientifique et philosophique, il conçoit des romans et des contes comme une façon de construire d’autres réalités permettant de comprendre les significations infinies du monde et de l’existence. La invención de Morel (1940), dont la trame est "parfaite" selon le préfacier (Borges), donne le ton à une oeuvre tout entière tournée vers le paradoxal et le fantastique. Suivent d’autres romans, Plan de evasión (1945), El sueño de los héroes (1954), Diaro de la guerra del cerdo (1969) et Dormir al sol (1973). Parmi les contes, on citera La trama celeste (1948), Historia prodigiosa (1956) et Guirnalda con amores (1959), ce dernier recueil fournissant des clefs pour la compréhension et l’esthétique de Bioy Casares. Sous plusieurs pseudonymes, il a écrit
en collaboration avec Borges de nombreux textes et prologues, des
romans policiers (Seis problemas para Don Isidro Parodi), et avec
Borges et son épouse Silvina Ocampo une Antologiá
de la litératura fantástica (1940). |
|
Extrait
de Anthologie de la littérature hispano-américaine du XXème siècle
de Jean-Marie Lemogodeuc et de Jean Franco (Paris - P.U.F - 1993) |
|
|
A PROPOS Invasion rajeunit le thème de l’Iliade : il ne vante pas l’astuce et l’efficacité du vainqueur, mais le courage d’une poignée de résistants prêts à défendre leur Troie –qui ressemble par trop à Buenos Aires– où il y a toujours une bande d’amis et un tango qui vous invitent à vous battre pour des causes nobles et justes. Homère me pardonne : le coeur est toujours du côté des résistants. Je crois que Hugo Santiago a réussi un film
extraordinaire. |
|
| Adolfo Bioy Casares - Buenos Aires,
mai 1969 |