|
A l’occasion de la rétrospective intégrale Brian
De Palma au Centre Georges Pompidou du 6 février au
4 mars 2002.
|
| |
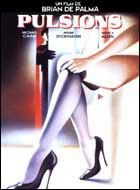 |
|
|
On savait De Palma hanté
par les thèmes récurrents du dédoublement
de la personnalité et du travestissement. La perruque
blonde et les lunettes noires de Bobby dans Pulsions
(déjà peu subtils) cachaient, sous le masque
du thème et de la simple tromperie (qui est qui ?)
dans laquelle se perdaient les personnages, un véritable
engouement de la part du cinéaste pour le déguisement.
C’est ce que l’on pût découvrir lors de la rétrospective
intégrale des films de Brian de Palma au Centre Georges
Pompidou qui se déroula du 6 février au 4 mars
2002. Alors que le thème du double et du travestissement
semble s’étioler de film en film, ou devient de plus
en plus pointu (le déguisement ne se désigne
pas comme tel, il est invisible, impossible à déceler,
comme dans Mission : Impossible), alors que se
trouvent deux personnalités pour une même apparence
(Snake Eyes) et non une personne pour deux sexes, deux
visages (Pulsions), les premiers films de Brian De
Palma, habités par William Finley, acteur devenu culte
grâce à son rôle dans Phantom of the
Paradise, désignaient le déguisement en
observant sa fabrication, comme si le cinéaste expliquait
avant coup le leurre dont allaient être victimes les
personnages de ses films futurs.
En employant Finley dans
tous ses premiers films, De Palma observe le travail du comédien
sous tous les angles (voir Dionysus in 69, filmé
par trois caméras et projeté en écran
partagé), le suivant, transformation après transformation.
Comme il le répète dans Dionysus in 69,
William Finley est William Finley, William Finley est le personnage,
et le personnage est William Finley. Quelle est la part de
l’acteur et celle du personnage, où commence l’un,
où finit l’autre ? Dans Dionysus, Finley
se plait à nous perdre dans un mythe réinventé,
où les personnages portent les noms des acteurs et
inversement, où les spectateurs deviennent acteurs,
les acteurs spectateurs, et s’unissent dans une transe au
rythme des tambours. Finley brouille les pistes et empêche
le bon déroulement de la pièce, la terminant
en un cortège anarchiste, constituant ainsi la performance
unique, et pourtant reproductible et manipulable, puisque
filmée, montée et projetée… Ainsi débute
une réflexion sur le cinéma et le réel
(plus flagrante encore dans le documentaire, The responsive
eye), et sur son rapport au temps. L’acteur représente
l’instant, le réalisateur le fait vivre dans le temps.
Mais ce que le réalisateur nous donne à voir
est-il la même chose que ce que nous offre l’acteur ?
L’un manipule l’autre, mais avec Finley, nous avons en fin
de compte l’impression que l’acteur est roi. Il dirige le
regard (voire le geste) du spectateur dans une performance
qui ne possède pas de scène ni de lieu spécifique
au spectateur, dans laquelle le regard peut errer sans s’attacher
à rien, ou au contraire se fixer sur un acteur/personnage
qui donne une vie parallèle à la pièce.
Mais William Finley (car il est bien William Finley, même
s’il est un William Finley schizophrène) est là,
toujours changeant et surprenant, ne suivant d’autre guide
que son esprit dérangé.
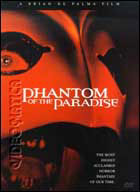 |
|
|
|
William Finley est bien
un acteur/personnage fantôme : noms multiples,
visages et corps changeants. Alors que nous sommes en quête
d’un nom pour le qualifier dans Dionysus, c’est son
corps et surtout son visage que l’on cherche à cerner
dans Wotan’s Take, un court-métrage de 1962.
Seul son nom (justement) au générique nous permet
d’identifier l’acteur. Un nom également est le seul
garant de l’identité du personnage étonnant
qu’il incarne. Ce qui interpelle est moins l’histoire pseudo
narrative qui y est contée, ni le portrait de ce personnage,
mais bien les séquences de transformation dans l’antre
de cette créature magicienne. Car nous sommes bien
dans un conte, où les péripéties et les
apparences ne font pas illusion : nous ne sommes pas
dans Mission : Impossible, où le jeu des
masques nous perd dans l’identité des corps par leur
caractère réaliste. Le masque est bien désigné
comme tel : Finley enlève, ajoute, change de nez…
Nous le voyons ôter et coller ces artifices grossiers
et fantasmatiques, sans jamais voir ce qui se cache en dessous,
le corps originel. Finley passe d’un déguisement à
l’autre comme d’un lieu à l’autre, aussi magiquement,
et ce déguisement est toujours aussi grotesque. Ainsi
De Palma dévoile les artifices qui feront le succès
de ses films futurs, et observe par ce fait le travail du
comédien. Mais mine de rien, le comédien dirige
le réalisateur autant que le réalisateur mène
son film.
|