SYNOPSIS : Anyang,
une ville moyenne de la province chinoise du Henan.Yu Dagang,
un ouvrier quadragénaire se retrouve brusquement au chômage
et sans ressources. Un soir, il découvre en pleine rue
un couffin dans lequel repose un nouveau-né abandonné
par sa mère. Celle-ci, Feng Yanli, une prostituée
originaire de Mandchourie, s'engage à verser la somme
de 200 yuans tous les mois à celui qui acceptera de prendre
soin de son bébé… |
|
....................................................................
|
|
L'ENFANT DE LA PEINE
| |
 |
|
|
Se refiler le bébé quand
on a jeté l’eau du bain : que faire d’un corps en plus
au cinéma, dans un plan de cinéma ? Tout
récemment, Mischka de Jean-François
Stévenin envisageait cette question via le corps rond
de Jean-Paul Roussillon, gros bébé au bord de
la sénilité qui encombrait le départ
en vacances de son fils (interprété par le pétaradant
Yves Afonso). Ce corps en plus était un corps en trop.
En rencontrant l’infirmier Gégène (Stévenin
tel qu’en lui-même, c’est-à-dire dans la posture
contorsionniste d’un altruisme dépensier), grêlé
de corps absents qui lui manquent (oncle, père, fille)
mais auxquels il ne manque pas, Roussillon, rebaptisé
Mischka, lui servira non pas tant de béquille que de
contrepoids. Chez Stévenin, la pesanteur peut être
aussi une grâce. On lâche du lest d’un côté,
on en récupère de l’autre. Ce qui était
vieillesse usée devient par un jeu d’échangeurs
(pas seulement autoroutiers) rondeurs enfantines : un
corps ne se perd jamais, c’est la mauvaise fiction (celle
des vacances programmées et hystériques en famille,
par exemple) qui est perdante de tant manquer à ces
corps-là. De ne plus vouloir les voir. De ne pas ou
plus savoir qu’en faire.
Il y a cinq ans, dans Ossos du
Portugais Pedro Costa, le bébé était
plus rudement encore le corps du délit, non plus métaphorisé
et malléable comme chez Stévenin, mais ici filmé
frontalement, dans sa douleur raide. C’est la question :
" Que fait le Portugal de ses enfants ? ".
Et c’est la réponse : " Des rejetons,
des corps rejetés ". Ce corps particulier,
comme la vie concentrée jusqu’à la souffrance,
sert aussi de prise de poids nécessaire quand l’étiolement
(social avec le chômage, affectif avec le suicide, physiologique
avec la drogue) règne, implacable. Le plan a plus de
chances de durer positivement quand il prend en charge cette
prise en charge involontaire (un bébé tombe
toujours, dans les bras ou du ciel), se substituant aux prises
de drogue et aux tentatives inopérantes de suicide,
à la dé-prise sociale. La référence
obligée se situe du côté du Kid de
Charlie Chaplin : c’était la geste cinématographique
chaplinesque (un art du plan en tant qu’il est une scène
habitable du monde, qu’il rend le monde stable et habitable)
qui surenchérissait sur le désir moteur et secret
du personnage de Charlot de tenir un espace et de le rendre
vivable, pour lui comme pour cette figure de l’altérité
maximale et obtuse (le môme, antithèse absolue
du tigre du Cirque qui n’appelait alors que la
fuite) qu’il tenait dans ses bras, à bout de bras.
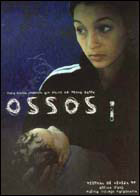 |
|
|
|
Et on aurait pu tout aussi
bien parler du bébé de Nanni Moretti dans Aprile
comme décongestion à teneur politique du trop-plein
de discours écrasant la puissance citoyenne de la parole,
du bébé de Nénette et Boni de
Claire Denis comme rééquilibrage entre le frère
et la sœur de ce qui manque chez l’un et qui étouffe
chez l’autre, du bébé de Sinon oui de
Claire Simon comme appel névrotique à la fiction
et besoin de jouer au prix du mensonge une part reluisante
(la maternité) du théâtre social. Non
pas l’hymne régressif de l’enfant-roi hystérisé
: " Dur, dur d’être un bébé ",
mais la difficile ré-interrogation des valeurs d’un
cadre quel qu’il soit (de vie, de cinéma) : " Dur,
dur d’avoir un bébé ou de savoir quoi en faire ".
Le bébé comme personnage natif du cinéma quand
celui-ci en repasse pour son salut ou sa survie par quelques
questions primordiales facilement oubliées (qu’est-ce
qu’un plan, un personnage, un récit ? Plus généralement,
qu’est-ce que le cinéma, pour reprendre le titre du
livre fondamental d’André Bazin ?). C’est la nativité
du cinéma qui s’en trouve ré-éclairée.
La vie comme le cinéma ne cessent de se justifier :
pourquoi existons-nous ? Pourquoi un autre enfant, pourquoi
un autre film ? Perdurer, c’est justifier sa volonté
de perduration. C’est sans cesse se battre, feinter, monter
au créneau ou au filet (le bébé comme
balle de tennis, comme témoin à faire passer).
|