Avec Qui veut la
peau de Roger Rabbit ?, Zemeckis immergeait
directement ses personnages dans un univers cartoonesque,
et ses cartoons dans le monde (humain ?) du cinéma.
L’interaction entre les deux mondes était explicite,
les cartoons empreints d’humanité et inversement. Pourtant,
ce n’est peut-être pas dans ce film que Zemeckis utilise
le plus les propriétés du corps cartoonesque.
| |
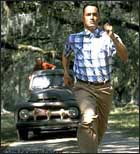 |
|
|
Tous ses films (ou
presque) jouent sur la transformation du corps et sur ses
capacités à défier les lois de l’espace,
du temps et de la matière… Retour vers le futur,
La mort vous va si bien, Forrest Gump, Seul
au monde, Apparences… Le corps atteint les limites
de l’humain, tend vers une dégradation physique intimement
liée à son évolution mentale. Toujours
le personnage lutte contre sa disparition du monde humain
et surtout social, et devient pour cela de moins en moins
humain. Forrest Gump est accepté au sein de la communauté
dès lors où l’on découvre ses capacités
de coureur hors du commun. Afin de posséder la jeunesse
éternelle, les deux sœurs ennemies de La mort vous
va si bien n’hésitent pas (ou à peine) à
" vivre " à l’état de cadavre
en décomposition, se camouflant sous d’épais
maquillages, contraintes de s’entraider, de se soigner l’une
l’autre à contre cœur. Elles défient le temps.
Qu’ont-elles gardé d’humain, mis à part les
apparences dont la couche d’une finesse prête à
craquer à tout moment risque de dévoiler le
véritable corps et l’âme de leurs habitantes.
Le corps dévoile l’âme, mais celle-ci est malheureusement
mal perçue la plupart du temps. Les milliers de gens
qui suivent inlassablement Forrest dans sa course autour du
monde lui prêtent milles intentions, milles revendications,
sans s’intéresser le moins du monde aux véritables
causes et à sa personnalité profonde… La morte
amoureuse d’Apparences prend en otage le corps de la
femme du tueur afin de remonter à la surface des mémoires.
Le jeu impressionnant de Michelle Pfeiffer basé essentiellement
sur les traits de son visage toujours changeant, est soutenu
par un morphing astucieux et très bien rendu avec le
visage de la victime. Un doute s’immisce encore en nous :
quel visage s’approche de nous ? L’un se transforme en
l’autre sous nos yeux, mais comment être sûr de
ce qu’ils nous disent ? Et brusquement le corps mort
devient vivant et réel, palpable il EST à la
place du corps vivant premier, et le corps premier devient
un simple souvenir, une image. Deux temps se télescopent,
Michelle Pfeiffer est à la fois présente dans
ces corps mais elle en est aussi absente, puisque son esprit
et son corps sont partagés entre deux âmes. Et
les deux se dédoublent : le miroir nous renvoie
un reflet absent, pendant qu’un corps disparu prend la place
du corps présent téléporté dans
le passé…
 |
|
|
|
La question du temps
est également et évidemment présente
dans Retour vers le futur : alors que Marty n’existait
pas en tant que corps (ni en tant qu’idée d’ailleurs)
dans les années 50, il résiste au voyage dans
le temps et le voilà matérialisé dans
le passé, incarné et incarnat (Pierre Cardin,
inventeur du rock n’roll), actualisant à la fois le
présent dans le passé et inversement. Disparu
dans le présent, comment peut-il encore être
corporellement présent dans le passé, si l’idée
même qu’il soit un jour créé n’est pas
née ? La question ne se pose pas longtemps puisque
le corps de Marty disparaît peu à peu dans l’invisible.
On ne traverse pas le temps impunément.
Alors que dans le premier opus Marty faisait office de cartoon
en chamboulant le passé par des idées, des musiques,
des accessoires du futur, il est victime dans le second d’un
monde cartoon, où un requin hologramme géant
menace (virtuellement) de le dévorer, des vêtements
auto-séchants, des skate-boards volants, le tout dans
des couleurs acidulées… Cartoon ou jeu vidéo ?
Ne soulevons pas la question. Marty est dans tous les cas
un élément perturbateur comme peut l’être
Roger Rabbit. A l’aise uniquement dans son monde et dans son
temps.
|