AUTEURS,
DES DIFFUSEURS, ET DES ENFANTS QUI PLEURENT
Présenter au public parisien des films inédits et dénichés
dans le monde entier, organiser des rencontres entre leurs
auteurs/producteurs et des distributeurs/diffuseurs français,
tels sont les deux objectifs que se sont donnés les créateurs,
en 1995, des Rencontres internationales de cinéma à Paris.
Accueillie en novembre dernier pour sa septième édition au
Forum des images, la manifestation peut déjà se prévaloir
d’un franc succès selon sa déléguée générale, Marie-Pierre
Macia : depuis leur première édition, les Rencontres
ont “ contribué à permettre l’accès aux salles à 40 %
des films invités non distribués ”.
|
|
| |
 |
|
|
Dans cet esprit, le grand prix du public
est entre autres doté d’une enveloppe de 100 000 Francs
(environ 15 000 Euros) pour le distributeur du film primé,
afin de soutenir sa sortie dans les salles françaises. Cette
année, il est revenu à Promises (2001), œuvre co-réalisée
entre 1997 et 2000 par l’Américain B.Z. Goldberg, la Sud-Africaine
Justine Shapiro et le Mexicain Carlos Bolado. Les auteurs
ont profité d’une période d’accalmie en Israël et en Cisjordanie
pour interroger des enfants israéliens et palestiniens sur
le conflit, et pour organiser leur rencontre. Au cours de
ce film parfois larmoyant, on rit beaucoup lorsqu’un sage
petit Israélien orthodoxe interrompt son discours sur la légitimité
éternelle de la présence juive à Jérusalem, et préfère improviser
un concours de rots avec un gamin palestinien qui vient de
lui lancer son ballon de football dans le dos. On est plus
triste, mais à peine surpris, lorsqu’un enfant des implantations
affirme que tous les bébés palestiniens sont appelés à devenir
des terroristes. On est carrément effrayé, en revanche, lorsque
deux gamins israéliens qui se sont jusque-là montrés au fait
de la situation dans les territoires, tombent des nues en
traversant pour la première fois un barrage militaire et réalisent
que sur leurs terres, les Palestiniens peuvent “ être
si injustement contrôlés ”.
Il faut dire qu’en ces années troubles, Israël n’en finit
pas d’effrayer. Lors des Rencontres internationales, c’est
entre autres ce qu’a montré Khiam (2000), film des
Libanais Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sur la prison
du même nom. Créé en 1985 dans la zone occupée par l’Etat
hébreu au Liban entre 1978 et mai 2000, ce pénitentier a été
utilisé par l’Armée du Liban sud, milice libanaise supplétive
de Tsahal, pour incarcérer les résistants libanais. Au cours
d’entretiens avec d’anciens détenus, parmi lesquels figure
la désormais mythique militante Soha Becharra, on apprend
que la torture est une pratique sioniste courante, et qu’elle
va bien au-delà des “ pressions physiques modérées ”
que le Parlement israélien est d’ailleurs le seul à avoir
jamais légalement intronisées. En fonctionnant par anecdotes
minuscules autour de la privation, où une dent de peigne se
transforme en aiguille à coudre, et un noyau d’olive en la
perle d’un collier, le film forme aussi une belle ode à ce
que peut être une lutte de chaque instant pour la liberté.
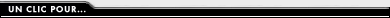 |
|
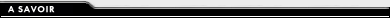 |
|
Notes : Les 7e
Rencontres internationales de cinéma à Paris ont
aussi montré, en avant-première, Le Stade de
Wimbledon de Mathieu Amalric (2001, sortie
prévue en février 2002). Objectif Cinéma reviendra
bientôt sur ce film.
|
|
|