Dans le cadre de ses rendez vous mensuels
consacrés au cinéma d’animation, le Forum des images a présenté
un hommage à Paul Grimault, alors que ressort en ce moment
sur nos écrans son long métrage Le Roi et l’Oiseau
en version restaurée. L’occasion de découvrir les premiers
courts métrages de Grimault avec La Table tournante
de Jacques Demy et d’apprécier ses nombreuses filiations avec
les courts métrages de jeunes animateurs des années 70 produits
par la société Paul Grimault Films.
Point d’orgue de cette soirée : la diffusion du long
métrage des frères Prévert rarement montré Le Petit Klaus
et le grand Klaus pour lequel Paul Grimault a réalisé
les décors.
|
|
| |
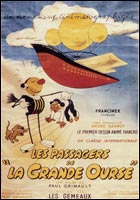 |
|
|
La table tournante
se présente comme une rétrospective de Paul Grimault par lui-même
où se mêlent poésie et humour. On peut y découvrir ses premiers
courts métrages réalisés avec Jean Aurenche comme « La
séance de spiritisme » (1931), viennent ensuite Le
marchand de notes (1942), Les Passagers de la Grande
Ourse (1941) inachevé pour cause de guerre, L’épouvantail (1943)
un des meilleurs courts du cinéaste où s’expriment tout le
burlesque et l’originalité graphique développés dès le début
des années 30 notamment avec l’épouvantail à l’accent irrésistible
et les petits oiseaux chers à Grimault.
La période d’après guerre voit naître La flûte magique (1946), Le
Diamant (1970) et Le chien mélomane (1973)
où les personnages tentent toujours vers un comique de gag
un peu à la Tex Avery mais où s’exprime aussi une recherche
plus poussée sur la trame dramatique (sans délaisser le côté
comique) tout en développant la caractérisation des personnages.
Un travail qui est à l’œuvre dans Le petit soldat et
qui trouvera son aboutissement avec Le Roi et l’oiseau en
1980.
Pour ce qui est des influences, on ne peut pas dire que Paul
Grimault possède des descendants directs mais nombre de jeunes
animateurs qu’il a accueillis dans son studio se sont inspirés
de l’esprit de ses films afin de créer leur propre univers.
Il en va ainsi de Jacques Colombat et son film La tartelette
(1967) dans lequel une petite fille abandonnée se prend à
rêver d’une abondante nourriture faite de gâteaux et de mets
succulents qui se mettent à tomber du ciel et l’écrasent.
Un burlesque tirant sur l’humour noir que l’on retrouve aussi
chez Jean François Laguionie et son court Une bombe par
hasard (1969). Il présente une structure dramatique
bien construite avec un suspense lié à l’explosion de la bombe,
un graphisme épuré qui vient peut être de l’influence de Grimault
et une attention toute particulière pour la musique. Un court
qui confirme tout le talent que Laguionie développera plus
tard avec Le château des singes en 1999.
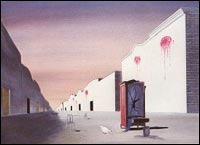 |
|
|
|
Quant au Petit Klaus
et le grand Klaus des frères Prévert commenté par l’assistant
décorateur de Grimault de l’époque, il se présente comme une
sorte de film expérimental où photographies, dessin crayonné
et prises de vues cinématographiques se mêlent. Pierre Prévert
réussit avec habileté à mêler les trois modes narratifs tout
en restant cohérent.
Et malgré la cruauté du conte, le film parvient sans peine
à nous faire rire notamment grâce à la performance des deux
acteurs Maurice Baquet et Roger Blin ainsi qu’aux truculents
dialogues concoctés par Jacques Prévert.
|