Les protections accordées
par l'Etat, au cinéma français, face à
la domination du cinéma américain, sont anciennes.
Elles remontent à 1928 et au décret Herriot
qui limitait à 120 par an, le nombre de films américains
exploités sur le territoire français. Depuis
cette date, les mesures de protection n'ont pas cessé
de s'adapter au marché. La politique des quotas est
donc le centre de la plupart des conflits. La pérennité
de la politique française en matière de culture
cinématographique dépend d'une mobilisation
et d'une vigilance constante de la part des professionnels
de l'industrie du cinéma lors de la négociation
de traités internationaux.
Des mesures sont efficaces pour promouvoir le développement
de la production nationale. Que ce soit le président
de Canal +, de Gaumont, de MK2 ou de Pyramide, ils sont tous
d'accord pour maintenir, non plus des quotas, mais un système
de soutien financé, en grande partie, par la Taxe
Spécial Additionnelle (TSA). Les quotas existent
mais ils concernent aujourd'hui la régulation interne
du marché c'est-à-dire la quote-part des investissements
des chaînes de télévision, qui se définit
comme un pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel, TF1
et France 2, 3% chacune et 9% pour Canal +.
L'Etat américain, afin de défendre et de promouvoir
son industrie, prône le libéralisme économique
dans tous les secteurs d'activités. L'une de ses principales
armes fut le General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). Il avait pour objectif d'ouvrir les économies
sur l'extérieur. Néanmoins, le cinéma
n'est pas, malgré une augmentation du caractère
mercantile des films, uniquement un produit marchand. Cet
enjeu est à la fois culturel, maintien ou non d'une
cinématographie active et plurielle, et économique
: les films américains représentent presque
60% des entrées en France alors que les films français
représentent environs 1% du marché américain.
En 1994, à la demande de la France, les questions culturelles
furent exclues des négociations du GATT (aujourd'hui
remplacé par l'Organisation Mondiale du Commerce).
La mondialisation du commerce entraîne parfois des dérives.
Ce fut le cas avec les Accords Multilatéraux sur
les Investissements (AMI). Les Etats s'engageaient dans
le cadre de ces négociations, à "livrer sans
restriction ni condition, toute richesse nationale, sous quelque
forme d'"actif" qu'elle se présente, à n'importe
quel "investisseur" qui s'en porterait acquéreur"(1).
L'industrie du cinéma français fut l'une des
plus mobilisées par ces négociations, puisqu'elles
signifiaient en cas d'application, une remise en question
de l'existence d'un cinéma français. La riposte
des professionnels du cinéma comprenait une pétition,
une présence constante dans les médias dans
le but de mobiliser les citoyens, et une demande de soutien
acquise de la part de grands noms du cinéma américain
tel que Martin Scorsese et Steven Spielberg. L'AMI, c'était
pour la profession en France, passer "du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes au droit des investisseurs
à disposer des peuples" (2).
Au-delà des querelles internes, le cinéma français
a parlé d'une seule voix pour défendre ses intérêts.
Le manque d'information dans lequel se sont déroulées
ces négociations, avaient et ont de quoi inquiéter
l'ensemble de la filière cinématographique.
Le dossier de l'AMI n'est pas définitivement mis à
l'écart des débats Il sera réouvert d'une
manière ou d'une autre, au compte-gouttes, au sein
des traités de l'OMC, malgré l'échec
de la conférence de Seattle. La vigilance des pouvoirs
publics et des principaux acteurs de l'économie française
mais aussi européenne est devenue un enjeu vital.
Ces traités sont le signe d'une tendance plus générale
des modes de fonctionnement de l'activité économique
française. Les phénomènes de concentration
participent à l'élan de mondialisation du commerce.
Dans ce cadre, où le terme "exception" est remplacé
par "diversité" afin de rallier à la cause française
d'autres pays, comment un pays peut préserver une activité
artistique et la soutenir, si dans le même temps des
négociations ont lieu, dont l'écho ne parvient
pas toujours efficacement aux intéressés ? La
régulation des marchés internationaux reste
néanmoins nécessaire. Mais à quel prix
? Et dans quelles conditions ?
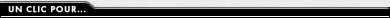 |
|
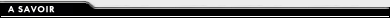 |
|
(1)
Le Monde Diplomatique, décembre
1998, p.21
(2)
Communiqué de la Société des
Réalisateurs de Films, de l’Union des Producteurs
de Films et du syndicat CGT des artistes-interprètes,
le 2 février 1998.
|
|
|