On y pense pas ! Le cinéma
congolais n'existe plus. En mésalliance avec le régime
marxiste de la période post-coloniale, les timides
élans du film congolais des années 1970 se sont
ensuite brisés avec les guerres récurrentes
de la décennie écoulée. Le bradage de
toutes les salles de projection de la capitale aux ''églises
dites de réveil'' a davantage annihilé ses initiatives
et l’a plongé dans un ''sommeil'' profond. En clair,
toutes les salles de projection ont été vendues
aux groupements religieux, dits "fous de Dieu",
qui les utilisent comme lieux de culte permanent. Ce qui n’est
évidemment pas sans conséquence sur des populations
qui, jadis, avaient intégré la culture du cinéma,
et s’y rendaient quotidiennement pour découvrir les
nouveautés du grand écran.
Des entreprises personnelles
ont vite émergé au sein d’une jeunesse confrontée
à l’horripilante réalité du chômage.
Nantis d’un magnétoscope et d’un téléviseur,
ils proposent à vil prix (25 francs CFA / film), une
variété de films dans des quasi étouffoirs.
Journellement, on a à l’affiche : les incontournables
films d’action américain, prisés pour leurs
effets spéciaux ; les variétés musicales
du Congo d’en face (Congo Kinshasa) et les très tenants
films pornos. Et, à la sous-barbe des autorités
compétentes, les tout petits (9 à 12 ans) s’adonnent
à cœur joie au spectacle hard.
 |
|
|
|
Pour le président
de l'Association des cinéastes congolais - organe requinqué
sous la forme d'une Organisation non gouvernementale (Ong),
en quête d'un partenariat avec le gouvernement -, "le
cinéma est une part de l'esprit d'une nation". Cette
opinion n’est visiblement pas partagée par les sensibilités
locales. D’ailleurs, au sein du gouvernement, on ne s’en cache
pas : "La culture est le cadet des soucis du gouvernement",
reconnaissait au cours d’un point de presse, la ministre en
charge de la Culture, Aimée Mambou Gnali. Les conséquences
de cette indifférence envers le septième art,
pourtant source d'immenses possibilités, tant artistiques
et expressives que commerciales et industrielles, "aura
inévitablement des répercussions culturellement
dangereuses sur la société congolaise",
estime Matondo Kubu Ture, sociologue, enseignant à
l’Université Marien Ngouabi, l’unique établissement
d’enseignant supérieur du pays.
Absente des fêtes
continentales et mondiales du film, la cinématographie
congolaise tourne aujourd’hui bel et bien le dos à
son histoire, à sa gloire. Selon Sébastien Kamba,
un des premiers cinéastes du pays, le film congolais
a connu ses "lettres de noblesse" avec Les raisons
d'une alliance (1973), long métrage tiré
du roman d’un écrivain du pays, Jean Malonga. Considéré
comme classique du cinéma africain, il a passé
5 ans au Musée du film de New York. Le Congo était
ainsi un des premiers pays d'Afrique francophone à
mettre à profit cette relation cinéaste-écrivain,
du roman au film, explique-t-il.
| |
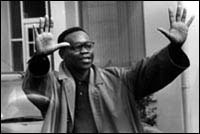 |
|
|
Ont suivi, à partir
des années 1978, La Chapelle, Les lutteurs,
longs métrages de Jean-Michel Tchissoukou ; 'Médecin
tradi-moderne Le réveillon de Noël,
respectivement court-métrage et téléfilm
de Sébastien Kamba, Cinquantenaire de Brazzaville
de Bernard Lounda. Puis bien d'autres films, notamment de
cinéastes de la diaspora, Alain Léandre Baker
avec Un pygmée dans la baignoire et Diogène
à Brazzaville (sur Sony Labou Tansi, écrivain
congolais) ; Camille Mouyeke avec Voyage à Ouaga
; Pierre David Filla : L'homme-mémoire et Matanga.
Des noms comme Alain Nkodia,
Valère Youlou Mingoley (avec Premier bureau, deuxième
bureau, tilt), M. Kimbembé ont un tant soit peu
marqué l'histoire du film africain", se souvient-il.
Des comédiens congolais comme Alain Léandre
Baker jouant dans une séquence de Médecins
de nuit ou Pascal Nzonzi dans Le professionnel
avec Jean-Paul Belmondo et aussi dans Black Mic Mac,
ont signé de leurs empreintes l'histoire du cinéma.
A l’aune de ce passé qui s’éloigne davantage,
les cinéastes congolais ne manquent pas de talent et
l’avenir pourrait s’avérer moins sinistre. Et à
Sébastien Kamba de les égrener : "Il y a des
jeunes formés dans de grandes écoles de cinéma
tels que Charles Nouma, Thérèse Batalamio, Roch
William Ondongo, Bernard Mbounda ou Julio Nzambi, etc., qui
n'attendent que d’être exploité au maximum de
leurs potentialités".
|