Quasiment seules sur le créneau,
les Editions des Cahiers Du Cinéma continuent avec
insistance leur oeuvre de littérarisation du septième
art en publiant, à un rythme soutenu, des scénarios
qui s'y prêtent. Face à 00h00.com et Arte, ils
s'adjugent sans mal la palme de la maquette, prix non-dérisoire
lorsqu'il s'agit du livre, support traditionnellement enclin
au fétichisme de la matière. Remplir les rayons
de sa bibliothèque avec ces petites reliures noires
et blanches, caresser leurs couvertures mates oriente le plaisir
de les posséder vers une expérience résolument
sensitive. Que reste-t-il alors à leur valeur cérébrale ?
| |
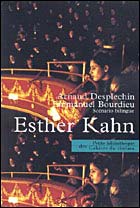 |
|
|
Il n'est pas sûr qu'aucun
scénario édité n'offre, à sa
lecture, une attache transcendentale ou une accroche réflexive.
La forme même de l'objet nuit. C'est une prose hachée,
délibérément brouillonne car ontologiquement
provisoire et vouée à s'incarner. Le scénario
édité ne vaut pas pour lui, mais pour le retour
invariablement tardif du film à sa forme primitive,
écrite. L'immixtion du facteur " cultification
du film " dans la valeur éditoriale d'un
scénario biaise le rapport de l'objet au lecteur :
le public de ce créneau n'est pas d'essence littéraire
mais cinéphile, travesti pour l'occasion en bibliophile.
Son instinct est celui de l'entassement, de la conservation,
de la multiplication, quitte à ne même pas
lire le contenu de l'objet. Il biaise encore, par un évident
ricochet, les choix éditoriaux. Se côtoient
alors, dans la seule " Petite bibliothèque
des Cahiers du cinéma ", des auteurs aussi
différents que David Lynch, Woody Allen, Pedro Almodovar,
Ethan Coen, Nagisa Oshima, Eric Rohmer, Patrice Chéreau,
Sandrine Veysset...
Si Rohmer, Chéreau et Allen
justifient d'emblée leur présence par la prépondérance
filmique et la qualité littéraire habituellement
conférée à leurs scénarios,
d'autres, cinéastes résolument picturaux ou
génériques (Lynch, Coen) la doivent à
leur statut, plus qu'à leur aisance dans le domaine.
Ailleurs, c'est le film qui efface le cinéaste et
son auteur, moins connu, qui en bénéficie :
Ernest Lehman pour La Mort aux trousses... Les dernières
livraisons de la collection intègrent ces pistes.
L'Ester Kahn de Desplechin et Bourdieu est manifestement
littéraire, empreint de formes narratologiques étudiées
(narrateur à l'énonciation très écrite,
dialogues aux multiples échos) lorsque le Dancer
in the Dark de Lars von Trier applique une formule basique,
vouée à l'illustration (dialogues oraux, structure
privilégiant le rythme scénique...). L'un
comme l'autre présentent l'avantage d'être
bilingues, offrant sur les pages de gauche la version anglaise,
et sur les pages de droite les fragments correspondants
dans la version française. La disposition en vis-à-vis
n'a d'enseignement que linguistique, même s'il est
toujours agréable de détenir les mots prononcés
à l'image (si le scénario d'Esther Kahn
a été écrit en français, il
a ensuite été traduit pour être tourné
en langue anglaise...). En revanche, la sécheresse
éditoriale déçoit par le peu d'annexes
mises à disposition. Exceptées les habituelles
fiches techniques et filmographies, chacun des ouvrages
présente uniquement un court un texte introductif.
Si Lars von Trier signe celui concernant Dancer in the
Dark, sorte de note d'intention, c'est un simple avant-propos
de l'éditeur qui raconte la genèse d'Esther
Kahn et son adaptation d'une nouvelle d'Arthur Symons...
La présence inévitable des génériques
comme la reprographie, en couverture, d'images du film confirme
sa supériorité sur l'embryon littéraire,
qui n'a de légitimité et d'exposition qu'à
travers le prisme de son descendant imagé. A quand
l'expansion du scénario publié en fac-similé,
ou même des écrivains adoptant cette forme
pour ne jamais être illustré par une caméra ?
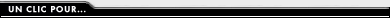 |
|
|