Jolie entrée en matière que ce titre :
« L’écran amoureux ». Joli et mystérieux : l’écran
amoureux est un terme bien ambigu. L’écran pourrait être amoureux
de l’image qui y est projetée : sans aucun doute, car sans
l’image, l’écran n’aurait plus sa raison d’être. Serait-il alors
amoureux des spectateurs qui le regardent sans se lasser ?
Non, le numéro 107 de la
revue Cinémaction s’attache simplement au sujet principal
qu’aborde le cinéma : l’amour. Mais pas simplement le
bel amour, et même pas du tout. Ainsi, l’un des pans les plus
évidents du cinéma est à peine évoqué : la comédie romantique.
Cinémaction n’aborde ni le film de teenager
ni la comédie dite du remariage. Le thème principal en serait
plutôt le drame, l’amour dans ce qu’il a de plus complexe
et de plus noir.
L’amour au cinéma est étudié
par le biais de cinq thèmes : amour et société, l’amour
et la famille, la fin des interdits, passion et illusion et
l’amour et la mort.
Si Cinémaction est
une revue d’esthétique du cinéma, elle en aborde également
l’aspect sociologique : comment celui-ci véhicule les valeurs
en vigueur de nos sociétés, ou au contraire, comment tente-t-il
d’offrir une alternative à celles-ci, comment réussit-il à
contourner les règles morales, comment représente-t-il les
tabous, les interdits.
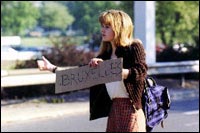 |
|
|
|
Tabou et interdit sont-ils
d’ailleurs des termes équivalents ? La frontière paraît
parfois floue en ce qui concerne l’amour et les questionnements
qui en résultent : Les différences sociales : un
obstacle insurmontable ? se demande Gaëlle Bosser en
étudiant deux films de Billy Wilder (Sabrina et La
garçonnière), thème que l’on pourrait aisément élargir
à l’ensemble de l’œuvre du réalisateur. Raphaëlle Costa de
Beauregard explore quant à elle « l’illégalité amoureuse »
au travers de Lolita de Kubrick, Simple Men
de Hal Hartley et C’est la tangente que je préfère
de Charlotte Silvera. Car l’éthique rattrape parfois la loi
et inversement : rien n’interdit à une secrétaire de
fréquenter son patron, exceptée la bonne morale.
|