La sortie de l’ouvrage Gilles Deleuze,
cinéma et philosophie, écrit par Paola Marrati, est l’occasion
de revenir sur les écrits du grand théoricien de philosophie
et de cinéma qu’était Gilles Deleuze.
Son œuvre, à la fois conséquente et complexe dans son approche
éthique et philosophique du cinéma, nécessitait une synthèse,
une approche plus globalisante, permettant aux plus novices
d’entre nous de se réapproprier ses écrits particulièrement
denses, mais indiscutablement essentiels à l’analyse réflexive
du septième art. Ce qu’avait amorcé André Bazin en son temps,
Gilles Deleuze l’a poursuivi et, tout en collant au plus près
des films qu’ils citent abondamment, il s’était attaché à
nourrir un idéal du genre, glorifiant le cinéma d’être capable
« de rendre visible » et non pas seulement de « reproduire
le visible ». Ses deux ouvrages de références les plus
régulièrement cités sont très certainement L’Image temps
et L’Image mouvement, aux éditions Gallimard, et rendent
compte de cet attachement à maintenir comme indissociables
le temps et le mouvement dans le cinéma.
Mais l’intérêt de cet essai de Marrati n’est certainement
pas de reprendre à son avantage les théories de Deleuze. Avant
toute chose, l’auteur s’attache à replacer le théoricien dans
un contexte idéologique, comparant ses principales idées aux
autres grands intellectuels du cinéma. Ainsi, on apprend que
Bergson, même s’il représentait une référence indiscutable
pour Gilles Deleuze, est parfois remis en question dans sa
réflexion sur la narration, le temps et l’espace au cinéma.
Considérant que le cinéma et la philosophie appartiennent
à un tout, à une dynamique générale, Paola Marrati se questionne
justement sur le sens, la constitution et la définition de
ce tout, sur la place de l’homme, en tant qu’individu par
rapport à la sublimation et l’image-cliché qui constitue l’essence
même de l’art visuel. D’où naît cette image-cliché à l’origine
même du langage cinématographique ? Paola Marrati, via
les écrits de Deleuze, n’a pas la prétention de vouloir répondre
à cette question, mais témoigne d’un souci idéologique dans
sa conception de « l’image vivante » et qui, constamment
replacé dans un contexte historique grave comme ce fut le
cas lors de la seconde guerre mondiale, influe sur notre foi
dans le cinéma, puisqu’en révélant la manipulation visuelle,
l’art cinématographique est rendu à ses propres limites idéologiques.
Toutes ces questions fort passionnantes au demeurant trouvent
une résonance particulière lorsque l’on est capable de considérer
avec acuité le danger que représente aujourd’hui le pouvoir
de l’image-cliché de la télévision et du cinéma commercial
sur un public peu averti. De ce fait, cet ouvrage, qui cherche
paradoxalement à s’élever au-delà de la simple question du
cinéma et de sa représentation, nous emmène vers d’autres
sujets bien plus vastes encore et pour lesquels il est bien
difficile de trouver une réponse satisfaisante. Ainsi cet
essai se conclut non pas sur « qu’est-ce que le cinéma ? »,
en référence à l’ouvrage d’André Bazin, mais « qu’est-ce
que la philosophie ? ». Libre à chacun d’y concevoir
un lien de cause à effet ou de trouver la question vaine.
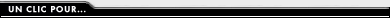 |
|
Titre : Gilles Deleuze, cinéma et philosophie
Auteur : Paola
Marrati
Editeur : PUF
|
|
|