Il est vain et grotesque
de vouloir mordicus scinder le cinéma en deux gargantuesques
catégories. L’automne dernier, Leconte a bien failli
être bon. Le polémiste malgré lui, victime
d’un bug de fax, en a eu pour ses frais. Sa diatribe, ou plutôt
son désarroi face à une supposée haine
des critiques envers la production locale, a justement prêté
le flan aux critiques. Et braqué les projecteurs sur
un manichéisme rampant et vomitif bien de chez nous.
Il y aurait donc les "gentils films" français
(même si réalisés aux States) et les méchants
films - évidemment américains, subodore-t-on
dans notre barbe. Cette analyse binaire est tellement puante
qu’elle en refoule du bec. Il est donc grand temps de lui
faire mâcher un (Hollywood) chewing gum de bon aloi.
Et de désinfecter ces idées puériles
et putrides par trop en odeur de sainteté.
Le septième art,
comme son nom l’indique de manière intrinsèque,
est... un art. Il ne va donc pas s’embarrasser, parce que
des réalisateurs médiocres, aigri ou pissant
le pognon crient à leur propre trépas, de questions
métaphysiques comme "De la binarité de
ma fonction". On ne trouvera pas les ingrédients
d’un bon film dans les fiches cuisine de Elle. Mais
dans ses attributs scénaristiques et émotionnels.
Dans ses aptitudes à transcender le quotidien. C’est
de cette ossature quasi-divine que pousse l’anatomie du cinéma-septième
art.
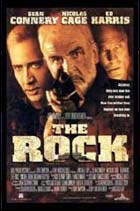 |
|
|
|
À cet égard,
et à bien des antipodes du débat stérile
Exception culturelle versus Ricains, il est deux objets filmiques
qui subliment et cette schizophrénie désopilante
et notre quotidien. Deux frères ennemis, si l’on en
croit quelques chirurgiens cinématographiques adeptes
du bistouri et autres instruments de torture employés
pour retirer toute preuve éventuelle de gémellité.
Speed de Jan de Bont et Ressources humaines
de Laurent Cantet sont deux skuds qui viennent anéantir
cette foutue gueguerre de gosses rivés devant leur
calculette Play School. Ces deux frangins ennemis-là
(en apparence) prouvent que le cinéma, quand il se
met à bander sec, défonce toutes les frontières
idéologiques.
Speed, poids lourd
du box office de l’été 94, est un édifice
phallique du film d’action. Il en explose les codes, et enterre
ses prédécesseurs. On a difficilement fait mieux
depuis excepté peut-être The Rock de Mickael
Bay. Quant à Ressources humaines, chef d’œuvre
d’engagement politique aguerri, il vidange bien des moteurs
syndicalistes censés, dans la vraie vie, embellir le
sort des ouvriers. Frères jumeaux, Speed et
Ressources humaines arborent les mêmes bleus
de travail, ceux qui, portés avec élégance
et éclat, subliment la réalité, celle-là
même qui ne cesse de pactiser avec la satanique fatalité.
La vie de beaucoup (trop) de nos congénères,
quoi!. Par le truchement cinglant de son hyperbolisme, Speed
dévale tout schuss sur les pistes de l’invraisemblable
et de l’irrationnel. Aucun bus, même chargé de
kérosène, ne pourrait effectuer le centième
de que l’engin du film réalise en deux heures. Aucun.
Idem, il semble difficile d’imaginer dans le monde du travail
en entreprise le retournement de situation opéré
par le jeune héros-apprenti DRH du dernier Cantet.
Qui, aujourd’hui, serait assez membré pour se retourner
contre son propre employeur qui, à défaut de
carburer au kérosène, marche au sans sentiments.
Qui?
A leur manière bien
particulière, Speed et Ressources humaines
raillent, tels des Monsieur Jourdain - donc sans le savoir,
le manichéïsme qui s’est emparé des économistes
de la chose cinématographique. Le septième art
remplit là sa fonction d’agent matrimonial et fourre
dans le même pieux conjugual deux (chefs d’) œuvres
qui font la nique à un clivage qui raye trop le parquet.
Et démontre que, Américains, Français
ou Asiatiques, il n’y a que de bons ou de mauvais films.
|
