Alchimiste cinématographique
peu banal puisqu'il transforme l'or en pierre, Robert From
Marseille présente son nouvel opus bipartite, mi-socialo
mi-bobos : La Ville est tranquille. Il y mixe comme
un cinglé chargé aux somnifères quelques
méga-hits de ces cinq dernières années
: Fight Club (la globalisation, c'est méchant),
Trainspotting (la fille d'Ascaride shootée à
mort), Taxi (Darroussin et son engin) et Magnolia
(chassé croisé nimbé de Janis Joplin
déifiée). Un désert avec des mirages
mal négociés terminant par des tonneaux. Pis,
le disque est rayé et le fabricant ne veut pas le reprendre
car, reconnaît-il désemparé, "je n'ai
aucune solution". Fichtre, la société de
subventions a encore frappé. Saloperie d'arnaque !
|
| |
 |
|
|
Enième variation
faisandée, zélée et sans ailes, sur la
carlingue de la mondialisation, d'ores et déjà
de sinistre mémoire, le nouveau manifeste en papier
craft(berk) de Bob Guédiguian arbore un militantisme
souterrain en robe de chambre et savates à carreaux.
Oripeaux de fortune et de circonstance pour ce relevé
de compte de faits fringué par Emmaüs - l'habit
ne fait pas le moine, faut-il le rappeler ? - prêt à
passer, en outre, au service gérontologie tant son
auteur, depuis des années, s'évertue à
bégayer, à baragouiner comme on l'cause dans
l'Ouest. La Ville est tranquille prend toute sa sève,
anachronique, dans une bile en état d’ébriété
qu'il aurait été peut-être judicieux de
tourner sept fois dans sa narration avant de nous la cracher
en pleine face. Heureusement, la blanche colombe n'est guère
atteinte par cette prose andropausée frite et moult
fois ressassée. Sang scénaristique contaminé
et sans contamination, tel est le lot de ce pétard
coagulant. Car, au nom d'un laïus déplumé
de toutes ses cordes vocales, de quelque vertu soi disant
nitrique, le réalisateur impuissant - il le crie sur
tous les toits - de Marius et Jeannette enjoint, clonant
à nouveau son rituel dogme de l'échange, les
spectateurs, réceptacles des mycoses dont la planète
Marseille est victime et qui sont ici décrites par
le menu, à parler, à se parler, à en
parler. "J'expose, vous disposez", en somme.
Problème : la machine bien rodée le temps d'une
fraction de revendication via Marius... en 98 se retrouve
à présent encrassée, encerclée,
notamment, par les stéréotypes obèses
qu'elle engendre, rendue à gigoter du pouce en quête
d'idées rénovatrices, d'une brèche éminemment
frictionnelle. Guédiguian, dans son stop et encore
mal poncé, fait écho à ces vieux communistes
sanglés à leur projet sociétal sans discontinuité
ni actualisation aucunes, inconditionnel qui plus est des
pages saumon du Figaro. A l'adresse de l'homologue hexagonal
de Ken Loach, lui aussi fossilisé, hanté par
de vieux démons syndicalistes qui, à quelques
cas particuliers près, ont bien du mal à embrasser
la sphère cinématographique, on ne peut que
stigmatiser, simultanément regretter, l’anesthésie
générale que subissent les personnages de ce
contestataire aphone. Certes, il y a bien dans La Ville...
comme une urbanisation des corps, des décors et des
fluides qui les unissent. La durée élastique
de l'ensemble (2h12), presque chorégraphié dans
ses rares prises de risque, n'y est certainement pas étrangère.
Or, ladite cité finit vite par s'endormir sur les lauriers
d'un créateur en panne, en pâmoison affamée
devant le spectacle d'un monde à bien des égards
privé de lumière. Une Cannebière sans
houblon cocktailisée jusqu'au comas à la commisération.
A l'inertie lendemain de biture. L'époque qu'opère
maladroitement le cinéaste n'est pas épique.
Je ne veux plus m'y frotter car elle me pique. Je ne veux
plus me piquer d'elle parce qu'elle fane à perte de
vue. Pétales dans la semoule.
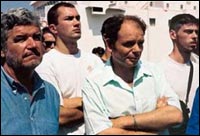 |
|
|
|
La citoyenneté, quel
que soit son visage - engagement politique ou perforation
artistique -, se doit d'ôter les verrues, de neutraliser
les escarres, mouches à merde. Mais La Ville...
sommeille, diégétiquement meurtrie par ce que
son premier magistrat de fortune combat : l'inactivité.
La livraison 01 de Guédiguian se casse les épaules
contre, et c'est un comble, des portes ouvertes. On imagine
aisément le père de famille frustré,
découragé par les agissements malséants
et irresponsables de ses petites têtes blondes adorées.
On le devine se contenant puis, dans une rage brûlée
au millième degré, passant ses nerfs sur les
chérubins. La scène désastreuse du suicide
dans la moite Ville.... "Le cinéma c’est
pas le lieu du pére ", pensait Serge Daney. Et
d'ajouter : " A condition qu’il n’y soit pas ". Bob
joue au père omniprésent. Son hyperbolisme dramatique,
attribut castrateur du père, m'agace et m'agresse.
Me concernant, mon père n'est plus. Je ne veux pas
que son fantôme vienne m'emmerder et me sermonner dans
mes lieux de perdition. Pas au cinéma...de grâce
!
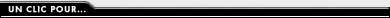 |
|
|
