En 1965, l'immense Bob déversait sur le monde les vers
enflammés de sa chanson The Times They Are A-Changin.
Perché sur son volcan et sur les talons de ses bottines
de cuir, les yeux cachés derrière ses lunettes
noires comme pour se protéger de la chaleur de ses
mots en fusion, le prophète-dandy annonçait
l'avènement d'une ère nouvelle. L'inéluctable
roue du changement allait tout renverser sur son passage,
la révolution des mentalités était en
marche et allait faire tomber tous les murs. L'heure du jugement
dernier avait sonné et personne n'était à
labri : les écrivains, les critiques, les sénateurs,
les pères et les mères allaient enfin répondre
de leurs méfaits. Les perdants seraient les gagnants,
les derniers les premiers, et de nouvelles routes prendraient
la place d'anciennes voies pavées de conventions obsolètes.
Toute une génération, avide de faire évoluer
une société prise dans la glace de ses propres
traditions, se reconnaissait dans l'incandescence clairvoyante
de ce sermon biblique.
|
|
| |
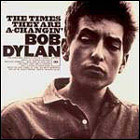 |
|
|
Trente-cinq ans plus tard, le poète
du folk-rock signe la bande originale du film Wonderboys
de Curtis Hanson et, comme le souligne le titre d'une des
chansons qui la composent (Things Have Changed), les
choses ont bel et bien évolué. Mais, ironiquement,
pas comme le laissait entendre son magistral brûlot
du milieu des années soixante, car celui par qui soufflait
le vent de la révolte s'est produit via satellite devant
le tout-Hollywood embagousé lors de la dernière
cérémonie des Oscars, clinquante célébration
annuelle de l'argent roi. O tristesse, ô consternation,
c'est à la miss T-shirt mouillé des plages californiennes
et symbole de la pop sous cellophane estampillée MTV,
j'ai nommé Jennifer Lopez, qu'est revenue la tâche
de présenter celui qu'on ne présente plus. Le
dylanophile moyen pourra toujours se consoler en se disant
que les textes des chansons de la " bomba latina "
ne seront jamais, à la différence de ceux du
maître, comparés à la poésie de
Shakespeare ou de Lord Byron, espérons-le tout du moins.
Après cette pathétique introduction, l'Artiste
est apparu à l'écran et s'est lancé dans
les premiers accords de sa dernière création,
sans autre forme de préambule. Il n'a pas daigné,
à la manière d'un John Lennon au Royal Albert
Hall, demandé au public de secouer ses bijoux en rythme.
Dylan n'aura au moins pas eu à assister à l'affligeant
spectacle offert par un parterre à l'ego surdimensionné
qui, durant ce mini-concert formaté, a sombré,
suivant les cas, dans une gestuelle insignifiante héritée
d'Histrion ou dans un sommeil salvateur dans l'attente d'une
prochaine coupure publicitaire. La sémillante Goldie
Hawn, confondant apparemment Pat Garrett et Billy the Kid
et La Fièvre du samedi soir, a choisi la stratégie
dite du " trémoussement intense ", très
prisée aux heures des pantalons en velours orange et
des chemises à jabot. Son agitation cadencée
présentait tous les symptômes du réflexe
conditionné et probablement aurait-elle persévéré
dans la même voie si Ricky Martin était venu
bouter Dylan hors de l'écran. Danny de Vito a préféré
considérer la chose avec une indifférence boursouflée
et graisseuse. Esquissant une sinistre imitation du légendaire
" Boss " de la non moins légendaire série
Shériff fais-moi peur (notez la richesse de
la référence), il s'est lancé avec délectation
dans l'engloutissement méthodique d'une innocente carotte(
!). Attitude méprisante que Steve Martin na pas manqué
de railler avec l'esprit qui le caractérise. Seul Ed
Harris a semblé être fasciné par la performance,
et surtout a-t-on pu lire dans le regard bleuté du
néo-stalingradien tout le respect qu'il semble éprouver
pour celui qui a su donner une littérature au rock.
Maigre bilan.
 |
|
|
|
Que penser de ce carnage médiatique
planétaire ? Faut-il considérer que Dylan a
laissé ses convictions au vestiaire pour devenir un
businessman glacial s'adonnant au culte du veau dor ? Il serait
facile de se hâter vers une telle conclusion en l'écoutant
remercier la Columbia, la Paramount et les membres de l'académie
" pour leur audace ". L'apparition de Dylan aux
Oscars apparaît pourtant comme l'énième
pirouette d'un provocateur né qui a fait de l'art du
contre-pied une philosophie. Quand on a voulu l'enfermer dans
une image de chanteur engagé, il s'est orienté
vers la ballade introspective ou le blues déjanté.
Quand on a voulu le cantonner au rôle de leader spirituel
du folk acoustique traditionnel, il a électrifié
sa musique. Quand on lui a demandé s'il se considérait
comme un écrivain ou un artiste de folk-rock, il a
répondu qu'il n'avait rien à voir avec le folk-rock.
Dylan s'est toujours génialement ingénié
à fuir tout drapeau et toute étiquette, a toujours
refusé de se laisser coller des pancartes dans le dos.
Il a toujours clamé haut et fort son désir d'indépendance
à grands coups d'aphorismes désormais cultes
tels que " on n'a pas besoin de présentateur météo
pour savoir d'où vient le vent " ou " ne
suivez pas les leaders, regardez les parcmètres ".
Sa présence aux Academy Awards s'inscrit dans la grande
tradition des pieds de nez dylaniens. En évoquant Things
Have Changed, il a affirmé que cette chanson ne
fermait pas les yeux sur la réalité de la nature
humaine. Toujours présent là où on l'attend
le moins, Dylan est l'illustre représentant de cette
espèce qui se définit par sa glissante capacité
à échapper à toute définition,
de cet oxymore bipède qui se nourrit de ses contradictions.
Sa musique, son comportement, ses textes nous rappellent constamment
que si le ridicule ne tue pas, l'attendu, le prévisible,
le planifié sont eux synonymes de mort certaine. Rien
que pour cela, il ne méritait pas un Oscar.
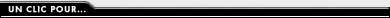 |
|
|
