Sorti de la salle de ciné,
toujours rien compris au film, pas de panique, cette chronique
vous refait le film. Les producteurs retiennent les spectateurs,
les personnages se demandent encore pourquoi ils ont accepté
ce rôle. Qu’est ce qui se passe dans leur tête, les dialogues
qu’ils auraient aimé dire, nous vous révélons la face cachée
des scénarios. On se refait le film, une critique inventive
de vos films préférés, ou pas… parce que le cinéma n’est pas
un art sacré.
|
|
| |
 |
|
|
Mika Kaurismäki, le réalisateur
de Moro no Brasil, était en train de devenir dingue
dans sa Finlande natale. Le Père Noël, les rênes et son traîneau,
ça commençait à lui pourrir la vie. Alors il y a 12 ans, il
a tourné la barre à 180 degrés, et franchi le cercle polaire.
Direction : Brésil. Entre l’équateur et le tropique sud,
c’est beaucoup plus son style à Mika. « J’ai échangé
mes disques de Deep Purple pour des vinyles de samba quand
j’avais 5 ans, est-ce que ça ne ressemble pas à un coup de
foudre pour le Brésil ? » Un tel coup de cœur
que Mika peut s’exclamer en brésilien dans le texte :
« Moro no Brasil ! ». Je vis au Brésil.
Il a garé sa jeep et un mec est venu lui glisser dans l’oreille.
« Tu voudrais pas tourner un genre de film sur la
musique brésilienne, ses racines dans l’Intérieur, le Sertao.
Tu nous dirais comment les Brésiliens font perdurer leurs
musiques traditionnelles depuis le cœur du pays jusqu’aux
plus grandes villes. »
Kaurismäki avait trouvé son sujet. Il allait faire 4000 kilomètres
entre campagne et ville, s’enfoncer dans les villages de l’Intérieur,
entre le Piaui et le Pernambouc, promener sa caméra entre
les jupes des filles en plein carnaval de Rio. Bon, il fallait
un peu de méthode. C’est bien gentil la musique brésilienne
comme sujet de film, mais d’ici à ce que ça ressemble qu’à
un grand clip avec des trompettes et des roulements de tambour,
on avait de quoi se planter. Alors Mika a tourné un grand
road movie, filmé ses rencontres avec des chanteurs locaux
dans des bouges et des favelas. Un film documentaire, un documentaire
filmé, un film bien documenté. Il a regardé les stars brésiliennes
gratter la guitare et souffler dans les cuivres. Et voilà
qu’on s’offre un grand voyage de musiciens en musiciens, de
groupe en groupe suivant, le tout dans un rythme de samba.
« Est ce que c’est pas convivial cette musique, toutes
ces fillettes qui dandinent leur ventre, ces vieux indiens
avec des plumes partout. » Il a filmé les indiens
Mika, ceux qui transmettent la musique de leurs origines.
 |
|
|
|
Et ils n’ont pas eu besoin
de traîner à l’école pour imaginer des paroles toutes déglinguées.
Ils délirent avec les mots, dans leur samba incroyable. « Dès
que tu as perdu un amour, commences-en un autre »,
raconte un vieil indien dans sa chanson. « Comme ça
au moins, tu pleures moins longtemps. » Les foules
se déchaînent au pied des taudis dans les favelas. On oublie
la misère et les égouts à ciel ouvert pour chanter. Ça chante
beaucoup dans Moro no Brasil. Ça chante toutes les
heures du jour, et à tout moment toutes les heures. Pas le
temps de faire la pause.
Les vieux chanteurs sont tombés dedans à la naissance. « Tu
suçais encore ta tétine que tu chantais déjà, vieux frère.
Et tu l’as encore ta tétine, elle est toujours dans ta poche.
On est des nostalgiques, nous les musiciens de l’Intérieur,
on n’a pas beaucoup grandi depuis qu’on sait chanter. »
Des vrais gamins ces brésiliens, impossible de leur parler
cinq minutes, faut toujours qu’ils se tortillent, qu’ils sifflotent.
Pour sûr, ils ne sont pas prêts d’oublier leurs racines. Et
en sortant de ce film, ça bourdonne longtemps dans les oreilles.
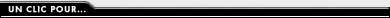 |
|
|
