SYNOPSIS : Béatrice
(prononcez " béatritché ",
puisque que nous avons affaire à la vénéneuse
italienne Asia Argento), héroïne éponyme
du film, oiseau de nuit et troisième terme d'un trio
de malfrats londoniens - avec ses deux compères Paul
et Bruno, interprétés par Rupert Everett et Jonathan
Rhys-Meyers, l'un dandy déjanté et l'autre jeune
blondinet hystérique -, Béatrice, donc, décide
subitement de se ranger des voitures. Le déclic lui vient
d'une rencontre coup de foudre avec un professeur à la
double vie - instituteur le jour et DJ dans un hôpital
(!) pendant la nuit -, interprété par Jarred Harris. |
|
....................................................................
|
UN SINGE EN GALERE
Après le grand succès public
du Facteur (Il Postino), le nom de Michael Radford
reparaît sur les écrans au générique
de B. Monkey. Dans une hypothétique classification
des genres cinématographiques, B. Monkey occuperait
la case hybride des " films de gangsters romantiques ".
Le film prétend en effet (mais une chose est de prétendre,
une autre de tenir ses promesses) concilier deux genres
a priori hétérogènes : le film noir
contemporain et la comédie romantique ; deux styles
tout aussi différents : un montage ultra-rapide
d'images sophistiquées et de longs plans jazzy et langoureux ;
des personnages au profil opposé : trois marginaux
déjantés et un représentant de la middle
class anglaise ; etc., etc., etc… En bref, il s'agit
de conserver les acquis (financiers ?) du Facteur
et de greffer par-dessus un emballage de " genre ".
Opération ratée
Cet improbable mélange, au lieu du
cocktail explosif prévu, s'avère être
une indigeste mixture. Pour réussir la gageure susdite,
il eut fallu un scénario d'un tout autre calibre -
entendez : d'un calibre bien supérieur - ;
une mise en scène à la hauteur ; une direction
d'acteurs impeccable. Or, le scénario accumule les
invraisemblances narratives jusqu'à frôler le
ridicule : on n'avait, par exemple, pas vu de coup de
foudre si peu crédible au cinéma depuis longtemps.
Radford, au lieu d'étendre le registre limité
du ressort lacrymal, revient à son application la plus
sommaire cinq minutes à peine après le début
du film - cinq minutes " clipesques "
qui expédient la tâche de planter le personnage
de B. Monkey. La mise en scène de Radford, ensuite,
oscille entre les deux extrêmes du langoureux et de
l'électrique et tente par à coups de les réunir :
un séjour romantique à Paris, passé dans
un hôtel crasseux ; une soirée bien arrosée,
conclue par la nausée de Béatrice (on a droit
au détail du dîner !). Le personnage semble
aussi rétif à digérer son repas, que
l'actrice à interpréter son rôle.
 |
|
|
|
L'échec de B. Monkey, à
la mesure de l'attente que suscitent désormais ses
apparitions, c'est d'abord et surtout l'échec d'Asia
Argento. On ne lui jettera pas la pierre : elle ne pouvait
à elle seule sauver le film du naufrage. Mais, si Radford
avait eu la preuve par son précédent film que
faire vibrer la corde sensible chez le spectateur était
un gage de succès, son obstination à faire de
la fibre romantique la vérité profonde des êtres
(et de ses personnages, leur penchant pour le " mal ",
l'illégal, l'anormal,… n'étant que de surface
et cachant mal une foncière et angélique innocence)
lui fait rater le charme singulier de l'actrice italienne.
Le réalisateur réduit le genre " noir "
à un exercice de style et peine à faire cracher
à Argento le venin qu'elle distille avec art chez Ferrara
ou lorsqu'elle se met elle-même en scène (cf.
le bon Scarlett Diva). Heureusement, ou malheureusement,
pour le spectateur, qui sort indemne de la séance.
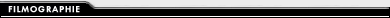 |
|
Titre : B.
Monkey
Réalisation
: Michael Radford
Interprètes
: Ian Hart, Jared Harris, Asia Argento, Rupert Everett,
Jonathan Rhys-Meyers, Tim Woodward, Clare Higgins,
Bryan Pringle, Michael Carlin
Scénario
: Michael Thomas, Choe King, Michael Radford.
Photographie
: Ashley Rowe
Musique
: Luis Bacalov
Production
: Miramax Films, U.S.A Scala Productions, Grande-Bretagne
Distribution
: Bac Films
|
|
|