L'ŒIL SCHIZOPHRENE
Premier film inuit de l'Histoire
du septième art, Atanarjuat, la légende
de l'homme rapide fera date autant pour son statut pionnier
que pour sa valeur intrinsèque. En revendiquant son
identité, il invalide toute posture documentaire
et s'inscrit aux antipodes de Nanouk. Robert Flaherty
posait, en 1920, un regard occidental foncièrement
ethnologique sur le mode de vie des esquimaux. Le caractère
informatif de l'œuvre naissait d'un objectif didactique,
d'un œil intéressé. Quatre-vingts années
auront été nécessaires pour qu'un projet
porté, développé et conçu par
des autochtones ne voit le jour dans le Grand Nord canadien.
Un projet qui refuse de laisser voir et décide de
montrer.
C'est donc dans le mortier de la fiction
que sont scellées les bases d'Atanarjuat, mais
une fiction mettant en scène la sève d'une communauté.
Le mal y règne depuis plus de vingt ans, vampirisant
un à un les représentants mâles d'une
lignée. Oki, vantard insupportable et violent est de
ceux-là. Ses cousins, et parmi eux Atanarjuat, sont
garants du bien. Mais lorsque ce dernier gagne, à la
force du poing, la main d'Atuat qu'il convoitait, Oki jure
de se venger. Sa vile promesse défiera le temps. En
faisant naître, vivre puis mourir son récit au
sein d'une identité culturelle, Zacharias Kunuk ne
peut esquiver son folklore. La vie de clan, les traditions
chamaniques et autres coutumes de chasse y sont abordées
sans insistance ni déconstruction, car inhérentes
au savoir de l'énonciation. Si le film n'épouse
jamais une trajectoire documentarisante, notre réception
lui imprime en revanche un sceau de découverte que
son caractère inédit amplifie. Le quotidien
des personnages, si éloigné du nôtre qu'il
interpelle sans être décrit avec précision
paraît naturellement écartelé entre valeurs
universelles et héritage occulte. Ce décollement
est avant tout dû au traitement de l'œuvre, qui
raconte une légende sans établir de pacte de
lecture. Les oripeaux animistes n'y sont jamais livrés
au merveilleux... Un regard sans surplomb dans lequel le film
s'incarne.
 |
|
|
|
L'existence filmique
du peuple inuit donne lieu à une aberration temporelle.
Cette intrusion de la modernité dans un espace résolument
attaché à son évolution propre, en
marge et naturante, distille une figure de l'écart
qui metaphorise sa position ontologiquement biaisée.
Kunuk multiplie ainsi les fragments anachroniques : on se
dispute l'acquisition d'une femme lors d'un rite barbare,
duel à coups de poings, mais l'adultère se
révèle être un tracas universel. De
même, les parades amoureuses sont singulièrement
médiévales, mais le langage sexuel est un
délicieux espéranto. Les corps sont, dehors,
désexualisés par d'épaisses peaux de
bêtes qui effacent toutes formes, seules à
même de protéger du froid intense qui règne
sur la banquise. Mais les peaux nues et les positions ne
nous sont pas inconnues, pas plus que les cris de jouissance
ne nécessitent de sous-titrage.
C'est un regard externe qui suscite
et impose ces instances de décollement, moins contenues
par le cœur de l'œuvre que par sa périphérie.
L'essence du film, lui, se recueille dans le creuset du mythe.
Son scénario, adapté d'un conte oral millénaire,
a valeur morale. Privilégier l'intérêt
du groupe aux désirs personnels semble être la
leçon dispensée aux personnages de ce récit
initiatique. Sur le mode allégorique de tout enseignement
sacré, Kunuk illustre 2h40 durant un destin exemplaire
mais encore un portrait de groupe, sensément empreint
de manichéisme. Les dialectiques (bien-mal, épreuve-épanouissement...)
s'habillent pourtant de détails plus opaques et moins
sclérosés, sombres entités circulantes.
La généalogie incarne cette incessante transmission
: malédictions, statuts sociaux ou colliers ancestraux
voyagent de main en main et d'une génération
à l'autre. Bientôt, les identités épousent
le même chemin au gré d'une étrange croyance
en la réincarnation familiale : une grand-mère
y voit son père défunt investir le corps de
son petit-fils. De sorte que tout communique et, finalement,
communie. Les saisons se succèdent et avec elles le
mode de vie de ces nomades. Lorsque la lumière renaît,
la neige disparaît et les igloos deviennent des tentes,
les caribous des poissons. Symbiose entre hommes et éléments.
| |
 |
|
|
Cette peinture esquimaude cultive finalement le paradoxe.
Réclamant une vision exclusivement narrative puis
offrant innocemment une meute d'informations, elle se pare
d'un grain de pellicule à vocation réalisante.
Mais, bien que tourné en Bétacam numérique,
Atanarjuat distancie sa valeur vériste par
une incessante oscillation entre représentation et
représenté : les jeux artificiels et parfois
forcés des comédiens amateurs revendiquent
le simulacre et rejoignent en ce sens le générique
final où le champ s'élargit tant qu'il cadre
bientôt la caméra. Énième décollement,
élégamment mensonger (dédoublement
de l'objectif) qui ponctue tel un emblème ce film
schizophrène.
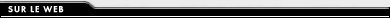 |
|
|
 |
|
Titre : Atanarjuat,
la légende de l'homme rapide
Titre original :
Atanarjuat
Réalisateur :
Zacharias Kunuk
Acteurs : Natar Ungalaaq
, Sylvia Ivalu , Peter-Henry Arnatsiaq
Scénario : Paul
Apak Angilirq
Photo : Norman Cohn
Musique : Chris Crilly
Distribution : Rezo
Films
Sortie France : 13 février
2002
Durée : 2h 27
mn
Pays : Canada
Année : 2001
|
|