SYNOPSIS :
En faisant preuve de détermination, d'endurance physique,
d'agressivité et d'intelligence, Muhammad Ali est devenu
une légende vivante de la boxe américaine. Belinda,
son épouse, Angelo Dundee, son entraîneur, Drew
Brown, son conseiller, Howard Bingham, son photographe et biographe,
et Fernie Pacheco, son docteur, ont été les témoins
privilégiés de sa carrière à la
fois brillante et mouvementée que ce soit sur ou en dehors
du ring. |
|
....................................................................
|
MULTIPLICITY
| |
 |
|
|
L’expression en-tête
de l’article sur Ali, de Michael Mann, dans le numéro
de Première de février 2002, n’engage
que son auteur, Christian Jauberty, mais elle risque de générer
un drôle de malentendu général. L’expression-cliché
" Pour ceux qui aiment les bios des stars du
sport " provoque un léger malaise. Promotion
et raccourci oblige. Oublier le jugement hâtif, l’étiquette ;
mais l’important est ailleurs, dans le contenu de l’article,
car Ali est loin d’être la biographie commune
d’une star du sport. Dans son article, Christian Jauberty
reproche au film de ne pas proposer de " point
de vue révélateur sur la personnalité
profonde et le destin exceptionnel d’une légende vivante ".
Que manque-t-il au journaliste, obligé paradoxalement
d’accorder trois étoiles à ce produit attendu-médiatisé-incontournable ?
Un chapitrage du film, et dans ce qu’il nomme " une
succession de vignettes ", une borne lumineuse éclairant
les diverses optiques : " ses femmes ",
" son goût pour la provocation ",
" son nihilisme "..? A propos stérile,
critique stérile : c’est enfoncer une porte bien
ouverte que de critiquer Première, mais cela
devient légitime au regard des moutons qui étiquettent
les films comme les illustres bergers de leur magazine préféré.
Première véhicule moins du sens qu’il
n’en vend ; ici, le sens donné au film avorte
la critique, mais se révèle tristement cohérent,
quand Christian Jauberty se recentre finalement sur l’acteur,
Will Smith : la politique maison (la seule) de l’acteur,
comme image-spectacle. Il semble que Jauberty s’abîme
dans la problématique apparente d’Ali en évacuant
la réflexion : " Ali se révèle
(…) aussi insaisissable que sur un ring ", confesse-t-il,
tout en se risquant à poser la bonne question :
le point de vue biographique, dans Ali, existe-il ?
Dans Ali, la multiplicité
des points de vue se fond dans l’image. L’abondance des tracés,
la recherche de l’esquisse idéale illustrent le personnage,
sans formater le mythe. Ébauche, tentative d’une tapisserie
constituent l’essence du biopic Ali. Ce qui
prime semble la complexité à cerner un mythe,
née de la recherche (bio) graphique autour d’un
vide, passé et identité dont les restitutions,
autres que graphiques, s’avèrent vaines. Qu’il s’agisse
d’Ali importe-t-il réellement ? Retrouver un personnage,
une légende passée, comme une entité
symbolique et vivante révèle de l’utopie. La
réactualisation du mythique Ali, par la fiction, se
double, chez Michael Mann, d’un regard immotivé (de
là naît l’effusion poétique) portant sur
un homme souvent non-motivé : dans son esquisse
du vide qui tend vers une mythologie, Ali est moins
une biographie (du héros), qu’une radiographie mentale,
cérébrale (de l’homme). Le parcours de l’homme
au héros, du héros à l’homme, sous-tend
le film pour ce qu’il est : recherche, exercice et équation
visuelles qui dessinent la cellule mentale du célèbre
boxeur.
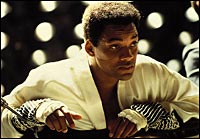 |
|
|
|
Tel est l’enjeu de Michael
Mann, cinéaste graphiste : transcrire le tissu
du cerveau d’Ali par les profusions de lumière, de
jets sibyllins dans les pores de l’image diaphane et ralentie.
Parvenir derrière les affects de l’image (Ali), en
puisant dans les nervures de l’image (numérique, vidéo
et autres gracieusetés). De la démultiplication
sensorielle par l’apparente sobriété du parti
pris, épure des différences visuelles, provient
la faible incompréhension du journaliste. On assiste
à l’effacement biographique, au gommage du caractère,
pour accéder à une géographie mentale
(ou topographie), expérimentation graphique de Muhammed
Ali. Nulle trace de biographie, de destinée, mais des
desseins qui s’accordent aux puissants simulacres de l’image.
Accomplissement d’une totale subjectivité, biographie
abstraite ébranlée par les dessous du visuel,
Ali propose le scanner d’une cellule mentale. L’émotion
culmine à mesure que ne grandisse l’arsenal des supports,
passages et transferts d’images, regard pyrotechnique du cinéaste
qui décline les préceptes communs de la biographie
et en marque l’aporie.
De la bio ne subsiste que
le graphique. Dans l’usage de la steady-cam numérique
sur le ring de boxe, nous recevons le tracé des coups
et devenons Ali. Et par-delà l’arsenal technique, une
lueur humaine : avant l’ultime ralenti, plan moyen sublime
: derrière Ali en sueurs, les grains de l’image fixe
coulent - l’image pleure. C’est dire si la biologie des images
tient, dans Ali, à une synergie sémantique
et conceptuelle du dessin et du sens.
 |
|
Titre : Ali
Réalisateur :
Michael Mann
Interprètes :
Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van
Peebles, Ron Silver, Jeffrey Wright, Mykelti Williamson.
Scénario : S.
J. Rivele, C. Wilkinson, E. Roth et M. Mann
D’après une histoire
de : Gregory Allen Howard
Directeur de la photographie :
Emmanuel Lubezki, A.S.C, A.M.C.
Chef décorateur :
John Myhre
Musiques : L. Gerrard,
P. Bourke, S. Keita, R. Kelly, A. Keys, A. Stone
Production : Peters
Entertainment / Forward Pass
En association avec :
Columbia Pictures, Lee Caplin, Picture Entertainment
Corp. et Overbrook films.
Distribution : Bac Distribution
Sortie le : 27 février
2002
Pays : Etats-Unis
Année : 2001
Durée : 2h38
|
|
|