SYNOPSIS :
L'été. Les départs en vacances. La France
profonde entre Bourgogne et Gironde. Quatre personnages se rencontrent
par une succession de hasards. A moins que ce soit le destin.
Alors le vieux Mischka, l'infirmier Gégéne, l'ado
fugueuse Jane et Joli-Cœur la rockeuse, vont passer quelques
jours ensemble en voyageant vers la mer. Quelques jours pour
mieux comprendre comment naviguer entre la famille qu'on a et
celle qu'on se choisit. |
|
....................................................................
|
| ROUTE EMOUVANTE
Un plan-séquence
virtuose, pour ouvrir un ballet de corps. De violents jump-cuts
dépourvus de plan de coupe, pour en briser l’unité.
Dans Mischka, la trajectoire de l’objectif est celle
des personnages, de leurs liens tronqués puis reconstruits
en marge d’institutions qui peinent à les épanouir.
Sur la route des vacances, un insupportable quadragénaire
sature l’espace sonore de sa bile franchouillarde. En une
scène de ménage unilatérale, où
l’interlocutrice blasée laisse glisser sur elle la
logorrhée de son mari, Stévenin dresse le procès-verbal
de la famille et par là même, un provisoire constat
d’échec. Mischka, que son braillard de fils traite
comme un chien, ne souhaite pas finir son voyage allongé
dans le coffre du break. Il fugue.
De cet éclatement
primitif (la femme ulcérée s’éclipse
à son tour, laissant ses deux enfants aux soins du
bourru), Stévenin recueille des fragments de vie, des
errances marginales, pour les agglomérer. Le vieux
presque muet, sa monstrueuse et épaisse silhouette
au rythme de culbuto, engrènent une spirale de rencontres
heureuses car défectives. Recueilli par un hospice
bourguignon, il est kidnappé par son gardien alcoolique
et loufoque, Gégène, lui-même rongé
par sa mauvaise paternité. Plus loin, ils se lieront
d’affection avec deux gosses dont l’aînée traverse
clandestinement la France pour retrouver son géniteur,
à un vieux garçon un peu simplet qui traîne
sa quarantaine dans la maison maternelle, à une jeune
gitane fatiguée des régulières escapades
carcérales de son mari... Filiation de la cicatrice,
qui régénère les tissus des déshérités
et donne un lustre si émouvant à leur famille
de fortune. Cette spirale utopique, à l’œuvre dans
Mischka, rapproche Stévenin d’Eastwood : un
tel road-movie hippie, visitant par un récit errant
les grands espaces d’un pays en puisant dans le creuset de
ses mythes, assume sa gémellité inconsciente
avec sa traduction américaine, le western épique
de Josey Wales, Hors-la-loi ou réduplicateur
de Bronco Billy.
 |
|
|
|
Le même rêve
de sédentarité épanouie étreint
ces saltimbanques, que la sédentarité aliénante
a poussés sur la route. À chaque personnage
revient la charge de mythifier sa carence (père absent,
fille abandonnée, carrière avortée...),
Stévenin s’appliquant à les incarner, monumentales,
concédant de son objectif insistant une valeur déifiante
à la symbolique débridée. Des bustes
de statue glorifiés, un Johnny et son buste au statut
fantasmé, le rêve d’imposition est au centre
de Mischka. Mais l’issue en est invariablement douce-amère,
déceptive mais réalisante. Lorsque les pèlerinages
se heurtent à leur destination, c’est littéralement
une démythification qui est à l’œuvre : la rencontre
de son père n’a pas, pour la jeune fille, la saveur
escomptée, de même que Gégène flanche
et renonce au moment de revoir sa progéniture... Tous
réunis dans cette odyssée de la légèreté,
aucun n’en estompe pour autant la meurtrissure qui sous-tend
leurs rencontres. Ensemble, ils travestissent leur souffrance
en insouciance et assument une certaine folie.
La mise en scène
de Stévenin, au diapason de ses personnages (lui-même
est acteur dans Mischka, se confiant l’entité
la moins équilibrée et la plus fantaisiste,
par défaut d’affection...), ne distancie jamais son
point de vue et naturalise leur déviance, inscrivant
leur évolution dans l’exploration sensorielle de l’espace.
Les mouvements d’appareil semblent adresser aux paysages de
campagne une caresse d’aveugle sur les traits d’un visage.
La bande-son en hérite une acuité décuplée
et instrumentalise les atmosphères, alternant l’angoisse
paranoïaque de la symphonie autoroutière et le
paisible recueil de la nature champêtre. La topologie
détaillée, nommant villes et régions,
en appelle à la signifiance : ces exclus pas même
désargentés (ils achètent des billets
de train pour ne pas le prendre, des huîtres pour ne
pas les manger...) trouvent en leur dernière arrivante
un emblème de condition. Tous gitans, nomades par choix,
ils dirigent leur escapade vers un camping au statut sociologique
métaphorisé. Réunion provisoire d’éléments,
autour d’un feu, au soir d’une étape, consumant dans
un brasier commun leur rancune de la vie. Rythmé par
ces moments de repos collectif, Mischka clame la communion
de son bestiaire et revendique l’absence de personnage principal.
Le sage patriarche éponyme, qui avait débuté
la fiction en enfant incontinent ou en clébard galeux,
ne doit son rôle-titre qu’au mérite ultime d’avoir
initié, géniteur d’émotions, cette route
émouvante.
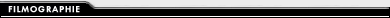 |
|
Titre : Mischka
Réalisateur :
Jean-François Stévenin
Acteurs : Jean-Paul
Roussillon, Jean-François Stévenin,
Rona Hartner, Salomé Stévenin, Pierre
Stévenin, Jean-Paul Bonnaire, Yves Afonso,
Claire Stévenin, Elisabeth Depardieu, Patrick
Grandperret
Scénario : Jean-François
Stévenin
Photo : Pierre Aïm
Musique : Philippe Miller
Production : Arcapix
Distribution : Bac Distribution
Sortie France : 20 février
2002
Durée : 2h 06
mn
Pays : France,
Suisse
Année :
2002
|
|
|