SYNOPSIS :
Dans la petite ville de Snow-Hill,
en 1898, une horde de chasseurs de prime mené par l’ignoble
Figueiro (Klaus Kinski) profite tranquillement d’une poche de
hors-la-loi réfugiés dans les montagnes pour augmenter
leur capital. Et comme ils valent autant morts que vif, les
cadavres s’accumulent. L’arrivée de Silence (Jean-Louis
Trintignant), tueur qui ne se différencie des autres
que parce qu’il ne dégaine qu’en état de légitime
défense, va-t-il rétablir l’ordre ?Un nouveau
shérif, mandaté par le gouverneur, est dans tous
les cas déterminés à faire de nouveau régner
la Loi à Snow-Hill. |
|
....................................................................
|
|
POINT DE VUE
Il existe deux versions
du Grand Silence : celle qui est connue en Europe,
et qui fit pour beaucoup pour la renommée du film de
par la noirceur absolu de son final ; et la version avec
" happy end " destinée à
l’exploitation américaine. Ce fut la version européenne,
en VF, qui fut projetée ce soir, plus pour des raisons
de compréhension qu’à cause de la difficulté
de trouver une copie de la version alternative. On peut le
regretter, mais pas bouder son plaisir devant l’occasion de
voir les plaines de Snow-Hill sur grand écran.
Échec public à
sa sortie, Le Grand Silence s’est rapidement imposé
comme un des chefs d’œuvre de son réalisateur Sergio
Corbucci, et l’un des meilleurs " western-spaghetti "
jamais réalisé. Entièrement tourné
dans les paysages enneigés des Dolomites, le Grand
Silence impose d’emblée un univers sauvage et morbide,
où le mythe de la Conquête n’est plus qu’un lointain
souvenir. La communauté humaine est désagrégée,
dans un No Man’s land funèbre où l’argent régit
toutes les interactions sociales, et où la vie d’un
homme ne vaut que le montant de la prime mise sur sa tête.
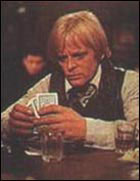 |
|
|
|
Il y a parfois des coïncidences
fascinantes dans l’histoire du cinéma : ainsi
la réalisation, la même année (1969),
du Grand Silence et de Goyokin (La Terreur
des Sabais en VF !) d’Hideo Gosha. L’emploi étonnant
de la flûte Kakuashi, porteuse d’une tonalité
tout orientale, par Ennio Morricone dans le Grand Silence
incline à penser l’antériorité de Goyokin.
Mais ces deux films terminaux, reflet dégénéré
de l’agonie du cinéma de genre, sont si proches dans
leurs propos et leur situation qu’on a peine à croire
à un hasard. Même recours au paysage enneigé
pour dépeindre un monde sans espoir, même fascination
pour la chair morte et la décomposition… 1969, année
zéro du cinéma de genre ?
À la re-vision, la
particularité du Grand Silence est d’accorder
à la question de la Loi une place première.
Sur la trame minimale du western-spaghetti, le scénario
fait retour sur une situation plus typique du western hollywoodien,
toujours soucieux de la question politique de l’ordre public.
Le personnage du shérif balourd, scrupuleux comme un
fonctionnaire et désireux de rétablir l’ordre
par des moyens légaux s’offrirait presque comme le
personnage principal de ce récit désespéré.
Sa croyance en la toute-puissance de la loi ne vaut cependant
rien face à une réalité chaotique que
les décrets mêmes ont conduit à créer.
Le Grand Silence procède alors pour beaucoup du
collage, d’une juxtaposition tonale entre deux situation du
western.
|