|
Malgré des fulgurances
incontestables dans certaines séquences, le film ne
parvient pas à nous captiver entièrement. La
mise en scène demeure académique, classique,
sage, sans surprise. Le travail de la photographie, du cadre,
de la lumière, des acteurs bien sûr, est certes
remarquable, mais donne un sentiment de déjà
vu, tant sur le plan esthétique que narratif.
Sans doute cela provient-il
du parti-pris de reconstitution historique adopté par
Im Kwon-Taek, parti-pris qui alourdit le propos, lequel traite
pourtant d’un sujet inépuisable : la création
artistique et sa douleur…
On pense alors au " Van
Gogh " de Pialat, peintre contemporain de Ohwon
ou à " La Belle Noiseuse "
de Rivette qui avaient su mieux nous plonger dans l’inconnu,
la singularité, la tourmente d’un être en création…
" Apprendre à souffrir sans se plaindre,
apprendre à considérer la douleur sans répugnance,
c’est justement un peu là qu’on risque le vertige ".
Cette phrase de Vincent Van-Gogh est proche des sentiments
d’Ohwon, de cette ivresse que voudrait saisir le réalisateur
mais que sa mise en scène n’atteint pas ou rarement.
Dans son précédent
film : Le chant de la fidèle, Chunhyang (2000),
Im Kwon-Taek était parvenu à nous fasciner,
en suivant l’incantation particulière d’un chanteur
traditionnel sur la scène d’un opéra et la représentation
visuelle de son récit ; un dispositif et un art
pourtant difficiles d’accès, voire même hermétiques
pour des non-initiés occidentaux, mais qui parvenait
à nous prendre, à nous émouvoir.
Ivre de femmes et de
peinture a peut-être le défaut d’un
récit trop linéaire et simple justement, occidentalisé,
lequel donc, ne nous étonne pas, ni dans la forme ni
dans le fond. Mais il a le mérite de nous rappeler
que la préservation de l’identité culturelle
spécifique des films est donc essentielle pour atteindre
l’universalité et toucher l’être humain, le public,
où qu’il soit, quel que soit son mode de vie, un sujet
d’actualité…
C’est le désir que
formule le cinéaste Aki Kaurismaki quand
il dit en poète : " Je veux faire des
films qui parlent à une vieille paysanne chinoise… ".
Et pourtant quels films sont plus spécifiques que
les siens, imprimés du sceau de la culture Finlandaise,
de l’esprit finnois si particulier ? L’on aurait souhaité
qu’Ivre de femmes et de peinture atteigne cette ivresse
universelle et nous transmette la promesse de son magnifique
titre. Hélas, il n’y parvient pas comme on l’espérait.
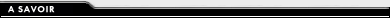 |
|
A lire :
Lettres
à son frère Théo, Vincent
Van Gogh (Grasset, Paris, 1986), correspondance
tourmentée et passionnante du peintre,
sur la vie, la création…
|
|
 |
|
Titre : Ivre
de femme
Réalisation :
Im Kwon-Taek
Premier assistant-réalisateur :
Chung Kyoung-Jin
Scénario :
Kim Young-Oak/ Im Kwon-Taek
Directeur de la photographie :
Jung Il-Sung
Scriptes :
Nam Ji-Young, Choi Min-Sik, Ahn Sung-Ki, You Ho-Jeong,
Kim Yeo-Jin, Son Ye-Jin
Chef éclairagiste :
Kim Dong-Ho
Ingénieur du son :
Lee Choong-Hwan
Décorateur :
Ju Byoung-Do (MBC Art Center)
Costumes
: Lee Hye-Lan
Chef accessoiriste
: Jung Chang-Ho
Maquillage :
Hong Ki-Cheon
Coiffure :
Lee Eun-Young
Photographe de plateau
: Kim Jae-Young
Documentaliste
: Cho Sun-Jong (IMTV)
Cadreur
: Lee-Kee-Won
Electricien
: Hwang Sung-Hyun
Preneur de son
: Ahn Dae-Hwan
Son
: Yang Dae-Ho
Directeurs de production :
Kim Sung-Ryong/ Lee Hee-Won
Régisseur :
Lee Ji-Seung
Distribution :
Pathé distribution
Production :
Taehung Pictures (Corée)
Producteur
: Lee Tae-Won
Producteurs exécutifs
: Kang Woo-Suk/ Michael Kim
Prix :
Prix de la mise en scène, Festival de Cannes
2002
Sortie :
27 novembre 2002
Durée :
1h 57
|
|
|