POINT DE VUE
| |
 |
|
|
Comme le remarque Romain Slocombe
dans son introduction au Charisma de Kyoshi Kurosawa,
la forêt revêt, pour le Japonais, un caractère singulier.
Lieu de méditation et de silence, l’esprit accablé vient s’y
abandonner, non pour trouver-là le réconfort de la nature,
ou pour obtenir la paix loin des préoccupations de la capitale,
mais pour, une fois la corde solidement nouée à une branche
haute, venir se donner la mort par pendaison. Maurice Pinguet,
dans son ouvrage La Mort Volontaire au Japon, décrit
comment les alentours du Mont Fuji sont ainsi devenus, en
l’espace de quelques années, le lieu de découvertes macabres :
« on vient ici, seul ou en couple, pour se pendre, s’empoisonner,
mourir de froid. Au mois d’octobre, avant l’arrivée des neiges,
une patrouille s’avance à grand-peine dans l’inextricable
sous-bois : chaque année on retrouve ainsi une trentaine
de squelettes que les renards, les corbeaux et les chiens
sauvages ont nettoyés de leur chair inutile » (1).
Pour une société qui sait distinguer chaque aspect du suicide,
qui codifie l’acte selon l’intention que le suicidé souhaite
lui accorder de son vivant -munenbara, « seppuku
de ressentiment », kanshi ou « mort de remontrance »,
asu ikka shinju ou « suicide familial » -,
la mort ne peut se dégager de ces signes comme de ces us.
Ici tout est rapport à l’autre et effort de communication.
Plus encore que de son vivant, le suicidé communique, de manière
définitive, irrévocable, il donne à entendre le fond de son
cœur.
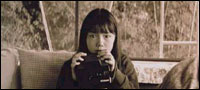 |
|
|
|
Dans Eureka (2000), Aoyama
dégageait déjà le paradoxe d’une société japonaise repliée
sur elle-même, multipliant les signifiants sans jamais laisser
de véritable place à la parole, où seules la mort violente
et la confrontation révélaient entièrement les individus.
Cette analyse de la société japonaise moderne est aujourd’hui
caractéristique des préoccupations de la nouvelle génération
de cinéastes - Kurosawa, Aoyama, Ishi… - dont les personnages,
souvent usés, sans passion, perdent lentement leur identité
jusqu’à la disparition complète. Qu’il s’agisse des anti-héros
de Kurosawa ou de Aoyama, la société japonaise ne semble
devoir offrir qu’une lente dégradation de ses membres dans
l’anonymat de la masse, sans pensée ni affects.
Premier épisode d’une série mettant en scène les aventures
du détective Mike Yokohama, La Forêt sans Nom (2001),
réalisé avec le concours de la télévision et développé par
Rumble Fish, prolonge cette étude du Japon contemporain
qui, si elle ne s’attaque jamais de front à la thématique
sociale, permet de revenir sur la crise de la jeunesse de
l’après-guerre.