POINT DE VUE
« Avec joie j’attend le
départ...et j’espère bien ne jamais revenir... »
Frida
| |
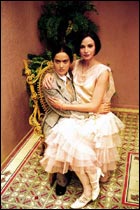 |
|
|
Voici les derniers mots qu’inscrit
Frida Kahlo dans son journal intime, en 1954.
Derniers mots de celle qui se disait être née en 1910, l’année
de la Révolution mexicaine, celle qui fut renversée par
un tramway et restera handicapée toute sa vie dans de perpétuelles
souffrances, femme-muse du peintre pygmalion Diego Rivera,
amante de Trotski, d’André Breton, admirée de Picasso, Kandinsky
et Muray, a définitivement marqué toute la culture latino-américaine.
Frida Kahlo est l’un des peintres les plus populaires d’Amérique
du Sud. S’attaquer à un tel sujet était de l’ordre du pari
perdu d’avance.
Quiconque croise l’image d’un tableau de Frida Kahlo conserve
en mémoire des images obsédantes. Comme une blessure perpétuellement
mise à vif qui hante tout imaginaire cauchemardesque.
Le pari pris par Julie Taymor et son interprète-productrice
Salma Hayek de réaliser une biographie hollywoodienne de
ce mythe latino-américain communiste demeura de l’ordre
de la folie. Le film n’échappe pas au genre. Les événements
se succèdent dans la vie de Frida au sens le plus hollywoodien
du terme. C’est peut-être, dans un premier temps, au travers
une touche toute particulière apportée à la partition musicale
que le sujet va à la rencontre du film. Si un titre est
tout spécialement composé pour le film, interprété par le
mythique Caetano Veloso et Lila Downs dans l’esprit proche
des chants traditionnels mexicains, les autres éléments
musicaux sont un hommage à la tradition mexicaine.
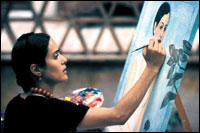 |
|
|
|
Le spectateur croise la vedette
portoricaine Chavela Vargas qui apparaît en « guest
star » dans le film, chantant « La llorona »,
textuellement « la pleureuse ». Tandis que « La
bruja », la sorcière, chant traditionnel mexicain chanté
puis évoqué à plusieurs reprises était l’une des chansons
préférées de Diego Rivera.
Si elle est difficilement évoquée dans le film, l’identité
toute mexicaine du sujet semble prédéfinir le film. L’ambiance
restituée demeure ainsi, loin des clichés « mexicanisants »
habituels. Décors naturels, où les couleurs éclatantes sont
autant de symptômes représentatifs d’une force et d’une
pauvreté que l’héritage vivant d’un pays en lutte perpétuelle
contre lui-même. Quelques instants fugaces sont touchés
par la grâce. Lorsque Trotski et Frida gravissent une à
une les marches d’une pyramide aztèque jusqu’à arriver à
son sommet, où rien ne subsiste sauf un ciel qui les écrase
de tous son bleu. La séquence entière justifie tous les
dialogues amoureux formulables mais surtout l’alliance amoureuse
d’un pays à une idéologie utopique.