POINT DE VUE
| |
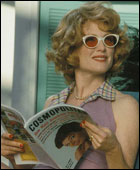 |
|
|
La Chronique d’un ménage en crise
sur fond d’années 50 : un film aussi beau qu’intelligent
qui met en scène les clichés du genre d’une manière fine
et élégante.
L’histoire du film se déroule dans les années 50. Les voitures,
les costumes, les us et coutumes, tout ramène inexorablement
à l’époque si bien qu’on se prend à voir dans ce parti pris
artistique un certain maniérisme, une esthétique de pacotille.
De même le scénario, « cousu de fils blancs »,
n’étonne jamais et reprend sans aucun complexe les topoï
les plus éculés de la société bourgeoise. Que doit alors
comprendre le spectateur ? À quoi rime cette tragi-comédie
tout droit sortie d’un autre âge et calquée sur le vaudeville ?
Ce qui importe en réalité n’est pas que ce film emprunte
son esprit à une autre époque mais qu’il pose précisément
le regard de notre temps sur celle-ci. Les tenants du nouveau
roman proclamaient : « L’écriture n’est plus l’écriture
d’une aventure mais l’aventure d’une écriture ». Ici
le film, en sursignifiant ses références, abat ses cartes,
nous parle du cinéma des années 50, de Capra (avec ses scènes
de familles, sa tendresse, ses joies) mais aussi de Douglas
Sirk. En somme Far from heaven, en mettant en scène
non pas une époque mais l’image de cette époque (ses
clichés), se pose comme une véritable déclaration d’amour
au cinéma ainsi qu’à la culture de ce temps.
Le film ne raconte donc pas nécessairement une histoire,
ses images sont des signifiants, qui révèlent pourtant des
aspects importants de la relation entre les individus et
de l’époque dans laquelle il vivent. Les conventions, le
style, seul ce qui relève précisément du signe vide conditionne
les rapports entre les individus et la marche d’une société
prise dans une croissance économique exponentielle. Cathy
Whitaker, au début du film, se fait prendre en photo pour
un magazine féminin, elle est l’image de la femme parfaite,
une mère de famille exemplaire, la reine du cénacle bourgeois
de la bourgade d’Hartford. Cathy est une image. Ce film
est l’image d’une image – un meta-film.
 |
|
|
|
A quoi ressemble cette image ?
Far from heaven retrace l’histoire d’une chevelure
rousse. Cette chevelure, toujours au premier plan, se marie
avec des tons pastels omniprésents : le mauve, le vert
d’eau, le bleu, le turquoise, le rose…sa rousseur s’accorde
aux couleurs de la même manière que Cathy s’accorde avec
son entourage. Les couleurs la racontent davantage
encore que ses gestes, ses paroles. Elle est l’harmonie
qui rend l’ensemble cohérent : le couple, la famille, le
cénacle (dont elle cristallise l’attention). Elle va même
jusqu’à transporter cette harmonie aux marges de sa sphère
sociale en sympathisant avec un homme noir, son jardinier.
Cathy introduit par là une dissonance, initie les rumeurs,
entretient malgré elle les potins. Bouleversée par les bruits
qui entourent sa relation avec Raymond Deagan (le jardinier)
et la crise homosexuelle que traverse par ailleurs son mari,
Cathy ne contrôle plus rien. Certes elle occupe toujours
le premier plan, mais sa coiffure, l’éclat de ses cheveux
n’est plus assorti au décor qui l’entoure, elle se confond
avec lui – la bonne société s’impose à elle, de maîtresse
femme elle passe au statut de femme calomniée. Son image
se trouble et se voit littéralement remise en cause. Cathy,
sans s’en rendre compte, a perdu son image (c’est-à-dire
la manière dont elle était perçue et dont elle-même finissait
par se percevoir). Cette perte est dans un premier temps
ressentie comme une sanction à la fois injuste et violente.
Puis, l’image envolée, Cathy se découvre : elle
ne parle plus, elle s’écoute ; elle n’agit plus, elle
sent. Il y a dans l’émancipation de cette femme quelque
chose de la magnificence de Nora, l’héroïne d’Une maison
de poupée – autre œuvre féministe – d’Ibsen.
L’un des plus beaux paradoxes de ce film est qu’il parvient,
en dépit du fait qu’il se déroule dans les années 50 et
qu’il repose sur une quantité de clichés, à être résolument
moderne. Sa modernité réside, nous l’avons déjà vu, dans
sa capacité à raconter une histoire tout en parlant de lui-même.
Cette œuvre comprend son propre réfléchissement, c’est le
premier point (songeons à la thématique du miroir chez Baudelaire
et à l’écriture double chez Mallarmé).