 |
|
|
|
En 2001, il passe à l'acte, transposant
du court au long sa démonstration par l'image du syndrome
de Stockholm, mal étrange qui pousse les victimes à prendre
le parti de leurs agresseurs. En soi, le passage d'un format
à l'autre n'a rien de critiquable. Si le cinéaste japonais
avait développé son histoire, l'avait rendue plus charnue,
l'opération aurait pu être séduisante. Mais Kazushi Watanabe
n'a fait qu'étirer son récit dans le sens de la longueur,
jamais dans celui de la profondeur. Même après le passage
au long, les personnages se résument en un seul trait de caractère.
Il y a le beau gosse charmeur, la brute silencieuse, le poète
philosophe... Bref, une série d'archétypes qui frisent la
caricature. Watanabe prétend que cette excessive caractérisation
est volontaire. Il a par exemple choisi de ne pas donner de
noms à ses personnages, d'en faire des êtres détachés de toute
réalité sociale. Au générique, les trois malfrats sont ainsi
désignés par des noms de régions japonaises : Chiba, Kobe
et Yokohama. Mais, le choix de l'anonymat devant renforcer
le côté surréaliste et mystérieux de son histoire n'explique
pas pourquoi les différents protagonistes sont d'une si grande
platitude.
La seule chose qui caractérise les personnages, c'est leur
look très étudié. Crinière à la Romain Duris, petite barbe
soigneusement négligée, chemise blanche largement ouverte,
le sauvageon en chef a tout du beau gosse rebelle, image d'Épinal
qu'on retrouve à foison dans les magazines de mode ou sur
les affiches publicitaires. Ses deux compères adhèrent au
même schéma : le poète porte bonnet et barbichette, tandis
que le violent arbore des lunettes noires et un piercing à
l'oreille. L'acteur qui interprète ce troisième larron, Ryo
Shinmyo, n'est pas connu au Japon pour ses talents d'acteurs,
mais plutôt pour celui de mannequin. Présence qui résume à
elle seule l'importance de la mode dans la démarche artistique
de Watanabe. Les habits de plusieurs personnages sont ainsi
customisés. La deuxième victime des kidnappeurs est vêtue
d'un tee-shirt bleu sur lequel est inscrit en gros caractères
jaunes le mot "happy" suivi d'un point d'interrogation. De
son côté, le poète à bonnet porte au dos de son tee-shirt
l'inscription "It's better to burn out, than to fade away".
Ces détails pourraient paraître anodins, mais ils témoignent
d'une volonté de « faire branché » qu'on retrouve dans d'autres
secteurs du film.
| |
 |
|
|
Dans sa réalisation, Watanabe utilise différents
procédés jeunistes. Dès le générique, un morceau de guitare
électrique saturée pose le débat. L'important n'est pas de
faire sens, de faire de 19 un véritable film. Il s'agit
d'être dans le coup, de coller au plus près d'une jeunesse
supposée écouter la musique à fond les décibels. Dans le même
ordre d'idée, l'image est très surexposée, non pas pour apporter
quelque chose à l'histoire, mais plutôt parce que « ça fait
joli ». Là est bien tout le problème de 19, on a l'impression
que rien n'est pensé, ni réalisé selon un but artistique clairement
défini. Les scènes se succèdent sans que leur nécessité ne
soit démontrée. Par exemple, pendant près de dix minutes,
le trio et leur victime errent dans un magasin aux airs de
bric à brac, tripotant un certain nombre d'objets présents
avant de finalement s'en aller. Ce passage ne sert à rien,
ne fait pas avancer l'histoire d'un pouce. Mais il comble
efficacement une partie des 82 minutes du film, et c'est là
la raison de son existence : il soulage un réalisateur en
proie à une inspiration plus qu’hésitante. Des personnages
stéréotypés, un argument assez mince, une esthétique particulière
: même en long-métrage 19 a tout du court. Mais malheureusement
pour Kazushi Watanabe, les qualités exigées ne sont pas les
mêmes suivant le format. Et là où Kazushi Watanabe a réalisé
un court digne d'intérêt, il a commis un mauvais long.
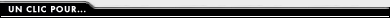 |
|
 |
|
Titre :
19
Réalisateur :
Kazushi Watanabe
Scénariste :
Kazushi Watanabe
Acteurs : Daijiro Kawaoka,
Kazushi Watanabe, Takeo Noro, Ryo Shinmyo, Masashi
Endo, Nachi Nozawa
Producteurs : Dany
Wolf, Saul Zaentzu
Production : Gaga Communications
Inc.
Distribution : Bodega
Films
Image : Mazakazu Oka
Montage son : David
A. Cohen
Lumière : Hideaki
Yamakawa
Décors : Masahide Kawanara
Montage : Yoshio Sugano
et Kazushi Watanabe
Effets sonores : Kouya
Sato
Sortie le : 23 juillet
2003
Durée : 1h 22 min
Année : 2001
Pays : Japon
|
|
|