SYNOPSIS
: 1875. Augustine, une jeune fille
atteinte d'hystérie, arrive à l'hôpital de la Salpêtrière.
Elle devient vite le modèle favori du nouveau laboratoire
de photographie et la patiente du professeur Charcot. Peu
à peu, elle échappe au contrôle des médecins.
|
|
....................................................................
|
L'antre
de la folie
Augustine est
un film ambitieux. En voulant parler des débuts de l'étude
de la folie, Jean-Claude Monod et Jean-Christophe Valtat
n'ont pas choisi la facilité. On est très loin du court-métrage
à chute reposant sur un scénario de la taille d'un synopsis.
La plongée en noir et blanc dans le XIXe siècle finissant
flatte des neurones trop souvent laissés au repos, en particulier
dans le cinéma français. Augustine questionne la
science moderne en en montrant les prémices. Aujourd'hui,
on s'interroge sur les OGM, sur le clonage, sur la capacité
des chercheurs à jouer avec nos vies pour une quête du Graal
hypothétique bien qu'insensée. Mais tous ces doutes sur
le progrès médical se posaient déjà en 1875.
Augustine évoque l'apparition de la photographie
dans le champ de la médecine. C'est l'époque où les médecins
avaient la passion de la mesure anthropomorphique. Tout
était découpé en petites lamelles, pesé au gramme près,
en dépit parfois du respect de la dignité humaine. En se
basant sur le personnage d'Augustine, Jean-Claude Monod
et Jean-Christophe Valtat espéraient mettre en lumière tous
ces thèmes passionnants. Et, parfois, les deux réalisateurs
y parviennent en grande partie grâce à leur distribution.
Maud Forget et surtout François Chattot, avec sa voix hallucinante,
sont remarquables et portent le récit.
Cependant, les prestations de ces deux comédiens ne parviennent
jamais à soutenir un film trop bancal pour être séduisant.
Autant le thème est intéressant, autant la réalisation pêche
d'un manque certain de virtuosité. Jean-Claude Monod et
Jean-Christophe Valtat n'arrivent jamais à adapter leur
mise en scène à leur propos. Résultat : Augustine
n'est qu'un film plat, sans souffle, qui ennuie plus qu'il
ne fascine. Et, même si l'on frôle quelque part par cette
constatation le préjugé et la généralisation, cet échec
tient peut-être dans le parcours des deux réalisateurs.
Jean-Claude Monod est chercheur en philosophie au CNRS et
Jean-Christophe Valtat est écrivain et enseigne la littérature
en université. Rares sont les cinéastes au parcours voisin
qui ont réalisé des films de référence. Tout simplement
parce que raconter par l'image n'est pas donné à tout le
monde, et encore moins aux hommes de lettres. Littérature
et cinéma ne résultent pas du même processus artistique.
Les réalisateurs écrivent souvent, et plutôt bien pour certains,
mais ils - du moins les meilleurs d'entre eux - possèdent
un rapport physique et non intellectuel au réel.
Augustine souffre ainsi d'une trop grande réflexion,
d'une trop grand érudition. Les sentiments sont comme figés
dans une gangue, incapables de toucher le spectateur car
privés de toute humanité. À la limite, Augustine
aurait pu être un des ces docus-fiction que diffuse régulièrement
Arte et où l'on aperçoit des reconstitutions historiques
sur l'invention de l'imprimerie ou la découverte du vaccin
contre la rage. Des programmes qu’il faut bien le dire sont
quasiment irregardables dans leur totalité tant ils sont
soporifiques. Dommage car le sujet de départ était passionnant.
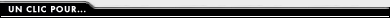 |
|
 |
|
Titre : Augustine
Réalisation : Jean-Claude
Monod et Jean-Christophe Valtat
Scénario : Jean-Christophe
Valtat
Image : Thomas Bataille
Son : Pierrick Guénnégan
Montage : Saskia Berthod
Interprétation : M. Forget,
F. Chattot, S. Ossard, F.-X. Noah
Production : Les Films
du Possible
Année : 2003
Durée : 43 min
Format : Noir et blanc,
35 mm
|
|
|