Film phare des défuntes
80's, Brazil a été un choc pour une génération
de cinéphiles. Mais derrière cet incontestable
film-culte, son auteur a subi une grande crise cinématographique.
| |
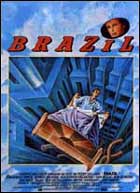 |
|
|
Spécialiste de l'animation
chez les Monty Python, Terry Gilliam a décidé
de se lancer dans un long métrage où il pourrait
explorer une profondeur que le gag télévisuel
lui interdisait. Cela aboutira à un chef doeuvre d'humour
et d'émotion, quand Kafka revisite Blade Runner.
Ce délire cauchemardesque fût d'autant plus difficile
à réaliser que Gilliam subissait la pression
constante et tyrannique de ses producteurs. Les pontes de
la MGM n'appréciaient en effet pas ses visions créatives
et le désespoir qui en émane. L'histoire donnera
raison à Terry Gilliam qui imposera avec le temps une
fin sombre et pessimiste.
Mais à quel prix ! En effet, le cinéaste ne
s'est toujours pas remis de ce traumatisme. Il enchaîne
ensuite trois films décevants où il tente maladroitement
de dompter sa folie créatrice. Ces projets, ambitieux
dans l'idée, furent des rendez-vous manqués.
A l'instar de Spielberg avec son navrant Hook, Gilliam
rate sa rencontre avec Le Baron de Münchausen.
Ce film reste étonnamment sage et statique, alors que
le spectateur n'aurait pas dû pouvoir souffler. Il est
exemplaire des stigmates post-Brazil. Le cinéaste
n'a de cesse de calmer le jeu, de conformer les scènes
entre elles, en bref de gommer ce qui faisait sa particularité.
Le célèbre baron se prêtait bien à
l'univers de l'ex-Monty Python, mais le scénario convenu
nous ramène sans cesse sur une scène de théâtre.
Le héros vieilli y compte ses aventures et tente de
retrouver ses anciens compagnons tous également usés.
La conclusion est la suivante : le baron est sympathique mais
gâteux, ne croyons pas trop son imagination débordante.
Adieu poésie et rêve, il ne reste plus qu'à
contempler décors et costumes empesés.
 |
|
|
|
Après avoir raté
cette adaptation qui ne semblait pouvoir être réalisée
que par lui, Gilliam ne réussit pas plus sa rencontre
avec Robin Williams. Cependant, Fisher king montre
que le réalisateur est peut-être conscient du
problème. Il y entreprend donc une sorte de psychanalyse.
Dans lequel de ses deux héros se reconnaît il
: l'animateur radio cynique et désabusé ou le
joyeux illuminé noyé dans ses chimères
? En fait, on a plutôt l'impression d'assister à
un conflit entre le Ça et le Surmoi du réalisateur.
Robin Williams incarnerait la folie douce à laquelle
Gilliam n'aurait pas totalement renoncé, et Jeff Bridges
l'amertume qui l'envahit suite aux problèmes rencontrés
sur Brazil. Cette opposition se conclura sur un statu
quo : le malade sera réadapté à la société,
et le cynique se laissera aller à des élans
de fantaisie.
Cette conclusion est malheureusement faussée par un
traitement formel assez terne. Finalement Gilliam met paresseusement
en scène un scénario hollywoodien convenu dont
la morale se rapproche de Dead poet's society: "profite
du jour présent" mais reste sage.
Le cinéaste a laissé passer cinq ans avant de
réaliser 12 monkeys. Ce dernier ne correspond
pas à ce qu'on attendait. Dans le meilleur des cas
ce suspens futuriste, adapté de La jetée
de Chris Marker, aurait dû lui permettre de retrouver
son sens du délire et du visuel flamboyant. Au pire,
on pouvait craindre que Gilliam ne devienne qu'un sous-Spielberg
ne vivant plus que sur sa réputation. En réalité,
12 monkeys poursuit la réflexion amorcée
par Fisher king.
|