Retour sur l'oeuvre de Fritz Lang à l'occasion de la
sortie, chez Opening Edition, d'un coffret triple DVD, dans
lequel, en plus des films M. le maudit et Le Testament du Dr.
Mabuse, vous pouvez découvrir dans un troisième
DVD dédié aux bonus, le documentaire Fritz Lang
le cercle du destin de Jorge Dana (55 min), l'analyse de M le
Maudit Image par image par Radha-Rajen Jaganathen (40 min),
l'entretien avec Noël Simsolo et Alfred Eibel (réalisation
Dreamlight) et les décors de Emil Hasler. |
|
....................................................................
|
|
L'écran pose doublement problème chez Fritz
Lang. D'abord, il peut se définir par un enchaînement de plans
inclus dans une forme ou un motif, sans jamais faire apparaître
de projection, ni d'écran au sens premier. Ensuite, il fait
part d'une dualité complexe, il faut parcourir son opacité
intérieure (du derrière), sans omettre sa réflexion
(au devant) de l'image. Que révèle l'écran : exhibe-t-il
autant la projection de l'image que sa capture ? Faire également
le voyage réflexif des écrans de contrôle au « cerveau-écran
», pour reprendre l'expression de Gilles Deleuze, permet de
différencier les raccords de plan et ceux d'ordre sémantique;
afin de synthétiser les stades terminaux de l'image, de la
pulsion humaine au règne de l'image par l'écran,ou inversement,
de la puissance acquise par l'écran de contrôle aux sens psychiques
qui en résultent.
| |
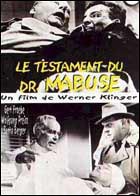 |
|
|
L'écran ne renferme pas une image close
mais souvent une image exhibant un agencement de plans. Dans
Le Testament du Dr Mabuse, la photo d'identité devient
écran avec image animée, écran en abyme dans l'écran initial,
mettant fin à la fixité du moment et délivrant le mouvement
arrêté dans l'image photographique. Le passage de l'image
fixe à l'image en mouvement s'effectue d'une photo en insert
(fixité) à un devenir-personnage acquis par l'écran (qui délivre
le mouvement). L'écran permet le raccord filmique en joignant
l'arrêt sur image, la photo arrêtée, au mouvement même de
l'homme photographié. L'écran assure alors l'intervalle invisible,
le battement des plans (la scansion) au sein ici d'un montage
hybride alliant photographie et plan mouvant de cinéma.
Aussi, l'écran n'est pas une surface ouverte
mais une suite d'images-écrans (de cadres ou de portraits)
agencée en fondus enchaînés. Ce qui est incrusté dans l'écran
(l'image d’un tableau provenant de Dellarowe Galleries)
naît par une succession de fondus enchaînés. Dans La Rue
rouge, Chris Cross regarde un prospectus dune galerie
d'art : les tableaux se suivent et se superposent, le prospectus
faisant écran en opérant par fondu et en raccordant les tableaux
dans un montage serré de plans fixes. Tel système délivré
par le prospectus, sert d'écran par le défilement des tableaux
; il fait également le travail des raccords en lieu et place
de Chris Cross.
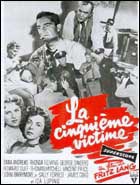 |
|
|
|
Mais « nous savons depuis André Bazin que
l'écran de cinéma ne fonctionne pas comme le cadre d’un tableau,
mais comme «un cache qui ne montre qu'une partie de
l'événement.» [1] Dans le prospectus comme
dans l'esprit de Chris Cross, le portrait qui faisait écran
l'a aveuglé. Auparavant, écran impliquait « protection ».
A la fin du film, « ce n'est pas un mur, un tableau » qui
lui révèle par « transparence » sa duperie, mais finalement
une « surface opaque » derrière laquelle « le réel afflue
», [2] derrière une vitre-écran lui révélant
toute l’illusion de son amour passé.
Par ailleurs, l'écran renferme un danger
qu'exhibe l'image. Au début de La Cinquième victime,
émerge un raccord entre le voyant et le support, l'écran,
qui acquiert ici un statut mortel. Kyne, responsable du célèbre
consortium Amos Kyne, regarde la télévision qui diffuse un
de ses propres programmes, lorsqu'il meurt soudainement, emporté
par une crise cardiaque. Il meurt à la naissance de l'image
: l'écran sert de miroir du pouvoir, reflet nuisible d'une
réussite apparente, rendue caduque par la représentation médiatique.
Tel message fait l'objet d'une représentation et d'une interception
mortelles dans la capture spectatorielle (Kyne) de l'image.
« Tout message fait l'objet d'une interception mortelle, tout
message est un message de mort » [3]. Qu'est-ce
qui est mortel : le pouvoir de l'écran (par réflexion), l'image
elle-même ou sa capture ? La projection est-elle généralement
obstruée par une interception du regard ?
|