Plonger dans les bandes-son de David
Lynch, c'est se confronter à une récurrence :
le désir de faire revivre le monde musical des années
50.
Combien sont-ils les
cinéastes qui ont su faire de la bande-son un élément
dramatique de leur oeuvre, un réel facteur structurel,
un pendant de l'image ? Jetons les noms : Jarmusch,
Hitchcock, Wenders, Godard, Lynch, pour une large part et
quelques autres dans une certaine mesure, Tati, Kurozawa,
Minelli, avec en vis-à-vis des films emblématiques
de la question, Ghostdog, Der Himmel über Berlin,
Mon oncle, The Bandwagon, Histoires du Cinéma
et bien d'autres qui seraient du plus bel effet dans une
cinémathèque portative.
Chez Lynch, la question du son au cinéma
est cruciale sinon décisive, pour toute une partie
de ce qui a déjà été fait au
cinéma, mais aussi pour ce qui reste à faire.
Dès Eraserhead, il impose une démarche
sonore qui à l'époque déjà était
plus proche des expériences de musique expérimentale
que de l'habillage musicale dont Hollywood avait posé
les canons. Aujourd'hui seuls peut-être les frères
Quay restent dans leurs productions, familiers de l'esprit
qui animait alors Eraserhead.
| |
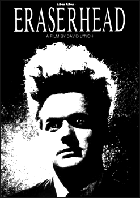 |
|
|
Ce qui frappe dans Eraserhead et qui
reste à jamais comme une empreinte, c'est le murmure
incessant de l'usine, fond sonore basse fréquence,
qu'on retrouvera plus tard - ce que Lynch lui-même
appellera drones (parasites, bourdonnements, bruitages)
envahissant tous ses films ultérieurs. Le plus souvent
les drones apparaissent pour donner l'impression que des
choses insoupçonnées s'agitent en profondeur
sous les apparences : c'est le grouillement d'insectes
sous le gazon du début de Blue Velvet, le
surgissement du visage blanc du Mystery Man sur le visage
de Patricia Arquette dans Lost Highway, ou de manière
magistrale, l'effroi provoqué par l'apparition du
clochard au visage noirci derrière le mur dans Mulholland
Drive. Dans cette séquence où un homme
revit son cauchemar dans la réalité, Lynch
utilise une lente progression sourde de cordes et de percussions
qui mène à un climax très bref, sorte
de torsion du tissu orchestrale, qui plaquée sur
l'image furtive du visage déploie toute l'angoisse
et l'effet de terreur voulus, sans pour autant user de l'artillerie
lourde propre au cinéma d'épouvante. Chez
Lynch au contraire, l'épouvante naît souvent
du mariage intime entre une matière sonore traitée
à l'économie, vrillée de crépitements
sourds, de fréquences graves et légèrement
saturées, et d'une image archi simple malgré
son luxe et son apprêt lustré voire glacé.
Il faut dire qu'il a su trouvé en Badalamenti l'orchestrateur
idéal pour mettre en musique ses lumières
et sa photo ultra sophistiquées. Comme si l'image
de Lynch, faite d'espaces réglés au cordeau,
au décorum si policé (presque jusqu'au design)
trouvait dans les séquences aérées
de Badalamenti sa meilleure mise en perspective. En dehors
des drones dont Lynch s'arroge seul la réalisation,
la bande-son lynchéenne repose sur des plages orchestrales
au classicisme fantasmé ou les restes d'un Jazz post-moderne
vaguement cosmétique, tous composées par Badalamenti.
Dans Mulholland Drive, le thème
central aux accents malhériens est le thème
de Rita, la face sombre du film, alors que celui de Betty,
éclairé et radieux comporte malgré
tout la touche de désespoir qui est la marque de
sa nécessaire déchéance.
Car chez Lynch, la perte, la chute et le néant, ne
sont jamais bien loin, au détour d'un angle de mur,
d'une arabesque de cordes ou d'une bossa de Jobim (voir
Lost Highway). C'est le cas dans Twin Peaks
où le thème de Laura Palmer était déjà
grevé de tous les malheurs en souffrance. Lynch reste
ainsi fidèle à une vieille conception qui
tient autant de l'opéra que du cinéma, celle
d'associer à des personnages forts leur propre thème
musical. Il inscrit ainsi la musique au cœur même
du drame. Combinant travail sonore et plages musicales,
il peut utiliser ainsi le son comme il le désire,
agissant directement sur la mémoire du spectateur
et créant une mémoire collective et mythique.
|