 |
|
|
|
Car l'une des choses les plus importantes
sans doute dans le travail sonore des films de Lynch, c'est
la présence quasi permanente des signes d'une mémoire
perdue du monde musical des années 50. Ses meilleurs
films sont traversés par ces éclairs, ces
réminiscences d'un Eden oublié du rock'n roll
où dorment les fantômes de Buddy Holly, Sam
Boy Williamson, Eddie Cochran ou même Jimmie Rodgers.
Comme un signe de reconnaissance qui serait autant un signe
de ralliement, c'est le son cristallin et sur-réverbéré
d'une guitare Guild (ou Gretsch on ne sait pas trop) qui
revient comme un vieux rêve glorieux dans beaucoup
de films (c'est d'ailleurs souvent Lynch qui tient lui-même
le manche). Ces pretty fifties qu'il a sans doute
tellement aimées, alors qu'il n'était pas
en âge de les comprendre, elles reviennent à
travers des bribes de musiques, un son, pur et débauché
à la fois, qu'on retrouve dans des vieux standards
que Judy Garland devait chanter entre deux milk-shakes.
Ces fifties sont comme le rêve éveillé
d'une Amérique toujours perdue dans les souvenirs
bon marchés de son adolescence, Amérique des
coffe-shop, des disques Sun, du western, des drive-in et
des Tucker. Quand John Waters n'y voit que le grotesque
de l'apparat cachant le vide et la médiocrité,
David Lynch, lui, y voit une raison de désespérer
du présent, une terre promise irriguée par
le rêve et la fiction. Les fifties avec leur
phosphorescente brillance, leur musicalité débridée,
leur absence de goût élevé au rang d'art
suprême, sont le matériau mnésique essentiel
de ses films : dans Sailor et Lula la clé
finale du film c'est l'histoire du magicien d'Oz ;
dans Blue Velvet c'est une chanson ; un film
sur les années 50 dans Mulholland Drive.
Mais qu'on ne s'y trompe pas. Cette présence
des fifties n'est jamais une reconstitution objective ;
si elle est fidèle, c'est seulement à l'image
que l'ado Lynch s'en est faite dans son musée imaginaire.
Ses pretty fifties nous sont projetées à
travers son prisme déformant. Les rock'n roll et
jazz urbains façon art-déco qui traversent
ses bande-sons restent des projections mentales, des fantasmes
de jazz et de rock fuselés par Badalamenti qui sait
fort bien retourner une mélodie pour en extraire
l' aspect weird cher au réalisateur.
Pour exemples : le thème de Rita est joué
par un orchestre philharmonique (de la ville de Prague)
mais le traitement sonore est tel qu'on croirait entendre
des nappes de synthé. Comme si Badalamenti cherchait
à donner à l'orchestre le côté
lisse et coruscant propre aux cordes numériques,
cet aspect recolorisé qui n'est pas sans lien avec
la dimension un peu cheap de certain de ses thèmes.
Qu'on se souvienne du thème de Twin Peaks,
avec son anatole (cadence ultra-classique d'accords) tout
droit sorti d'une ballade rock'ab : il produit toujours
son effet nostalgique, car il contient déjà
en lui-même cette nostalgie qui le fait tenir et ne
le laisse pas sombrer dans la pire guimauve. C'est une nostalgie
d'une époque perdue dont les vestiges ne sont plus
que des signes vaguement collectifs, vaguement identifiables
: hairspray et moleskine, juke box et college attitude.
| |
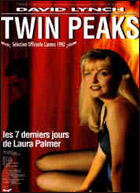 |
|
|
On sait que tout Twin Peaks (comme
presque tout Lynch) repose sur le chiasme de l'ombre dans
la pleine lumière : Laura Palmer, jolie ado
adulée, miss Twin Peaks, était en fait rongée
de vices et de douleurs. Dans le fabuleux Blue Velvet,
la petite ville provinciale, ensoleillée et doucereuse,
abrite sans le savoir le pire des sadismes et la terreur.
On retrouve bien sûr tout ça dans la musique
qui est toujours à la limite de basculer. Son apparente
innocence cache bien plutôt une agitation inconsciente.
A ce titre l'utilisation faite dans Mulholland Drive
d'un standard de la musique américaine, I've told
every little star de Kern et Hammerstein, littéralement
massacré par Linda Scott, dans une version drugstore
song façon sucre candi, est significative de l'importance
que Lynch donne à chacune des musiques utilisées :
ici, la chanson sert à un casting pour un film sur
les années 50. La séquence est l'un des nombreux
points nodaux d'un film à multiple entrées :
la blonde Betty, à qui l'on offre la possibilité
de passer le casting, part du studio pour porter secours
à la brune Rita. Ce faisant, elle échappe
à l'un de ses destins possibles, au profit d'un autre
qui s'avèrera fatal.
Dans sa recherche de la bande-son parfaite, David Lynch
affronte directement ses fantômes, c'est-à-dire
tous ses rêves d'enfant ; la musique parle immédiatement
à l'âme ; elle permet d'évoquer
des sensations et des idées, jusqu'à parfois
vous faire regretter une époque et un monde que vous
n'avez pas connu ; ce que le visuel aura plus de mal
à faire, étant plus frontal.
Serge Daney disait en parlant de Nostalgia,
que Tarkovski réussissait à nous parler depuis
un Moyen-Âge improbable, un temps du rêve en
quelque sorte. Si aujourd'hui Lynch est un grand cinéaste,
c'est qu'il est le seul à recréer de toutes
pièces un réel impossible, mais aussi par
la musique et le son, à le faire réellement
exister.
On pourrait en définitive voir dans son obsession
de la musique des fifties qui taraude son œuvre
comme une taupe sous la terre creuse des galeries, une volonté
de nous faire croire en un monde du rêve animé
du désir de retrouver une origine perdue, un monde
du souvenir réactivé par la fiction, un monde
de l'art en somme.