Déambulations markeriennes autour
de :
Le Tombeau d’Alexandre (Chris. Marker,
1993), projeté le 9 décembre 2001 dans le cadre
de la programmation " La lettre au cinéma ",
organisée par l’association Documentaires sur grand
écran au Cinéma des cinéastes (Paris
XVII), du 7 octobre au 30 décembre 2001. (*)
Chris Marker, écrivain multimédia
ou Voyage à travers les médias, ouvrage
de Guy Gauthier paru chez L’Harmattan, 2001. (**)
|
|
....................................................................
|
|
Une fois de plus ce soir-là, au Cinéma
des cinéastes (Paris XVII), nous étions quelques
dizaines entassés à attendre en silence, devant
la salle. Venus seuls ou à deux, dans une sorte de
recueillement, nous tentions de ronger notre impatience en
apprêtant nos yeux, en préparant notre écoute,
en affûtant notre perception. D’où vient cette
impression étrange, chaque fois, qu’une projection
d’un film de Chris. Marker commence toujours en retard ?
L’arrivée prématurée de la plupart des
spectateurs peut-être, mus par la peur de ne pouvoir
participer au rite. Et puis surtout, sans doute, l’espoir
confus, secret au fond de chacun, que ce soir peut-être
et malgré l’invisibilité éternelle dont
il s’est fait principe, il pourrait être là.
Du coup, on s’était
mis discrètement à chercher du regard dans la
file, un vieil homme mystérieux qui pouvait avoir dans
les 80 ans. Pour ma part, je ne l’ai pas trouvé et
j’ai dû me résigner à assister sans plus
de joie, pour la deuxième fois, à cette merveille
d’épître que l’association Documentaires sur
grand écran avait eu le bonheur de programmer dans
le cadre de sa rétrospective sur " La lettre
au cinéma "(*) : Le Tombeau d’Alexandre
(1993), film-icône, film-cantate, film-portrait que
Marker avait dédié à son ami le cinéaste
soviétique Alexandre Medvedkine, disparu quatre ans
plus tôt.
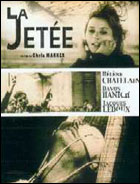 |
|
|
|
En fait de missives, Marker
pour cette fois-ci ne s’était pas privé. En
un seul film, il avait réussi à en adresser
six à son vieil ami russe, au cours desquelles il retraçait
l’histoire des expériences artistiques follement ambitieuses,
puis rapidement mises sous l’éteignoir, que l’Union
soviétique avait suscitées puis avortées
au cours des sept décennies de son existence. Aux côtés
des Eisenstein, Chostakovitch et autres Meyerhold, Medvedkine
y avait pris sa part, en sillonnant notamment les vastes provinces
soviétiques muni d’une caméra. Embarqué
dans un train dont les wagons avaient été transformés
en salles de montage et de projection, il en enregistrait
toute la diversité des paysages et des visages sur
pellicule. Puis, dans un geste démesuré où
l’image joue un rôle d’unification politique, il allait
montrer ses films aux populations les plus pauvres et les
plus éloignées de l’Union.
Comme à son habitude,
Marker racontait là l’espérance folle et la
liberté nées des nouvelles expériences
politiques, à jamais symbolisées sans doute
par l’image des " mains fragiles "
que des étudiants latino-américains brandissent
au début du Fond de l’air est rouge (1977).
Comme à son habitude, il évoquait aussi les
nouveaux horizons de pensée qu’ouvre toute expérience
inédite d’écriture artistique ; lui qui
avait vu, dès 1982 dans Sans soleil, en le graffiti
électronique " une écriture dont
chacun pourra se servir pour établir sa propre liste
de ce qui fait battre le cœur " ; lui qui
parlait de l’aide fournie à l’espèce humaine
par la machine électronique comme du " seul
plan qui offre un avenir à l’intelligence ".
|