SYNOPSIS :
Un artiste peint le portrait de sa
mère. Un metteur en scène réalise le film
de sa vie. Un adolescent passe la douane. Une jeune femme veut
comprendre comment son père a disparu. Une conférencière
se sert de l'Histoire pour oublier la sienne. Un acteur interprète
un " méchant " sans en mesurer les conséquences.
Une seule histoire les réunit : celle de l'Arménie.
|
|
....................................................................
|
|
L’IRRECONCILIATION :
AGHTAMAR TORONTO ALLER ET RETOUR
FILM POLITIQUE,
FILM COLLECTIF ?
| |
 |
|
|
L’Ararat n’est pas
seulement une montagne aux confins du Caucase ; il est
aussi repère pour la tradition biblique, et, à
l’instar de Jérusalem, lieu de mémoire de tout
un peuple – les Arméniens - qui dans sa grande majorité
ne le vit jamais sinon en images. Ararat, le film,
n’est pas seulement un film, c’est aussi un objet ou un geste
politique. Ce statut étrange sera pour beaucoup dans
la possible tiédeur, ou le malaise, qui entoureront
sa réception. Mais précisément, le film
donne à voir cette difficulté, il la prend même
pour objet. Ararat n’est pas exactement le film sur
le génocide arménien, il questionne la possibilité
même de parler du génocide arménien, et
plus généralement, de faire avec ce génocide,
dont le destin étrange est d’avoir attendu quatre vingts
ans pour commencer péniblement d’être reconnu.
On ne saurait dans ces conditions l’appréhender comme
on appréhende un film ordinaire. D’autant que sa facture
n’est aucunement classique. Atom Egoyan est réalisateur,
canadien, et de ces cinéastes dont on dit qu’ils sont
" auteurs ", en entendant par ce mot aussi
bien une liberté envers la production cinématographique
comme technique de divertissement, qu’une exigence envers
soi-même. Il signe là le septième film
d’une carrière déjà pleinement reconnue.
Impossible toutefois d’oublier – et lui le premier – qu’il
filme en tant qu’Arménien ce qui est et est attendu
comme le premier film " sur " le génocide
par un réalisateur important. Il a toute une diaspora
avec ou derrière lui. L’individualité de l’auteur
se double ici d’une sorte de sujet collectif, ou de collectif
en lui, qui relève aussi bien de l’héritage
que du communautaire. Ceci nous demande donc de trouver pour
ce film une modalité de réception quelque peu
distincte de celle que nous adoptons devant d’autres œuvres
d’Egoyan, ou simplement lorsque nous sommes au cinéma.
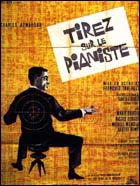 |
|
|
|
Sachant que ce n’est plus exactement
là œuvre personnelle, l’auteur mobilise ici des figures
arméniennes internationalement connues, et leur donne
des rôles proches de ce qu’ils sont : Aznavour
bien sûr, en réalisateur arménien consacrant
au génocide – comme Egoyan lui-même – son dernier
opus (au passage, le chanteur reprend le nom que lui avait
donné Truffaut dans Tirez sur le pianiste, cet
" Edouard Saroyan " dont le patronyme
est déjà celui du plus célèbre
écrivain arménien américain) ; le
comédien Simon Abkarian, qui joue un acteur… Et de
manière différente, Arshile Gorky, cet immense
peintre new-yorkais, maître de Jackson Pollock et à
qui l’abstraction en peinture dut certaines de ces nouvelles
voies - Gorky, évoqué par le " film
dans le film ", qui survécut à l’insurrection
de la ville de Van et finit par se suicider en Amérique,
après avoir achevé une toile figurative le représentant
enfant avec sa mère.
La force du film consiste à donner à voir sur
l’écran les effets du génocide des Arméniens
et de son absence de reconnaissance. Le " film dans
le film ", cet Ararat dont des mouvements
de caméra soulignent toujours qu’il n’est qu’un film
en s’arrêtant, après chaque prise, sur les techniciens
et la caméra qui la filment – est ici le catalyseur
de ces multiples effets. Ce qui en est fait, ce qui se dit
autour de ce film imaginaire, représente, dans le film
d’Egoyan, la difficulté politique qu’a ce film réel
à se faire, à se dire, et à être
perçu.
|