|
 |
|
|
|
Il apparaîtrait plutôt
que le film puise ses ultimes ressources du côté
du cinéma de Robert Bresson. Un dispositif carcéral
organisant la communication entre le détenu (Dagang)
et celle qui vient le voir (Yanli) se réfère
explicitement à la fin grillagée de Pickpocket
(et Xiao Wu de Jia Zhang-Ke rendait un bel et
justifié hommage à cette œuvre matricielle de
la modernité cinématographique), et on pourrait
très bien imaginer le premier dire à la seconde :
" Yanli, quel étrange chemin j’ai dû
faire pour arriver jusqu’à toi ". C’est enfin
le moment où un car de police, après avoir ramassé
des prostituées (sûrement dénoncées)
dont fait partie Yanli, les débarque devant un fourgon
blindé : on pense inévitablement à
une séquence similaire de L’Argent du même
auteur. L’évasion n’étant pas à l’ordre
du jour, son corollaire immédiat, l’incarcération,
est le motif formel secret du film. Cette lampe que regarde
Dagang, hors-champ et haletant au début du film, n’est
pas si éloignée du peu de lumière filtrée
par la lourde porte du fourgon que regarde la jeune femme
tabassée à l’instar de ses collègues
(on songe alors à la fin du Cercle de Jafar
Panahi). De la Chine, on n’en sort pas comme ça. Encore
quelques gags ou situations cocasses (la prostituée
ramenant chez Dagang des clients racolés pour récolter
l’argent nécessaire à leur ménage insolite,
ce dernier en profitant pour crever les pneus de leur vélo
et faire ainsi plus de bénéfices) qui peuvent
dériver vers des significations plus ambiguës,
imbriquant sexe et politique (Dagang avec sa pompe à
vélo, Yanli avec sa bouche enflée " à
force d’avoir trop sucé " comme le disait
en rigolant Si-De, Dagang encore dans son lit et qui haletait
sûrement parce qu’étant au chômage, son
inoccupation le portait naturellement à se masturber),
mais il faut un coup de force final (une image figée,
plus fantasmée que réaliste) pour que le film
puisse finir bien : le bébé ne sera plus
abandonné, quoi qu’il arrive, il retombera toujours
sur ses pattes, sur quelqu’un qui le connaît (Dagang,
devenu maître-étalon, valeur précieuse
de l’humanité).
| |
 |
|
|
L’Orphelin d’Anyang
ou le cinéma rattrapé par ce qui le travaille
au ventre. L’équation (double) est la suivante :
le bébé dans le film, c’est le cinéma
enceint du réel, gros d’une pâte organique contractant
à l’extrême la vie, et dont il faut s’occuper ;
le film sur nos écrans, c’est notre réalité
affectée par l’actualité du film, c’est un réel
ignoré qui accouche d’un beau film de cinéma
qui nous a rattrapé. A temps. Nous tombions sans nous
en apercevoir à force de lorgner du côté
de nos cinématographies (et Hollywood est l’une d’entre
elles, naguère privilégiée) vaguement
essoufflées, alors que c’est (encore) à l’Est
(très, très loin vers l’Est : l’Iran, Taiwan
et Hong Kong hier, la Chine populaire aujourd’hui, la Corée
n’en est encore qu’aux prémisses et se fait attendre)
que ça se passe, que le cinéma, ce vieux rêve,
bouge encore un peu. Et l’on préfèrera cette
fois-ci quand il vagit que quand il maugrée ou ratiocine.
Un vieux titre hollywoodien ne nous avait pourtant pas trompé,
et à plusieurs titres, on lui donnera valeur de prophétie :
" A l’Ouest, rien de nouveau ".
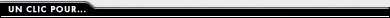 |
|
|
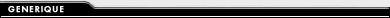 |
|
Titre : L'Orphelin d'Anyang
Titre VO : Anyang
de yinger
Réalisateur :
Wang Chao
Scénariste :
Wang Chao
D'après l’œuvre de :
Wang Chao
Acteurs : Zhue
Jie, Sun Gui Lin, Yue Sen Yi
Directeur de la photographie :
Zhang Xi
Monteur : Wang
Chao
Son : Wang Yu
Directeur artistique :
Li Gang
Producteur associé :
Wang Yu
Producteur : Li
Fang, Wang Chao
Distribution :
Les Films du Paradoxe
Presse : Thierry
Lenouvel - Séverine Roinssard
Festival : Quinzaine
des réalisateurs (Cannes 2001), Belfort
2001(Grand prix du film étranger)
Sortie France : 13 Mars
2002
Durée : 1h 24
Année :
2001
Pays : Chine
|
|
|