A l'occasion du cycle Le tour de
Boris Lehman en 80 bobines, qui aura lieu du 19 mars au 7
avril 2003 à Beaubourg, durant lequel notamment il
commentera en direct tous ses inédits et films. Boris
Lehman y présentera également le travail de
ses amis et proches, de Beckett à Varda, en une quinzaine
de films choisis par lui. Enfin, pour parachever le tour du
cinéaste, on pourra également le voir jouer
dans quelques films de Samy Szlingerbaum, Marie André,
Christel Milhavet…
Zakhor ! / Souviens-toi !
Deutéronome
Sois fidèle jusqu’à la mort
Apocalypse, II, 10
" La société s’emploie
à assagir la Photographie, à tempérer
la folie qui menace sans cesse d’exploser au visage de qui
la regarde. Pour cela, elle a à sa disposition deux
moyens. Le premier consiste à faire de la Photographie
un art, car aucun art n’est fou (…) L’autre moyen d’assagir
la Photographie, c’est de la généraliser, de
la grégariser, de la banaliser, au point qu’il n’y
ait plus en face d’elle aucune autre image à laquelle
elle puisse se marquer, affirmer sa spécialité,
son scandale, sa folie (…) Telles sont les deux voies de la
Photographie. A moi de choisir, de soumettre son spectacle
au code civilisé des illusions parfaites, ou d’affronter
en elle le réveil de l’intraitable réalité "
Roland Barthes, La chambre claire, Cahiers du Cinéma,
Gallimard Seuil, 1980
|
|
| |
 |
|
|
Drôle de petit bonhomme,
classant, déclassant follement, marchant, démarchant
sans relâche ni éreintement. A la voix sûr,
au timbre doux (d’une douceur presque enfantine), au nez aquilin,
au regard perçant, à la silhouette tranquille :
Boris Lehman, avant d’incarner l’une des démarches
cinématographiques contemporaines parmi les plus stimulantes
à observer et penser, est d’abord un corps remarquable
et attachant auquel manque (mais il n’est pas le seul) terriblement
(ça fait déjà moins de monde) l’image
originelle d’entre toutes, celle de sa venue au monde avalisant
(parce que Lehman se trouve être proche philosophiquement
de Heidegger) son " être-pour-la-mort ".
C’est donc aussi l’autre image déjà manquante,
la seule qu’il est certain de ne jamais voir de ses propres
yeux, celle de " l’instant de sa mort "
(Maurice Blanchot). La question que pose implicitement Lehman est
celle-là : quel avenir pour ma mort ?
Conséquemment, parce qu’il ne veut rien perdre de sa
vie (ni une dent, ni un cheveu, ni une photographie de lui,
de ses amis, de gens qu’il ne connaît pas ou dont il
ne se souvient plus), parce que sa vie s’origine dans la mémoire
du Lager (ses parents ont été des rescapés
des Camps), Boris Lehman est devenu le mémorialiste
de sa propre existence fragmentée, démultipliée,
objectivée par la technique photographique. Son œuvre :
les archives mouvantes (littéralement il s’en imprègne
comme d’une eau régénératrice, véritablement
on aime s’y perdre) du Moi, son obsessionnelle récollection.
(1) Une psychanalyse extensive sans psychanalyste.
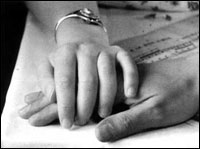 |
|
|
|
En quoi ce matériel
peut appeler de l’altérité, susciter de la communauté,
créer ou réactiver du lien ou du souvenir, rapprocher
du loin comme éloigner du près dans l’espace
comme dans le temps, c’est-à-dire produire du champ ?
Voilà les questions posées par les circulations
lehmaniennes de la vie qui se présente, à l’image
(de la vie) qui (la) représente. Mais il y a surtout
cette question-là, axiale, cruciale : en quoi
cette matérialisation du vécu (avec laquelle
le cinéaste se vêt, dont il se nourrit) qui ne
saurait mourir, que l’on ne saurait assassiner (encore des
images, toujours des images pour dire ce que l’on cherche
à réduire en cendres, en poussière, au
silence), peut entretenir cette vérité fondamentale,
à savoir que moi c’est tous les autres que moi en plus
de ce moi qui, photographiquement, à chaque tirage
photographique, devient toujours un autre ? L’éthique
du cinéaste, c’est un " Moi qui est un Nous ",
" un Nous qui est un Moi " car " la
conscience de soi atteint sa satisfaction seulement dans une
autre conscience de soi " (G. W. F. Hegel, La
Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier,
1992, vol.1, p.152-154).
Trouble de l’image : qui est sur
l’image ? C’est un peu de perte consubstantielle aux
mécanismes de la mémoire (la mort qui travaille)
qui ne demande qu’à être comblée par l’aide
d’un autre que moi : l’image réclame beaucoup
de choses sauf de l’extrême solitude. Jouissance de
l’image : celle de la reconnaissance. L’image interpelle,
fait parler, rend le mouvement interne à la parole
à la fixité ontologique de la photographie,
plongeant l’instant capturé au cœur de la durée
de laquelle la photographie l’avait précédemment
extrait. Paradoxe : Boris Lehman est un pur cinéaste
parce qu’il n’a besoin de l’image photographique que comme
inducteur de la parole charriant des souvenirs et des émotions,
des hésitations, des craintes et des tremblements que
le plan cinématographique, dans toute sa durée,
donne ou redonne à entendre et à lire dans les
plis du corps parlant. L’instance du je et l’instance du tu,
respectivement, échangent le jeu de leur flux réflexif.
L’image cinématographique comme saisie réactive
de l’affect pur vectorisé par la photographie. Rien
de moins narcissique qu’une telle attitude fondant le champ
de l’esthétique dans celui du social - qui, Lehman
l’a bien compris, est un corps - et visant à l’avènement
heureux d’un nous partagé.
|