LE RYTHME CINEMATOGRAPHIQUE
Nakano, Ecole militaire,
réalisé en 1966, est probablement le meilleur
film du prolifique Yasuzo Masumura ( né en 1924 ).
C’est aussi l’un des moins connus. Réalisé en
pleine vague des James Bond - série extrêmement
populaire au Japon, au point qu’un an plus tard On ne vit
que deux Fois y sera situé - le film en prend thématiquement,
mais aussi stylistiquement et rythmiquement, le contre-pied
total, en montrant l’aspect sinistre et cruel de l’espionnage
et de la formation des super-agents. Pour cette raison, il
me semble que le rythme " typiquement japonais "
du film (pour ce que cette expression creuse veut dire) n’est
pas seulement une marque de fabrique du réalisateur
et du style cinématographique de son pays, mais un
choix assumé pour d’autres raisons que celles du rythme
tout à fait comparable des films intimistes d’Ozu.
| |
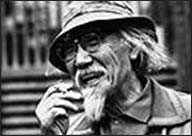 |
|
|
Masumura n’emploie pas seulement
ce rythme dit " japonais " de lenteur
solennelle des plans avec homogénéité
de leur durée (c’est à dire que " l’amplitude
temporelle " entre le plan le plus long et les plus
court n’est pas très élevée.) et mouvements
de caméra élégants - bref, ce rythme
contemplatif qu’on aime attribuer au cinéma japonais
" authentique " -, pour approfondir son
sujet, mais aussi pour contraster avec le caractère
mouvementé, ultra-dynamique, " léger "
des James Bond. D’où, peut-être aussi, le choix
du noir et blanc : à la même époque,
les polars parodiques, proches, dans l’esprit, de la série
britannique, bien que beaucoup plus nihilistes, de Seijun
Suzuki éclataient de mille couleurs criardes ;
ici par contre, on le voit, c’est du sérieux.
Contrairement à certaines
affirmations fallacieuses que d’imbéciles présentateurs
reprennent trop facilement à leur compte, Nakano,
Ecole militaire n’est pas un film divisible en deux parties
distinctes, une heure " documentaire "
et une demi-heure " fiction ". Sur le
plan du rythme, justement, ainsi que sur celui du ton, de
l’ambiance et de l’esthétique, il n’y a bien entendu
aucune césure. Masumura aurait été bien
peu fin de traiter la partie " mise en application
des principes énoncés auparavant ",
c’est-à-dire celle où, une fois formés,
les espions passent à l’action - la deuxième,
donc - de façon distincte de la première, ce
qui serait tout à fait contraire à la cohérence
de traitement de l’ensemble ainsi qu’à la conviction
de ne récolter que ce qu’on a semé (ici, donc :
on ne peut adopter la logique guerrière sans avoir
à aller jusqu’au bout). De bout en bout, le film est
donc, sur le plan du montage et de la durée des plans,
lent, hypnotique, avançant de façon mesurée
et d’autant plus claire, d’autant plus révélatrice.
Ce qui fait qu’on taxe ce film de froideur, c’est l’effacement
volontaire du réalisateur, qui, dans les moments légers
(la leçon de danse) comme dans les moments dramatiques
(les deux exécutions, l’arrestation de l’espion anglais),
ne se mêle pas de donner à ce qui se passe un
rythme qui viendrait à se superposer à son rythme
naturel. Si je me souviens bien, la musique est parfois très
entraînante, avec des connotations militaires dans l’orchestration
(percussions, cuivres), mais le montage ne suit pas, il a
son rythme propre, quasiment immuable.
|