Le 3 juin dernier, dans
la région de Nantes, un lycéen poignarde sa
petite amie et la tue. Aux policiers, il dit s’être
inspiré du film d’horreur à succès Scream
de Wes Craven. Sa motivation tenait à une forme d’expérience
existentielle : voir ce que cela fait de tuer. Affaire
d’autant plus troublante que ce n’est pas la première
fois que ce film est au centre de faits divers similaires.
| |
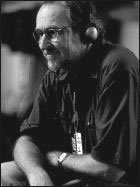 |
|
|
Voilà donc qui relance
le sempiternel débat sur la violence dans les médias
(et particulièrement au cinéma) et pourrait
apporter de sérieux arguments aux tenants de son influence
néfaste sur le (jeune) public. Il n’est pas difficile
de cerner l’enjeu du problème, considéré
comme problème de société dépassant
les limites des questions de cinéma : il réside
dans la question du passage à l’acte. Le spectacle
de la violence rend-il violent, favorise-t-il le passage à
l’agression dans la vie réelle ? C’est bien le
rapport de l’imaginaire, soumis à la mimesis (imitation
de la vie), et de la réalité qui est posé,
et qui se pose a vrai dire depuis fort longtemps en Occident,
depuis que l’homme fait des spectacles qui représentent
la réalité. Ainsi, dès l’époque
de la tragédie grecque, il est au cœur de la célèbre
théorie d’Aristote de la catharsis selon laquelle les
spectateurs évacuent leurs mauvaises passions dans
les spectacles tragiques et ne les accomplissent pas dans
la vie réelle. Soit dit en passant, il est notable
que pour Aristote, le spectacle de la violence n’a rien de
nocif, au contraire….
Aujourd’hui cette question est d’autant moins facile à
aborder qu’elle s’accompagne d’une grande confusion :
le débat est biaisé par un flou conceptuel et
terminologique. En effet, de quelle violence parle-t-on et
qui accuse-t-on vraiment ? La violence du cinéma,
de la télé, des jeux vidéos, des médias
de masse ? Autant d’éléments qui se recoupent
mais qu’on ne saurait confondre. C’est pourtant ce qu’on fait
allègrement, notamment une bonne partie de la presse
qui parle indistinctement du cinéma et de la télé
au sujet de Scream, film de cinéma, si celui-ci
est diffusé à la télévision. Par
commodité, certains parlent de la violence des écrans.
Quoiqu’il en soit, il y a un terrain commun, l’image, susceptible
d’être au centre des accusations.
 |
|
|
|
Pourtant, concernant le
fait divers évoqué plus haut, le cinéma
demeure l’objet majeur du soupçon. C’est en lui qu’il
faut voir la matrice de toutes les violences sur écran
(par exemple les jeux vidéos ultra-violents). L’accusation
faite au septième art de véhiculer, voire de
glorifier, la violence, n’est pas neuve et accompagne son
histoire. Peut-être que l’émotion cinématographique
primitive est chargée d’une violence telle qu’elle
a à voir avec l’effroi (l’arrivée d’un train
en gare de la Ciotat). Et on ne compte plus le nombre de films
à scandale : Scarface, Orange mécanique,
Massacre à la tronçonneuse, Réservoir
dogs, Baise moi, Irréversible etc. Plus profondément,
certains ont vu un lien consubstantiel du cinéma à
la violence en raison de son dispositif technique même ;
c’est la thèse de Walter Benjamin, exposée dans
l’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité
technique, pour qui le cinéma, en tant qu’art de
masse, accompagne et anticipe une violence de masse propre
à son temps, est coextensif à la guerre. Il
écrit notamment : " …l’aspect
distrayant du film a en premier lieu un caractère tactile,
en raison des changements de lieux et de plans qui assaillent
le spectateur comme des coups (…) le processus d’association
du spectateur qui regarde ces images est aussitôt interrompu
par leur métamorphose. C’est de là que vient
l’effet de choc exercé par le film qui comme tout choc
est amorti par une attention renforcée. Le cinéma
est la forme d’art qui correspond au lourd danger de mort
auquel doit faire face l’homme d’aujourd’hui ".
(Walter Benjamin, Œuvres III, L’œuvre d’art (première
version), folio-essais, Gallimard, 2000.)
|