Nous n’entrerons pas dans les polémiques et rumeurs
entourant les sorties reportées, la durée finale
et l’absence d’Elmer Bernstein comme compositeur du dernier
film de Martin Scorsese. Gangs of New York est surtout
une passionnante proposition audiovisuelle et marque une nouvelle
exploration des possibles pour la musique au cinéma.
Arrêts sur musique autour du film et retour sur les rapports
de Martin Scorsese avec la musique. |
|
....................................................................
|
| |
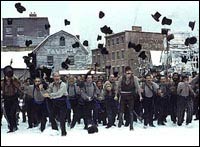 |
|
|
Gangs of New York
se déroule dans les années 1860. Scorsese, en
parfait contrebandier, n’hésite pas à employer
des musiques parfois volontairement " anachroniques "
avec le récit du film, en compagnie de musiciens aussi
divers que Peter Gabriel (déjà compositeur sur
The last temptation of Christ, Scorsese 1988), Afro
Celt Sound System, Howard Shore (compositeur sur After
Hours, Scorsese 1985), U2 ou Jocelyn Pook (à qui
l’on doit quelques musiques mémorables dans Eyes
Wide Shut, Kubrick 1999). Ces musiques contemporaines
offrent indéniablement une autre profondeur de champ
émotionnelle à Gangs of New York.
Si visuellement le nouveau film de Scorsese se compose et
se décompose en savants arrière-plans (souvent
eux-mêmes à " double-fond ") et en
perspectives astucieuses, la musique du film, elle aussi,
prolonge l’impression d’un espace à multiples tiroirs.
Un espace musical fait de plusieurs " arrière-salles
", de plusieurs couleurs et tempos, relie ici, par des
orchestrations résolument " post-modernes ",
le New York des années 1860, les luttes intestines
entre immigrants et natifs, au New York d’aujourd’hui…hélas
tout aussi agité. Dans The Age of Innocence
(1993), Scorsese avait convoqué de célèbres
musiques viennoises allées avec la musique originale
et élégante d’Elmer Bernstein. Mais le cinéaste
new-yorkais déploie dans Gangs of New York un
éclectisme musical beaucoup plus dur et fouillé
- allant de musiques irlandaises et de musiques de cabaret
à des effets synthétiques " clipesques
" et compositions " opératiques. " (1)
 |
|
|
|
Encore une fois, la
part " d’anachronisme musical " (à première
vue) dans Gangs of New York appelle à la profondeur,
à ce qui est derrière (ana - "en arrière") ,
mais aussi à ce qui est projeté en avant (métachronisme)
telle l’image de fin annonçant le futur Manhattan,
et tel, en un sens, cette porte au tout début du film
s’ouvrant violemment d’une caverne cacophonique vers une cité
paradoxalement silencieuse. Un mouvement en avant que les
protagonistes auront du mal à réguler - rappelant
les explications mêmes du réalisateur au sujet
d’un de ses films majeurs :
" Dans Goodfellas [1990], la musique
fait partie intégrante de l'environnement des
personnages, elle fait même partie de ce perpétuel
mouvement en avant qui finit par devenir incontrôlable.
" (2)
Dans Gangs of New York, la musique pousse en avant,
projette, et fait aussi partie intégrante de l’environnement
des protagonistes alors même qu’il y a parfois anachronismes,
" confusion de dates, attribution à une époque
de ce qui appartient à une autre. " (cf. Grand
Robert). Mais c’est bien la confusion que Scorsese traque
dans son film, confusion des musiques et des sentiments, confusion
des origines, des races et même des sexes. La confusion
des combats raciaux et des dominations politico-économiques
n’a au fond, nous dit-il, pas changé depuis les années
1860 à aujourd’hui. Ces guerres confuses à New
York entre des peuples opposés, d’hier au 11 septembre
2001, semblent inextricablement liées. Les musiques
ici sont des luttes, et sont mêlées au sang.
|