 |
|
|
|
La force du premier
film de Yamina Bachir-Chouikh réside dans sa puissance
formelle où à chaque instant la cinéaste
fait se bifurquer le récit. A la fois pour éprouver
tous les ressorts narratifs au nom de la sincérité
(scène inoubliable de la mère silencieuse berçant
du bout de l’orteil son bébé tenu par une nacelle
alors que son mari épicier, silencieusement, rejoint
les terroristes intégristes) mais aussi pour rendre
sensible une politique du corps. Rachida est un film
de la modernité cinématographique, à
savoir celle qui, à hauteur de visage, questionne le
rapport au monde. Il emprunte à la fois les chemins
du réalisme (Alger et ses rues), du suspens (la peur
innerve le récit filmique dans sa seconde moitié)
de la poésie (la gamine et la lune) où sans
cesse le regard de la cinéaste joue la dualité
(le grave et le léger, le burlesque et le tragique,
la tension et le calme)
Plan rapproché sur une bouche qui se couvre de rouge
brillant. L’essentiel se dit dans ce plan d’ouverture où
une femme séduisante nous dit sa singularité
tout comme sa liberté. Le cinéma a toujours
aimé filmer des corps en mouvement, éminemment
beaux (tout Hollywood) et celui-ci rejoint l’universel lorsqu’il
laisse s’échapper une singularité signifiante.
Borzage plutôt que Hathaway, Cassavetes plutôt
que Spielberg. Beauté fatale et liberté de parole
d’une enseignante d’Alger, le rouge sur ses lèvres
promesse de vie et de baisers qui ne viennent jamais. Entourée
de jeunes hommes sur son chemin à travers la casbah,
Rachida comme on pouvait le croire et l’espérer (naïveté
romantique) ne sera pas draguée ni même interpellée
sur sa beauté. De même, ce jeune homme qui la
suivait chaque jour n’était pas non plus un amoureux
transi. Il n’y a plus place à la romance, elle n’est
même pas envisageable et cela rend compte, me semble-t-il,
d’une vraie tragédie. Rachida le paiera dans son corps.
Refusant de poser une bombe dans son école, ces même
jeunes hommes qu’elle connaît et qui ont son âge
vont froidement l’abattre au ventre.
| |
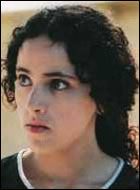 |
|
|
Lorsqu’un homme en
arrive à tuer une femme au lieu de l’embrasser, quelque
chose de terrifiant a lieu. De ce traumatisme inouï,
incommensurable (nos fils qui tuent nos filles, leurs sœurs,
leurs mères) Yamina Bachir-Chouikh tisse les liens
de la vie comme de la mort : la faillite des pères
qui ne peuvent accepter que leur fille soit violée,
le silence absolu de la communauté repliée sur
ses terreurs, l’inaction forcée d’une jeunesse éperdue
de vie, l’exclusion des femmes divorcées. Rachida et
non Karim ou Omar. C’est bien de la femme, la sœur, l’épouse,
la fille dont il est question. Questionner la femme, cela
peut paraître désuet, comique ou déplacé
sous nos contrées occidentales mais que répondre
à la douleur et à l’humiliation de l’homme,
ce père qui ne se reconnaît plus dans le regard
de sa fille souillée ? Il proclame la vouloir
morte pour ne pas subir la honte et la caméra s’attarde
avec sensibilité sur ce petit homme (comme échappé
d’un film de Pagnol ave sa casquette). Cette attention sur
le dos de cet homme qui s’éloigne est tout à
l’honneur de la cinéaste permettant à tout un
chacun d’éprouver la complexité humaine sans
le discours attendu d’une idéologie prétendument
égalitaire. Mais surtout Rachida raconte la
peur de tout un chacun et le film entier se vit sous la menace
d’une autre catastrophe, d’un autre attentat. Dans cette suspension
du souffle, le film me bouleverse, car, de ce qui se noue
et rejoint nos terreurs enfantines (la mort de nos parents)
de la compassion se dit. Où il y a à souffrir
avec et peut-être comprendre une histoire de notre Algérie.
" Notre ", car de France, ne peut se légitimer,
qu’une parole du lien.
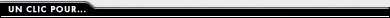 |
|
|
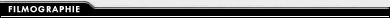 |
|
2002 Rachida
avec Ibtissem Djouadi, Bahia Rachedi
|
|
|