SYNOPSIS :
Le titre du film de Michael Moore
s’inspire d’un fait divers réel. Les deux adolescents
qui, en 1999, massacrèrent 13 personnes avant de se suicider
à la Columbine High School. Bowling for Columbine est
une critique cinglante, acerbe, dévastatrice de l’industrie
de l’armement, de l’usage des armes et du droit constitutionnel
qu’à tout citoyen américain d’en posséder.
C’est aussi le portrait désopilant d’un pays au lendemain
du 11 septembre. |
|
....................................................................
|
|
CITIZEN MOORE
| |
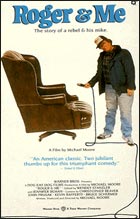 |
|
|
Depuis 1992, date
de sortie de son premier film Roger and Me qui décrivait
de manière critique, et dans une certaine mesure autobiographique,
la fin de l’ère du fordisme à travers l’exemple
de la fermeture des usines General Motors à Flint,
Michigan (leur siège historique) et leur " délocalisation " au
Mexique, Michael Moore a réalisé The Big
One, où il s’attaque au fabricant multinational
de chaussures Nike, et Canadian Bacon… Il a également
publié des livres dont Downsize this et le récent
Stupid White Men , et travaillé à la
télévision, créant TV Nation puis
The Awful Truth. Il est devenu, en dix ans, à
l’intérieur des Etats-Unis, l’une des figures de la
contestation du " Nouvel Ordre Mondial " -
impérialisme politique, offensive idéologique
et suprématie économique des Etats Unis - instauré
par George Bush père au début des années
1990.
Bowling for Columbine (sortie fin septembre 2002) est
son quatrième film et peut être le plus abouti,
à ce jour, de sa filmographie. Prenant comme point
de départ un massacre dans un lycée de la petite
ville de Columbine, Colorado (où des adolescents ont
ouvert le feu sur leurs camarades et professeurs, faisant
plusieurs morts) Michael Moore explore le rapport ambigu que
la nation américaine entretient avec la violence et
le culte des armes à feu. La force de cet essai mordant
est d’échapper à la manière conventionnelle,
" sujet de société ", d’évoquer
cette question ; sa structure est là pour rappeler
à chaque instant que vouloir faire de la violence un
sujet en soi, c’est-à-dire à l’isoler d’autres
questions plus essentielles dont elle est le symptôme,
serait une imposture. Le premier travail consiste donc en
une redéfinition des termes du débat, en opposition
avec le discours médiatique.
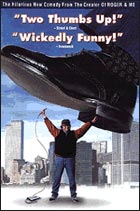 |
|
|
|
Pour la télévision
américaine (et européenne, notamment française)
l’affaire est entendue : il suffit de parler de " violence ",
de " délinquance ", de " criminalité "
pour que des images mentales se forment très vite :
la violence est le fait des " minorités "
et, essentiellement, des Noirs (1). " Le
suspect est un homme noir de 30 ans environ... ",
c’est l’incontournable commentaire des journaux télévisés
du soir dans leur rubrique complaisante consacrée au
crime; et ce, quelle que soit la ville des Etats Unis. Le
postulat médiatique est simple : les pauvres créent
l’insécurité or les Noirs sont pauvres donc
ils sont dangereux car ils en veulent à la propriété
privée ; les armes sont nécessaires pour se
protéger de ces nouveaux indiens.
Moore s’ingénie à montrer, par des exemples
concrets, en quoi cette vision des choses est partielle, fausse
et intéressée. Dans Bowling for Columbine,
on apprend ainsi que la police a modifié la procédure
d’arrestation des " délinquants "
afin de satisfaire aux exigences des chaînes de télévision,
avides d’humiliation et de spectaculaire : un montage montre
plusieurs scènes similaires où des policiers
(Blancs) arrêtent un " délinquant "
(Noir), lui arrachent ses vêtements jusqu’à ce
qu’il soit torse nu et le maintiennent plaqué au sol
avec leurs pieds. Près d’une fois sur deux, le " suspect "
est innocent. De telles scènes, très impressionnantes,
n’existeraient pas sans la télévision. Elles
accentuent l’idée de sauvagerie de la victime - alors
même que c’est elle qui subit une attaque sauvage -
et renvoient certainement à un inconscient esclavagiste
dont la population blanche ne s’est jamais vraiment débarrassée.
Un sociologue spécialisé dans l’étude
de la criminalité explique ensuite que la délinquance
des Noirs n’est pas la plus importante aux Etats Unis mais
que c’est de très loin la plus représentée.
Moore nous montre enfin que cette vision médiatique
de la violence attribuée aux seules " minorités "
sert à masquer les crimes de la " majorité "
- blanche et possédante. Il s’attaque alors à
une délinquance, quantitativement plus importante,
dont curieusement les médias ne parlent jamais (sinon
lors de " bavures " comme le scandale
Enron ) : celle des entreprises, " Corporate Crime ".
Leur éventail est si étendu qu’il va de l’empoisonnement
des usagers aux fraudes fiscales de grande ampleur en passant
par l’usage de faux, la corruption, le détournement
de fonds et une multitude d’infractions aux lois américaines
et internationales. Dans sa série télévisée
" TV Nation ", Moore avait déjà
créé le personnage burlesque du " Corporate
Crime Chicken " ; un poulet redresseur de torts
traquant les entreprises coupables d’infractions à
la loi. Dans son film, il approfondit la démarche d’analyse
avant d’opposer à l’image télévisée
du délinquant Noir, celle d’un cadre de grande entreprise
que des policiers arrêtent et auquel ils arrachent sa
chemise...
|