La levée de
bouclier qu’a provoquée le rapport de Blandine Kriegel,
conseillère du Président, qui préconisait
de supprimer les œuvres violentes ou sexuellement explicites
du petit écran de 7h à 22h30, cache en réalité
la part de responsabilité des gouvernements successifs
et de leur politique de censure de l’image dans l’appréhension
du sexe et de la violence. Entre son " Manifeste
Porno " et ses apparitions publiques, retour sur
la jeune réalisatrice Ovidie, figure du féminisme
" pro-sexe " dont le travail, aujourd’hui
mis en cause, marque le fossé entre l’industrie du
film pornographique et l’inanité de la censure d’Etat.
| |
 |
|
|
La question en fâche
plus d’un, que le film dit " pornographique " ne
s’embarrasse plus des quelques salles des Champs Elysées,
ou du boulevard de Strasbourg, à l’entrée du
métro Strasbourg Saint-Denis, des salles comme La Scala,
ou Paris Ciné. Genre honni, souvent caricatural, de
piètre qualité la plupart du temps puisque aujourd’hui
réservé quasi-exclusivement au marché
de la vidéo, le film pornographique assume pourtant
une influence certaine sur le marché, non-seulement
sur les " Pink Movies " japonais, ou sur
les " roman poruno " de la Nikkatsu, mais
également sur les productions dites classiques, et
ce jusqu’à la rétrospective que consacrait la
Cinémathèque Française à l’acteur
réalisateur HPG en 2000.
La législation internationale, anglo-saxonne particulièrement,
qui censure et sanctionne les images considérées
comme " pornographiques " ou plus largement
" évocatrices " au cinéma
et à la télévision, a été
rapide à comprendre leur danger potentiel. Le fait
que le premier cas de censure pour cause d’ " obscénité "
(" obscenity ") avéré dans
l’industrie du disque date de 1986 seulement avec le disque
" FrankenChrist " des Dead Kennedys chez
Alternative Tentacles Records témoigne d’une différence
de traitement significative entre support audio et audiovisuel
tandis que, dès la création du cinématographe
en 1895, le film Serpentine Dance présenté
à l’Exposition Universelle de Chicago avec l’actrice
Annabelle Moore, fit un tel scandale qu’on décidait
d’en détruire les bobines quelques années plus
tard.
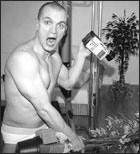 |
|
|
|
Les lois accompagnant
les sorties cinématographiques sont rapidement restrictives
alors que celles-ci étaient définies par la
Cour Suprême américaine comme " business
pure and simple " depuis 1915, impropres à
subir la censure puisque n’étant pas considérées
comme moyen d’expression (1). On considère plus
la naïveté du nickelodeon ou des images innocentes
qui viennent mourir sur les écrans aménagés
dans les foires, que la possibilité, encore embryonnaire,
de faire naître des émotions réelles.
C’est en 1922, avec le MPPDA (Motion Picture Producers and
Distributors of America) de Will H. Hays que commence à
s’organiser la censure d’Etat.
Aux USA, le média ne bénéficia donc que
de brèves années de liberté avant de
se voir contrôlé depuis la pré-production.
La pornographie semble aujourd’hui devenue l’une des cibles
privilégiées de ce pointage, tout autant que
la violence explicite à laquelle elle est irrémédiablement
rapportée par les organismes de vérification.
Durant le tournage de Dr. Strangelove qui sortira en
1963, Kubrick lui-même, accompagné de l’écrivain
américain Terry Southern, envisagea de tourner un film
pornographique à gros budget, non-pas que l’idée
de pousser au paroxysme son étude scrupuleuse du rituel
amoureux l’eut en rien séduit, mais parce qu’il souhaitait
transformer une œuvre violemment sexuelle en produit de consommation
courante, passant outre les barrières de consensus
social et esthétique, pour remettre l’œuvre artistique
au centre de la vie, contre les avis des grands studios, des
ligues de vertu ou des nouveaux libertaires, pour apporter
la possibilité d’un choix au spectateur, comme tout
grand artiste éducateur : l’œuvre finalement confrontée
à l’Homme au prix d’une liberté hors du commun
(2).
|