 |
|
|
|
De fait, la pornographie
qui s’étalait aux Champs Elysées n’existe plus,
plus sous cette forme, elle a été remplacée
par ces touches d’hypocrisie, ou de misogynie quotidienne
que personne ne remarque plus, comme le fait que les employés
de la voirie naviguant sur les Champs soient de facto
de sexe féminin, pour apporter, dit-on, une " touche
féminine ", c’est-à-dire raffinée,
élaborée, à l’axe parisien comme lieu
de commerce. Et la femme, reléguée au rang d’objet,
mais - ce qui semble-t-il fait toute la différence
- d’objet " beau ", balaye, nettoie et
frotte méthodiquement l’avenue avec un charme que n’importe
quel mâle irait lui envier s’il savait quel emploi il
perd-là.
Ovidie a ce défaut, aux yeux de la presse française,
et de la télévision en particulier, qu’elle
représente trop parfaitement l’évolution du
mouvement féministe dans la société française,
jusqu’à Luce Irigaray, poussée, aux yeux de
ses détracteurs, jusqu’à son paroxysme intenable,
comme si, tout en s’affranchissant des sujétions de
la phallocratie, les femmes devaient en somme se résoudre
à ne jamais dépasser les truismes masculins,
images encore morales, conservatrices, largement stéréotypées
jusqu’aux barmaids de la rue Oberkampf. " Pornographie "
en grec signifie " décrire la prostituée ",
seulement voilà, de " prostituée "
il n’y en a pas ici, seulement quelques jeunes femmes, des
hommes, moins nombreux, prêts à jouer de l’acte
sexuel pour des raisons qui leur sont propres. En ce sens
tout commentaire, toute glose, y compris le présent
article, crée la " pornographie ",
c’est l’œil unique qui en exposant, en décrivant l’acte
le transforme et le manipule en le rapportant à lui.
C’est ici, trop souvent, que réside la véritable
misogynie, lorsque, pour reprendre les mots de Barthes " le
photographe s’est trop généreusement substitué
à nous dans la formation de son sujet " (4),
et où, habitués que nous sommes à ce
que la porno star sans passif authentique ou identité,
se contente de venir faire acte de présence sur le
petit écran, agace si elle ne joue pas suffisamment
son personnage. On la présente dénuée
de toute personnalité, on la prive, à l’opposé
de tout autre comédienne, d’un droit à voir
sa carrière évoluer, s’altérer, à
parler de ses goûts et de ses états d’âme.
| |
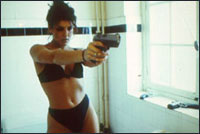 |
|
|
À la sortie
de Baise moi de Virginie Despentes et Coralie en 2000,
peu de commentateurs pouvaient encore s’émouvoir lorsque
Karen Lancaume et Raffaëla Anderson parlaient du viol
dont elles avaient été victimes, si ce n’est
pour ajouter à la caricature. Pourtant, tant que le
film pornographique reposera sur une équipe, du monteur
au photographe, et qu’il demandera une mise en scène,
c’est-à-dire la participation de plusieurs corps de
métier pour parvenir à un résultat peu
ou prou artistique, celui-ci ne pourra se résumer à
une question morale, aussi pertinente soit-elle, puisqu’un
film ne saurait seulement naître d’un trouble psychologique
individuel, ou d’une détresse vécue.
La pornographie s’apparente alors à la science de la
représentation, et remplit son office quand, tout en
étant décortiquée par les magazines,
elle demeure condamnée implicitement par la majorité
comme un jeu malsain, délicieux mais parfaitement condamnable.
Aussi, comme l’analysait froidement David Cronenberg dans
le recueil d’entretiens que lui consacre Chris Rodley, se
pencher sur la censure revient à se pencher sur l’état
de sanité d’une société qui confond dangereusement
réalité et fiction : " Censors tend
to do what only psychotics do: they confuse reality with illusion "
(5) et qui ne parvient pas à répondre
de manière appropriée à la misogynie,
et pire encore à la haine de la femme, non-pas imaginaire,
mais réelle, et subie quotidiennement.
 |
|
|
|
En identifiant la
frontière qui existe entre la réalité,
complexe comme les événements récents
l’ont à nouveau souligné, des " travailleuses
du sexe " dont elle se fait l’une des porte-drapeaux,
entre son travail d’actrice réalisatrice et sa personne,
Ovidie contrarie le plus souvent la stratégie des
médias qui consiste à nier, sur le ton de
la plaisanterie, la dure réalité de la phallocratie
française, sans appeler à la fondation de
nouvelles gynécées, sans néanmoins
apporter d’autres réponses que la consommation renouvelée
de produits dont elle est l’une des représentantes.
La sexualité serait donc soit représentative
du point de convergence de tous les aspects moraux de notre
société, soit de la " folie néolibertine
des gaucho-intellos " (6), comme si l’acte
même devait figurer, élucider quoi que ce fut
d’autre que ce qu’il montre sans fausse pudeur, un message
politique, sans doute, dont la portée est encore
à définir aujourd’hui.