Ovidie, en parlant de " travailleuse
du sexe " expose clairement ce paradoxe, et renvoie
la télévision, comme les politiques, à
leurs caricatures et à leurs propres clichés;
la " travailleuse ", ni vedette ni porno-star,
renvoie autant au monde du travail et à la quotidienneté
que l’ouvrier de l’usine Ford ajustant sa machine. Il y a
pas là matière à érotisme, ni,
à fortiori, à " pornographie ",
qu’une jeune femme, belle, séduisante, aimable, qui,
avoue-t-elle sans grande difficulté, n’a jamais manifesté
au public aucune part de son intimité. Celle-ci ne
peut être présumée qu’au travers de ses
écrits, Porno Manifesto paru en 2002 aux éditions
Flammarion, ou bien en glanant certains indices sur son site
web où figurent une série de textes en faveur
du militantisme féministe " pro-sexe " ,
d’autres témoignages en forme de professions de foi
pour une reconnaissance de la prostitution.
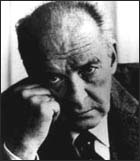 |
|
|
|
En rattachant pornographie
et prostitution, sans généralité ni dérision,
Ovidie a du moins eu le courage d’aider à dissocier
la figuration de la sexualité de sa réalité
ordinaire en prenant le contre-pied de la plupart de ses compagnons
d’armes. Si " travailleuse du sexe " il
y a, celle-ci parvient à assumer sa charge simplement
fonctionnelle, loin de tout fantasme et de toute enjolivure,
sans la moindre référence à la vertu.
Pourquoi fallait-il que les médias prêtent l’oreille
à une vedette de films pornographiques tandis que les
pamphlets féministes sont régulièrement
tournés en dérision ? Parce qu’Ovidie est
aujourd’hui à la croisée des chemins, entre
le fait d’assumer un métier - celui de la pornographie
- qui s’auto-parodie sans cesse dans la misogynie la plus
noire et les revendications les plus farfelues, et la nécessité
de se démarquer de son image stéréotypée
pour parvenir à faire passer un discours d’une honnêteté
désarmante.
Force est de constater que tout en mettant en lumière
une esthétique et une scénarisation tout à
personnelle, et originale, les films d’Ovidie se rattachent
à une longue tradition du film pornographique, pornographie
dont Nabokov se moquait dans un article aujourd’hui publié
en exergue de son roman Lolita, porté à
l’écran par Kubrick en 1961 pour la Warner Bros, et
où il s’amuse du caractère élémentaire
de la représentation de l’acte sexuel, ici dans le
cadre de la littérature: " (…) l’action doit
être limitée à une copulation de poncifs.
Style, construction, imagerie, rien ne doit distraire le lecteur
de sa fade concupiscence. Il est essentiel que le roman se
réduise à une succession de scènes érotiques,
séparées par de simples points de soudure logique,
des ponts d’une architecture aussi sommaire que possible,
les brefs enchaînements explicatifs, que le lecteur
sautera probablement sans les lire, mais dont l’absence lui
donnerait l’impression d’être frustré (réflexe
dont l’origine remonte aux contes de fées " véridiques "
de l’enfance). Qui plus est les scènes d’amour doivent
aller crescendo, avec de nouvelles variations, de nouvelles
combinaisons, de nouveaux sexes, et avec un nombre sans cesse
croissant d’acteurs (dans telle pièce de Sade, on convoque
le jardinier), de sorte que les derniers chapitres soient
encore plus gonflés de sensualité que les premiers ".
La distribution des
scènes est respectée, laissant supposer une
prochaine évolution de ses productions, mais ces
" points de soudure logique " dont parle
l’auteur américain, chez Ovidie, ont la qualité
peu commune de se fondre dans une masse onirique inédite,
où l’univers de la comédienne prend pleinement
forme.
Les personnages qu’évoque Ovidie dans ses propres
films, qu’il s’agisse de la Reine des Morts d’Orgie en
noir, ou de Lilith (Lilith, 2001) s’amusent des
clichés de la femme-objet en présentant au
spectateur une presque divinité, une femme à
la fois gracieuse et masculine dans ses mouvements, qui
dirige ses acteurs comme elle commande les rites amoureux.
Il faudrait être dupe pour croire un seul instant
que ces codes renversés constituent un acte féministe,
puisqu’on sait - depuis Sade ou Pasolini - que la soumission
sexuelle s’amuse également à feindre la domination
et la force. Le spectateur masculin ne ressentira donc aucune
gêne à regarder cette Reine barbare dominant
les hommes, puisqu’il connaît la pantomime à
laquelle il assiste dans ce faux conte de fées. Ovidie,
si elle s’incarne dans la Lilith de l’Alphabet de Ben Sirah
passée par l’heroic-fantasy, reste plus proche de
l’Eve biblique, sortie du flanc d’Adam, métonymie
commode de la soumission de la femme à l’homme, et
qu’on retrouve à chaque fois que la comédienne
est confrontée aux médias.
Là on lui demande, sans pudeur, ce qu’elle aime dans
le sexe, ce qu’elle préfère réellement,
pour se persuader, sans doute, de la correspondance entre
la créature de cinéma et la jeune femme sensuelle
qui visite, mi-souriante mi-réservée, les
plateaux de télévision. Demande-t-on à
Anna Karina si elle se plait en dévote chez Rohmer,
ou si, au détour de La Religieuse, elle assistait
à la guérison de deux aveugles et d’un démoniaque
? (3) On l’interroge effrontément, tout en
la regardant avec appétit, tandis que les magazines
culturels se servent de l’intérêt que suscitent
les porno stars pour faire monter le chiffre de leurs ventes
en kiosque.