AU PLUS PRES DE LA VIE
SYNOPSIS :
Hsiao Kang est vendeur de montres dans les rues de Taipei.
Quelques jours après le décès de son père, il rencontre une
jeune femme, Shiang-Chyi, qui part le lendemain pour Paris.
Hsiao Kang, oppressé par le comportement de sa mère qui attend
le retour de l’esprit de son mari défunt, se réfugie dans
le souvenir de cette jeune femme et tente de se rapprocher
d’elle en réglant les montres et horloges de Taipei à l’heure
de Paris. Là-bas, Shiang-Chyi affronte quelques péripéties
qui semblent mystérieusement liées à Hsiao Kang.
|
|
....................................................................
|
Notes à propos du synopsis du
film Et là-bas quelle heure est-il ?
| |
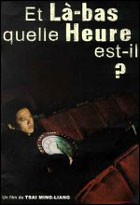 |
|
|
Le synopsis, reproduit ici dans
son intégralité, est celui qui figure dans le dossier de
presse de Et là-bas quelle heure est-il ? Ce
document est accompagné de la filmographie de Tsai Ming-Liang,
de commentaires et d’anecdotes du réalisateur concernant
ses comédiens et le film lui-même, d’une critique de Tony
Rayns, d’une interview de Benoît Delhomme, directeur de
la photographie de Et là-bas…Une filmographie du
directeur artistique Yip Kam Tim, de Arena Films (producteur
avec Homegreen Films de Et là-bas…), clôt ce dossier
rédigé en trois langues (français, anglais, chinois).
Hsiao Kang…
Hsiao Kang est le surnom de Lee Kang-Sheng, l’acteur
fétiche de Tsai Ming-Lang. Quand il parle de Lee Kang-Sheng,
Tsai Ming-Liang dit Hsiao Kang. Dans Les Rebelles du
dieu néon, Lee Kang-Sheng porte son vrai nom à l’écran.
Dans Les Rebelles du dieu néon, La Rivière,
Et là-bas…, le même appartement est utilisé comme
décor principal. C’est l’appartement, dans la vie, de Lee
Kang-Sheng.
Deux extraits des Quatre cents coups de François
Truffaut, le film préféré de Tsai Ming-Liang, apparaissent
dans Et là-bas... Le premier sur un écran de télévision
par l’intermédiaire d’une vidéo achetée sur un marché (Antoine
Doinel, plaqué contre les parois d’un manège de fête foraine,
lutte contre la force centrifuge). Le second plein écran
(Doinel toujours, errant dans les rues de Paris au petit
matin, vole une bouteille de lait. Il la jette dans une
bouche d’égout après avoir bu son contenu, goulûment, à
toute vitesse).
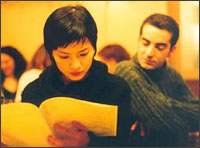 |
|
|
|
Dans Et là-bas…, Jean-Pierre
Léaud jouant son propre rôle rencontre, par hasard, dans
un cimetière (le cimetière du Montparnasse ?), le personnage
interprété par Chen Shiang-Chyi (qui n’a pas de nom), en
visite à Paris. On s’étonne du peu de changement entre le
visage de gosse du comédien entrevu tout à l’heure et son
visage d’homme vieillissant. Quelques rides évidemment,
les cheveux sont longs à présent, mais rien de plus. L’intensité
du regard est absolument la même.
L’évocation de François Truffaut, de son œuvre, n’est pas
un hommage. C’est un élément parmi beaucoup d’autres. Il
relie les deux personnages principaux : Hsiao Kang
et Chen Shiang-Chyi. D’après le cinéaste, il symbolise aussi
le temps qui passe. Il constitue un axe du film, mais n’en
est pas le point essentiel.
Lee Kang-Sheng n’est pas l’Antoine Doinel de Tsai Ming-Lang.
Le comédien est peut-être une sorte d’écho de la personnalité
du cinéaste mais certainement pas sa représentation. C’est
ce qu’est Lee Kang-Sheng qui fait son intérêt. Tsai Ming-Liang
ne l’envisage pas du tout comme un substitut, une copie
de lui-même. Il est la matière du créateur, son médium.
« C’est de découvrir qui il est, comment il évolue
qui me fascine », déclarait, dernièrement, Tsai
Ming-Liang dans un article de presse (Le Monde, Aden,
n°176). Il insistait aussi, par ailleurs, sur la ressemblance
physique frappante qui existe entre son père et Lee Kang-Sheng.
|