En attribuant à cet article un titre analogue à celui qu’avait
dédié Eric Rohmer au cinéma américain des années 50, je veux
montrer que Spike Lee est le digne héritier de cette génération
de cinéastes qui a marqué l’histoire du 7ème Art.
Son cinéma s’affirme comme le miroir social d’une Amérique hantée
par les résurgences de ses afflictions historiques, il filme
comme le témoin d’une société dont le passé est à restituer
à son peuple. Son œuvre est une métaphore de l’évolution des
Etats-Unis. |
|
....................................................................
|
| |
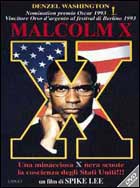 |
|
|
Alors que John Ford filme
dans My Darling Clementine la fondation épique de ce
continent, Lee retrace la renaissance de la communauté afro-américaine.
Faut-il chercher à comprendre Spike Lee à travers l’Amérique ?
Ou bien redécouvrir l’Amérique par le prolongement de son
cinéma ?
Adulé ou haï pour les idées radicales qu’il véhicule au travers
de ses films, il pâtit d’un a priori négatif : franc,
raciste, arrogant, colérique, antisémite, inquisiteur sont
les adjectifs que l’on lit régulièrement dans la presse à
son propos. Il apprécie la controverse et adore déplaire à
l’Hollywood politiquement correct, ce qui lui vaut d’être
honni par certains médias et de faire partie de ceux qu’on
préfère détester. Auréolé du succès de Malcolm X,
il tint des propos virulents contre les WASP et subit une
avalanche de critiques. Certains refusent encore de le considérer
comme l’un des cinéastes majeurs du patrimoine cinématographique
américain. Auteur le plus prolifique de sa génération, son
œuvre est indéniablement sous-estimée et réduite à n’être
que l’avant-garde d’un cinéma afro-américain moribond. S’il
a ouvert la voie à la nouvelle vague de jeunes réalisateurs
que sont John Singleton, Albert et Allen Hughes, Matty Rich,
Darnell Martin, Ernest Dickerson, il est aussi inquiet de
l'évolution que prend ce cinéma, selon lui : « relégué à trois
genres : la comédie romantique, la comédie vulgaire et
les films « drogue-gangster-hiphop-violence ». C'est
ce que les studios achètent, dit-on aux scénaristes noirs.
Cela impose des limites aux acteurs, aux rédacteurs, aux auditoires.
Le Festival de Sundance n’est plus que l’antichambre de l’Académie
des Oscars, Miramax joue le rôle de cheval de Troie d’Hollywood
alors que les Majors et les indépendants utilisent des stratégies
d’alliances communes, uniformisant ainsi une partie du cinéma.
Les « ex-contrebandiers » que sont Soderbergh, Gus
van Sant, Curtis Hanson, Paul Thomas Anderson, succombent
aux sirènes des grands studios et ne sont plus dorénavant
que des réalisateurs « main stream ». Spike Lee,
de son coté, fait figure d’exception en tant que réalisateur
indépendant (1). Evoluant à la frontière du système,
il a bouclé la majeure partie de ses films avec un budget
limité. Get on the Bus à été entièrement financé, à
hauteur de 2,5 millions de dollars, par des stars de la communauté
Noire (Will Smith, Wesley Snipes ) ou bien She’s Gotta
Have It, réalisé pour la somme de 175 000 dollars. Même
sur la super-production Malcolm X, si Spike Lee a exigé
de la Warner une durée au moins égale au JFK d'Oliver
Stone (190 minutes) et des moyens équivalents avec un budget
de 28 millions de dollars, pour pouvoir boucler le tournage
il dut renoncer aux deux tiers de son salaire et fit appel
aux subsides de ses amis (Bill Cosby, Oprah Winfrey, Magic
Johnson et Michael Jordan).
|