Plus d’un an après la sortie en salles de Christmas,
son dernier film, la Cinémathèque française a organisé en avril
2003 une rétrospective intégrale de l’œuvre d’Abel Ferrara,
du cinéma aux téléfilms en passant par les clips. Plus qu’une
simple succession de films et d’images, le travail de programmation
a su mettre en rapport les œuvres entre elles, créer des liens
et une osmose insoupçonnés dans le travail du cinéaste. |
|
....................................................................
|
| |
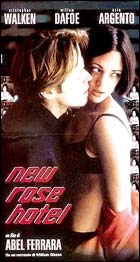 |
|
|
On a pu découvrir une véritable
philosophie du cinéma et des images, mise en lumière par le
petit film tourné par Asia Argento pendant le tournage de
New Rose Hotel (malheureusement non sous-titré en français).
On y découvre la difficulté de Ferrara à faire entendre sa
voix et sa volonté au sein de l’industrie cinématographique :
il veut filmer en cinémascope, on lui refuse, malgré des arguments
qui fondent son esthétique. Le cinémascope est, selon lui,
le format de l’intimité. Voici donc un cinéaste qui réfléchit
son œuvre et le cinéma.
La cohérence esthétique est étonnante. Et nous découvrons
alors Ferrara. Le cinéaste de la violence se révèle être celui
de la lenteur. Celui du corps exposé est en réalité celui
du brouillage, de l’anamorphose.
ANAMORPHOSE
En mettant en relation les paroles de la chanson de
Mylène Farmer, California, et les images tournées par
Ferrara, Nicole Brenez, dans une analyse de l’émission Court-circuit
diffusée pour l’occasion sur grand écran, dresse un portrait
politique de l’œuvre du cinéaste dont les images seraient
le support, et conclut : « dans le rétro, ma
vie qui s’anamorphose : Mylène Farmer, la meilleure
analyste de l’œuvre de Ferrara ? ». À l’anamorphose
de la vie s’associe l’anamorphose des images, qui vient sans
doute en premier lieu. Cette question s’illumine à la vision
successive du clip, dans lequel les néons se sur-impriment
au paysage urbain, et de Body Snatchers, troisième
version du thème, tourné en cinémascope.
 |
|
|
|
Les images comme les cultures
se superposent. On ne peut distinguer la bourgeoise de la
pute, toutes deux incarnées par la même icône musicale, comme
on ne peut distinguer l’humain du body snatcher, le flic du
truand, le Chinois de l’Italien. Les visages se succèdent
comme autant de doubles. Les communautés délimitent des frontières
qui ne peuvent qu’êtres transgressées pour créer un monde
hybride, malgré les efforts des hommes déjà pris dans l’engrenage
sans qu’ils veuillent le reconnaître. On ne se différencie
plus que par des détails que l’on veut encore culturels mais
qui ne sont plus que des habitudes consciemment conservées :
la nourriture, le meurtre… Le personnage ferrarien lutte perpétuellement
contre l’anamorphose menaçante d’une société hybride.
Dans des films où les personnages comme les univers semblent
identiques, où le bien et le mal sont mis sur un pied d’égalité,
où le flic tue pour empêcher le truand de tuer, Ferrara est-il,
comme le propose le titre de la rétrospective, indifférent
au mal ?
Les images de violence d’une apparente froideur cachent en
réalité des interrogations, un regard scrutant les visages
de ceux qui tuent et qui finiront par être tués, l’observation
étonnée de corps qui changent et sont pourtant les mêmes dans
la vie comme dans le meurtre. Il semble que Body Snatchers
explicite tout le travail à la fois filmique et scénaristique
du cinéaste : les corps sont en réalité des doubles extraterrestres.
On ne peut plus se fier à personne dans un monde où tout le
monde se ressemble, à l’image du camp militaire dans lequel
les hommes ne sont plus que des ombres. On ne distingue plus
le fond de la forme, la surimpression, qu’elle soit au sein
même de l’image ou mixte entre deux images, devient anamorphose,
et bien plus : hybridation.
|