| |
 |
|
|
C’est ici que s’arrête la comparaison avec
le film de Kurosawa, humaniste et touché par la peine de ses
contemporains, car dans La Rivière, la pauvreté n’est
pas offerte à l’œil du spectateur afin d’en tirer un principe
politique, ou pour se rapprocher du style documentaire - à
la manière de Pluie Noire de Shohei Imamura. La mère
de Kichii est une femme superbe, désirable, habillée à la
japonaise et dans les vêtements traditionnels de son pays
tandis que le sort a l’air de l’avoir entièrement épargné.
Elle-même traduit la grande originalité d’Oguri, et son extraordinaire
talent de cinéaste. Car La Rivière de Boue est une
œuvre sans pitié, qui ne désigne jamais les caractères pour
en tirer une quelconque fable morale. On est loin des films
de « classes » qu’affectionnait Kurosawa. La famille
de Nobuo, sans être véritablement aisée, ne fait pas partie
de la nouvelle bourgeoisie qui émerge des décombres de la
guerre, et le film évite tout bipolarisme clair ; la
frontière, la ligne de fuite, se situe à un tout autre niveau,
philosophique, métaphysique. La pauvre péniche n’a rien d’un
navire capable d’affronter le large, dégradée, gonflée par
l’eau de la rivière, c’est une vieille coque qui finira par
quitter le port à la remorque d’un plus gros navire. Les deux
familles vivent là comme capturées par leurs souvenirs de
la guerre, non pas seulement dans l’amertume, mais dans une
authentique douleur, ressentie physiquement dans l’absence
du père, la faim qui tenaille les enfants, ou la vie misérable
de la mère de Kiichi ramenée à l’existence de prisonnière,
séparée du reste de la péniche par une cloison qui la coupe
du regard de ses deux enfants.
C’est que les apparences
dissimulent elles-mêmes d’autres nuances, plus complexes encore,
et cette misère de la mère de Kiichi, montrée sans trace ni
stigmate, simplement d’une beauté et d’une jeunesse éclatante,
est bien le signe d’un ambitieux projet cinématographique,
d’autant plus ambitieux que le cadre de La Rivière de Boue
est très fortement limité. Les comédiens sont peu nombreux,
comme le nombre de décors. L’action se situe sur une scène
restreinte où seuls les quelques plans de la rivière rappellent
au spectateur la présence, certes lointaine, d’Osaka et du
reste de l’île. Ce film claustrophobe, forcément replié sur
lui-même, s’ouvre paradoxalement à un espace d’une richesse
étonnante, où les détails prennent de nouvelles proportions.
C’est justement ce qu’on ne peut pas voir, et ce que la caméra
est incapable de filmer et de mettre en scène qui est le vrai
sujet du film. Ici la rivière polluée sert à emprisonner,
à empêcher toute velléité de mouvement. Comme le passé des
deux familles, celle-ci demeure sombre sous une surface égale,
et abrite dans ses profondeurs une carpe d’une taille peu
commune que les enfants interprètent comme un monstre fabuleux,
capable de dévorer les Hommes. Le vieux pêcheur que Nobuo
voit tomber à l’eau est rapidement oublié par l’œil du spectateur
et par la narration, symbole du dérisoire de toute vie humaine.
Il a finalement intégré la rivière, sa légende, et part rejoindre
les créatures mystérieuses que les enfants imaginent. Ce n’est
plus le port encombré où les bateaux se pressent pour décharger
leurs marchandises, ce n’est plus un lieu d’escale pour les
mariniers. Personne ne s’arrête ici que les quelques clients
du restaurant en bord de grève. Le monde autour de la rivière
s’est définitivement échappé du cycle du temps et du passage
des saisons.
 |
|
|
|
Sorti sur les écrans à une
période - les années 1980/1990 - où le cinéma japonais tente,
non sans difficulté, de surmonter la crise économique et le
déclin des Majors, La Rivière de Boue est tout
autant tourné vers le passé du Japon, son âge d’or cinématographique
- les années 1950 -, que vers la nouvelle génération d’auteurs
- les années 1980. Avant la montée en puissance de grands
cinéastes comme Kiyoshi Kurosawa, Sogo Ishii, Aoyama Shinji
ou Takashi Miike, Oguri Kohei signait là un premier chef-d’œuvre
qui mérite, plus de vingt ans plus tard, et suite aux difficultés
que le cinéaste rencontre à financer ses films, tous ou presque
des échecs commerciaux, d’être apprécié à sa juste valeur.
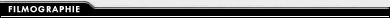 |
|
1996 L' Homme qui dort avec Masako
Yagi, Koji Yakusho
1993 Correspondance
par l'image avec Slamer Rahardjo Djarot (docu)
1990 L'Aiguillon
de la mort avec Keiko Matsuzaka, Ittoku Kishibe
1984 Pour Kayako
1981 La rivière
de boue d’Oguri Kohei
|
|
|