| |
 |
|
|
Le mouvement est donc au cœur, est le cœur
du cinéma de Ford. Et s’il apparaît porteur d’espoir – ce
noyau d’énergie positive que peuvent représenter l’installation
définitive, le renouveau ou la fuite enthousiasmante loin
de ce qui pèse –, il est malgré tout le résultat complexe
de plusieurs opérations, l’agrégat de plusieurs strates inégalement
constituées ou réparties (une pulsion individuelle, une logique
identitaire, une appartenance ethno-culturelle, une politique
nationale, une idéologie nationaliste) dont l’art fordien
rend compte (c’est là son seul sujet, du contraste photographique
ici à la profondeur de champ dans ses westerns) dans une forme
d’une limpidité et d’une franchise de trait (son sens prodigieux
des cadres) qui n’annulent en rien, bien au contraire, l’existence
concrète de cette complexité-là.
Monument Valley deviendra plus tard la figuration géologique
et architectonique de toute l’œuvre fordienne comme de ce
qui la travaille : quelles sont les forces qui traversent
le monde, lui impriment leur marque, participent de ses stratifications
et bousculent ses plaques ? À une autre échelle (économique,
chronologique, géographique) et avec d’autres moyens cinématographiques,
André Téchiné (dans Loin par exemple) ou Hou Hsiao-Hsien (dans
Goodbye South, Goodbye)
n’ont récemment pas filmé autre chose.
 |
|
|
|
Parce qu’il est aussi un cinéaste radical
du faire et de l’agir, qui ne néglige en aucune façon que
le dire a aussi une part active dans ceux-ci (Young
Mister Lincoln, Grapes of Wrath, The Man who shot Liberty Valance) (3), Ford
montre avec The Informer le sort d’une impuissance à vivre
lorsque le faire (partir) est neutralisé par l’inertie d’un
mauvais dire qui devait pourtant signifier la réalisation
même de ce faire (la délation, encouragée socialement, sanctionnée
localement, paralysante individuellement). Gypo, emmailloté
dans les ambivalences méconnues d’un agir interdépendant de
celui des autres (et cette méconnaissance est bien la seule
chose partagée équitablement par tous), rappelle cet « homme
total » dont parlait Marcel Mauss en 1924, « affecté
dans tout son être (…) par le moindre choc mental » (Sociologie
et Anthropologie, PUF, Paris, 1993, p. 306).
Paradoxe ? Contradiction non perçue a déjà répondu l’historien
Henri Lefebvre. La tragédie (et a fortiori la tragédie fordienne)
n’a pas d’autre ressource visible que la complexe matière
qui l’anime. Comme Nietzsche le disait de lui-même, Ford est
au fond un pessimiste gai. C’est-à-dire lucide.
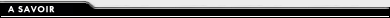 |
|
1) Nota bene : ce n’est pas le DVD
qui fait le film en lui redonnant un soi-disant
nouvel accès au champ du visible, mais le film
qui fait la seule justification du DVD, le rendant
désirable et regardable.
2) On aimerait d’ailleurs
conseiller vivement ce film aux thuriféraires
du « mythe de l’insécurité » (Pierre
Tévanian) et autres zélés fonctionnaires œuvrant
à pénaliser les classes défavorisées si leurs
convictions en la matière (la totale et absolue
responsabilité du délinquant dans son acte), s’essayant
à renouveler ce que le sociologue Laurent Mucchielli
nomme une « approche stratégique » des
faits criminels (comme s’il s’agissait là d’un
projet de vie délibéré et mûrement réfléchi) issue
de l’école libérale américaine, n’étaient pas
sous-tendues par une logique économique d’entretien
de la précarisation et de gestion d’une main-d’œuvre
corvéable à merci.
3) Pour le coup, on
dira que Ford est beaucoup plus proche de John
L. Austin (Quand
dire c’est faire) que de Pierre Bourdieu (Ce
que parler veut dire), justement en vertu
de cette « approche pragmatique du langage »
qui considère celui-ci non seulement dans sa dimension
syntaxique ou sémantique mais bel et bien comme
un acte véritable, consistant en une action à
accomplir. Le « pragmatisme », c’est
aussi et d’abord, d’après des penseurs tels Charles
S. Pierce, John Dewey et surtout William James
(le frère aîné d’Henry) qui s’étaient élevés à
la fin du 19e siècle contre les tenants
du scientisme universitaire (ceux qu’ils nommaient
« intellectualistes ») et furent reconnus
en leur temps par Henri Bergson, affirmer qu’une
idée (chez Ford c‘est une image), si elle est
en accord avec la réalité, est utile pour l’action,
« avantageuse pour notre pensée » (W.
James), en un mot vraie, quelle que soit dans
le cas du cinéma de Ford la véracité accomplie
ou non (puisqu’on n’a jamais cessé de lui en faire
le reproche) de la reconstitution historique,
western ou autre.
|
|
|