« La beauté convulsive sera érotique-voilée,
explosante-fixe, magico-circonstancielle ou ne sera pas »
André Breton, L’Amour fou (Gallimard, 1937, repris
en Folio, p.26)
Les dieux du cinéma ne nous ont pas été bien cléments ces
derniers temps : à peine un mois après la disparition
de Maurice Pialat, c’est João Cesar Monteiro qui sort du champ.
Mort, le cinéaste qui sut en un seul plan, celui concluant
Souvenirs de la maison jaune en 1989, ressusciter simultanément
le Von Stroheim de Foolish Wives et le Max Schreck de Nosferatu
de Murnau et conséquemment nous terrifier de sa crâne audace
fait à nouveau peur. Lui parti, et c’est le fascisme qui gagne
du terrain : c’était déjà la fin sublime – du genre :
« Qui m’aime me suive ! Et qui me hait fascise,
qui me rejette pactise avec le fascisme ! » – du Bassin
de J.W. en 1997. Et pourtant quand même cette certitude qui
nous réjouit, qui nous fait tenir en vie : avec l’œuvre
du plus grand cinéaste portugais après Manoel de Oliveira
l’immortel (pour lui, on n’a définitivement plus peur !),
au coude à coude avec Antonio Reis et Paulo Rocha, c’est la
preuve faites films (on compte depuis 1965 une toute petite
dizaine de longs métrages et autant de moyens et de courts
métrages – autrement dit une œuvre immense quand on en connaît
seulement que la moitié – que l’on brûle de pouvoir découvrir
complètement un jour) que la beauté aura été déjà. Et qu’elle
aura bien été selon l’espoir entendu de Breton convulsive.
|
| |
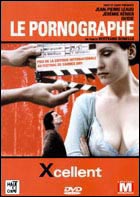 |
|
|
Salué discrètement, le temps d’une séquence
cinéphile, par le jeune et talentueux Bertrand Bonello dans
Le Pornographe en 2001 (1), ce pornographe lisbonnais
aux antécédents (le milieu de ses parents) anticléricaux et
antisalazaristes a hissé si haut les voiles de l’écran gonflées
des vents rares de l’extrême singularité que n’est pas permis
à une foule avide de suiveurs et d’imitateurs, contrairement
à ce qui s’est passé avec Jean-Luc Godard dont le cinéaste
s’est par ailleurs réclamé, d’emprunter la voie unique de
ses tortueuses avancées. Le premier titre de l’œuvre que Monteiro
a monté non sans difficultés sur cinq années entre 1965 et
1970 le dit sans ambages : Qui court près les souliers
d’un mort meurt nu-pieds. Ayant toujours fui les ors frelatés
de la reconnaissance officielle (à moins seulement de pouvoir
les pervertir : Monteiro dans son rôle favori de parasite/poil
à gratter aura été celui qui chiennement dit au puissant de
s’ôter de devant notre soleil ! (2)), le cinéaste
portugais a préféré s’atteler à une tâche autrement plus urgente
et pertinente. Celle de mettre en crise radicale, d’excéder
les codes disciplinaires et justificateurs de la représentation
comme de la fonctionnalité morale, matérielle et idéelle de
notre monde. La fin des Noces de Dieu en 1999, en citant
celle de Pickpocket de Robert Bresson, renseigne sur
ce désir monteirien de fuir tout sentiment de claustration
et toute situation d’assujettissement.
C’est le théâtre filmé comme tel de la domination, de l’exploitation
et de l’asservissement que Monteiro via ses doublures double
et met à sac. Il en est doublement et perversement le justicier
vengeur et le monstre honni, une sorte d’ange exterminateur
priapique traversé par l’utopie calvinesque du Baron perché,
celui qui se plait à réinventer les propres modalités de son
existence et du temps dont cette existence a besoin pour s’épancher.
A la fois maître du temps et inféodé aux glandes comme dirait
encore Cioran, Monteiro met notre monde littéralement sens
dessus dessous. Le dérèglement des sens naguère désigné par
un Rimbaud exalté par sa terrible découverte puis repris par
le Pasolini de Théorème (3) est calmement
retrouvé par ce démiurge de pacotille, ce faussaire de génie,
cet homme « déterminé par une horreur testiculaire
du ridicule d’être homme » (E.M. Cioran, op. cit.,
p.95). Où cela ? Sous les culottes clairsemées de quelques
poils pubiens (que le cinéaste fétichiste et collectionneur
nomme pensées) appartenant à de prosaïques jeunes filles,
jamais aussi naïves qu’on pourrait le croire (l’une d’entre
elles ne se nommait-elle pas dans Les Noces de Dieu
Elena Gombrowicz ? (4) ). Il ne s’agit que de proposer
un autre monde possible, entrevu dans l’œil torve du cinématographe
et dans lequel vivre libre peut devenir réel dans l’exercice
de la mise en faillite de toute censure, de toute servilité,
de toute répression. C’est-à-dire de tout fascisme. D’où l’âne,
mascotte du Bassin de J.W., que Monteiro sut rendre
autonome du chef-d’œuvre bressonien Au hasard Balthazar :
il est cet animal bâté qui prend des coups parce qu’il fait
tout le contraire de ce qu’on lui demande de faire, avec quand
même cette qualité d’avoir été fortement pourvu par la nature.
Paradoxalement (mais c’est un paradoxe bien vite résolu) l’impuissance,
alors que Monteiro n’a eu de cesse de dire qu’il bandait encore,
appelle chez lui la démiurgie qui ne souffre d’aucun désir
de reproduction puisqu’elle n’est que la modalité de sa propre
volonté créatrice.
|