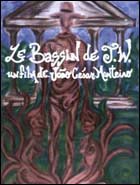 |
|
|
|
Un plan monteirien se signale en général
(La Comédie de Dieu parachèvera cette idée) par une
volonté apparente de maîtrise des espaces que le cadre fixe
et large souligne, comme s’il fallait que le monde entier
et tous les temps qui l’ont composé (rappelés proustiennement
(6) par les citations) rentrent dans le plan, mieux
comme si le plan se voulait comme alternative possible (et
temporaire, car soumise à la durée intrinsèque au plan lui-même)
au monde. Ensuite, si l’on y regarde plus attentivement, on
verra que ces plans à la géométrisation a priori implacable
qui semblent reproduire le cube scénographique du Quattrocento
sont en fait tous affectés d’une légère dissymétrie. Ces plans
légèrement bancals, métaphores du bateau qui hante l’œuvre
entière, ces plans-bateau sont comme traversés d’une houle
invisible, désignant toujours une ligne de fuite qui rompt
avec la volonté de maîtrise que déploie le cinéaste. Maîtrise
biaisée qui renvoie à la position jamais assurée du personnage
lui-même, digne héritier en cela de Chaplin, toujours sous
le coup d’une expulsion.
La durée du plan, c’est aussi permettre de retravailler en
profondeur la mécanique du burlesque même, étirant les gags
(alors que généralement ils demandent une vitesse d’exécution
afin d’être imparables) jusqu’à l’absurde, amplifiant d’autant
plus leur chute, souvent inattendue par le spectateur. C’est
dans La Comédie de Dieu la glace-prototype vendue à
un certain Français du nom d’Antoine Doinel (que joue impavidement
Jean Douchet) qui, au bout du plan-séquence dans lequel le
protocole politico-économique aura été longuement déroulé
et aussi un peu bousculé (on entend Deutschland über alles
à la place de La Marseillaise !), fera dire à
l’acheteur : « Mais cette glace, c’est de la
merde ! ». C’est dans le même film le paquet
de cigarettes qui offre à Monteiro face au boucher qui veut
l’écorcher (ce dernier a appris qu’il s’était tapé sa fille)
de retarder en allumant clope sur clope, à chaque fois éteinte
par son futur bourreau, le moment de l’attendue raclée (qui
ne sera pas filmée !). C’est enfin dans Les Noces
de Dieu, après la nuit de noces justement, Jean de Dieu
croyant faire l’amour à sa bien-aimée (qui s’est tirée avec
la caisse !) et déclarant sobrement à la toute fin du
plan : « Tout le monde peut se tromper, comme
dit le hérisson à la brosse à chaussure ». Le plus
hilarant dans tout cela, c’est que Monteiro honnêtement ne
cherche jamais à jouer l’ambiguïté de la situation et que,
dans le même temps, son personnage s’en tire par une pirouette
des plus stoïques.
| |
 |
|
|
Le cinéma personnaliste au sens du philosophe
Emmanuel Mounier, donc absolument pas individualiste mais
ni collectiviste non plus (plutôt anarchiste en fait), de
João Cesar Monteiro philosophant dans son boudoir précaire
et taquinant à la manière de Rabelais (7) la dive bouteille
(cf. Le Dernier Plongeon en 1992 au titre emblématique)
comme la donzelle en fleur, c’est tour à tour pouvoir y convoquer,
sur le mode sensitif et chatoyant des correspondances baudelairiennes
et par la pratique vertigineuse d’un art du trans-citationnel
et de l’intertextualité que seuls au cinéma Ruiz et Godard
égalent :
- l’univers idéalisé du personnage de Des Esseintes du symboliste
A rebours de Huysmans et celui rabougri de Fédor Dostoïevski
l’intériorisé (à la chrétienté fatiguée) et de Samuel Beckett
l’extériorisé (à la métaphysique épuisée) ;
- la forme excédentaire et dionysiaque du solaire Georges
Bataille le nietzschéen et celle de l’obscur comte de Lautréamont
qu’adorait Breton ;
- la scénographie chaplinesque (un plan, c’est fait pour vivre
dedans : d’où le cadre pour l’habiter et la durée… pour
le faire durer) et l’art buñuelien de faire saillir le détail
qui tue (le personnage de Jean de Dieu, saint et martyr comme
écrivait Sartre au sujet de Genet, c’est la triple synthèse
de Monsieur Verdoux, de Archibald de la Cruz,
mais aussi du personnage du Testament du Cordelier de
Jean Renoir) ;
|