Sam Peckinpah est un cinéaste majeur ; de nombreux réalisateurs
comme Martin Scorsese, John Woo ou John Carpenter, le considèrent
comme leur père spirituel et revendiquent la filiation ;
pourtant il est le grand absent au panthéon des cinéastes américains.
Si le titre d’inventeur du « dirty western », parsemé
de gun-fight apocalyptiques, lui est attribué, cette
évocation est réductrice au vu de la valeur de sa filmographie
et de l’influence qu’elle a exercée. |
|
....................................................................
|
| |
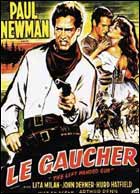 |
|
|
Son œuvre s’inscrit dans une véritable comédie
humaine métaphysique de l’Amérique et des américains, où y
sont dévoilées les afflictions historiques de cette société :
individualisme et violence exacerbée. La cruauté de ses héros
ne s’exprime que parce qu’elle est le résultat du monde dont
elle est l’héritière ; l’inhumanité qu’il retranscrit
n’est que le produit des structures sociales de l’Amérique
contemporaine. Afin d’assimiler totalement sa vision, une
étude des personnages est nécessaire.
Le thème de prédilection de Peckinpah est celui des « perdants »
face à la mutation d’une société qui aliène leur liberté.
Dans ses six westerns, qui sont aussi ses six premiers films,
il a exposé sa conception du cinéma et a façonné des personnages
picaresques. Dans le western traditionnel, la figure principale
est généralement celle du héros, qui est instinctivement du
côté de la justice et du bon droit, prêt à défendre le parti
des opprimés - le héros deviendra plus ambigu, de plus en
plus indistinct du bad man, comme on le découvre chez
Penn, mais aussi chez Anthony Mann, balayant peu à peu les
stéréotypes des prémices du western. Sous les coups de feu
de Bloody Sam, les poncifs du western classique vont entièrement
voler en éclats. Avec le personnage de Billy the Kid, il renouvelle
l’interprétation du rebelle romantique en décalage avec le
truisme de la représentation de William Boney. Quant à Arthur
Penn, dans Le Gaucher, il présente Billy the Kid comme
un anti-héros suicidaire à la recherche de sa propre mort :
« ni un ignoble tueur ou un sympathique hors la loi,
Billy est un rebelle sans cause »(1). Paul Newman, en
campant un délinquant juvénile névrosé, ambigu, détourne les
canons du genre en amorçant une vraie révolution dans le traitement
du hors-la-loi dans le western.
Penn, Fuller, Peckinpah, font partie des nouveaux cinéastes
qui critiquent l’Amérique au travers de ses mythes et
de ses clichés. Ce dernier expose une nouvelle vision du western,
plus violente, dans laquelle il laisse place à une peinture
naturaliste des États-Unis. Loin de constituer pour lui une
nouvelle esthétique, cette brutalité lui permet de dénoncer
les relents d’une Amérique contrainte par une violence convulsive.
Ainsi, avec la bestialité extrême de la horde, son caractère
misérable, ses tendances suicidaires, son absence de but existentiel,
mais aussi avec l’interprétation de William Holden, qui apporte
toute la profondeur au personnage emblématique de Pike Bishop,
on commence à parler de western crépusculaire. La fin de The
Wild Bunch (1969), avec une bataille sanglante de plus
de trois cents morts, si elle dépeint l’effondrement d’un
Ouest mythique, est surtout l’aboutissement d’une quête métaphysique.
En démythifiant les traditionnels cow-boys de l’Ouest, la
parabole du héros disparaît : « Mes héros sont des
losers parce qu’ils sont battus d’avance, ce qui est
l’un des éléments primordiaux de la vraie tragédie ».
|